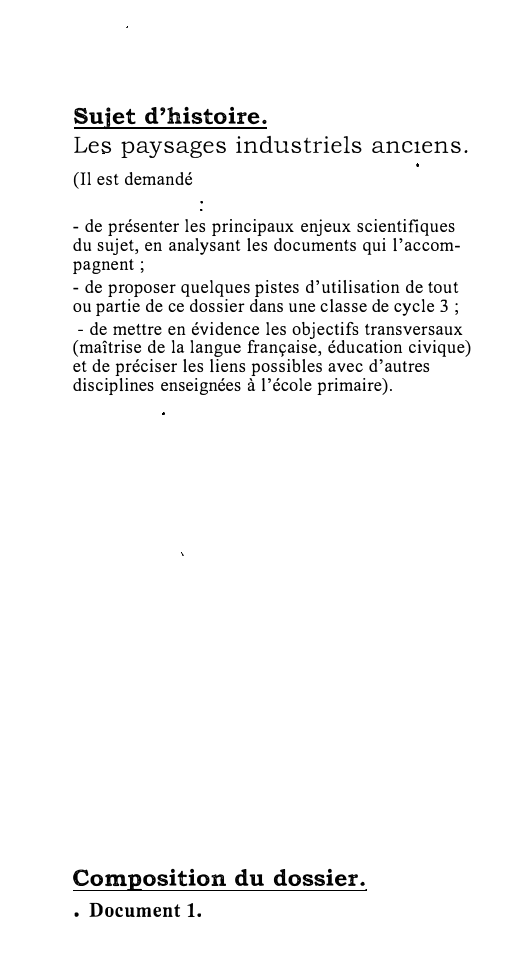Sujet d'histoire. Les paysages industriels anciens. (Il est demandé - de présenter les principaux enjeux scientifiques du sujet, en analysant...
Extrait du document
«
Sujet d'histoire.
Les paysages industriels anciens.
(Il est demandé
- de présenter les principaux enjeux scientifiques
du sujet, en analysant les documents qui l'accom
pagnent;
- de proposer quelques pistes d'utilisation de tout
ou partie de ce dossier dans une classe de cycle 3 ;
- de mettre en évidence les objectifs transversaux
(maîtrise de la langue française, éducation civique)
et de préciser les liens possibles avec d'autres
disciplines enseignées à l'école primaire).
Composition du dossier .
.
Document 1.
Bernard MALCZYK / André JANSON
- a) Extrait de la carte I.G.N.
de Douai, 1956.
© IGN 2006
Reproduction interdite
Autorisation N ° 6006105
b) Extrait de la carte I.G.N.
de Douai, 1994
© IGN 2006
Reproduction interdite
Autorisation N° 6006 I 05
• Document 2.
-a) Le centre historique minier de Lewarde,
Photographie A.
Janson (août 2006).
-b) Une cité minière: un coron à Ecaillon,
Photographie A.
Janson (août 2006).
-c) Le terril Saint Roch à Monchecourt,
Photographie A.
Janson (août 2006).
• Document 3.
L'histoire charbonnière de Nord-Pas
de-Calais, Texte d'A.
Janson.
« Le Nord-Pas-de-Calais a connu une histoire char
bonnière de plus de deux siècles et demi.
En 1734,
l'exploitation commence à Anzin près de Valen
ciennes.
Le 21 décembre 1990, le ôernier pu,its de
mine du bassin est fermé à Oignies : 2 milhards de
tonnes de charbon ont été extraites du sous-sol.:: Cette
histoire a été marquée par la présence dans le P.a'ysage
des mines, des cités (les corons) et dès ternls,.
(350
existaient).
Le charbon est encore présent dans le
sous-sol de Valenciennes à l'est, à Béthune à l'ouest;
il est de bonne qualité mais les veines étroites,
pentues, faillées, et profondes (jusqu'à 1 200 mètres)
sont difficiles à exploiter, donc le ,Prix est beaucoup
trop élevé.
La France a privilégie dans les années
1960 l'utilisation du pétrole et importe la houi:lle de
Chine, de Pologne, de Russie.
L'Etat est intervenu pour faciliter le reconversion (la
transformation des activités traditionnelles du bassin
houiller).
Des usines automobiles ont été créées,
l'Etat, les collectivités locales (Région, Départe
ments) font appel aux entreprises pour s'installer dans
la rég10n et creer des emplois.
»
• Document 4.
La création de zones franches urpaines,
Magazine d'information de la communauté d'agglomération du douaisis N°3, mai 2006.
« Le comité interministériel sur la ville présidé par
Dominique de Villepin a officialisé, le 10 mars
2006, la création de quinze nouvelles zones franches
urbaines dont celle présentée par la Communauté
d'agglomération du Douaisis.
Pour la C.A.D., l'obten
tion ûe cette zone franche était à la fois une nécessité
impérieuse pour le Douaisis où le tissu industriel
montre des signes d'essoufflement, mais aussi un bol
d'oxygène pour le développement économique et
l'emploi.
Le président Jean-Jacques Delille ne éache
pas son enthousiasme et son optimisme quant aux
retombées favorables que cette zone franche ne
manquera pas de générer dans tout le Douaisis.
« En bénéficiant, pour au moins cinq ans, d'exoné
rations fiscales et sociales exceptionnelles, notre zone
franche urbaine devrait attirer nombre de porteurs de
projets et de créateurs d'emplois.
»
Corrigé :
les enjeux scientifiques
• La France reste une puissance industrielle:
L'aventure industrielle, qui a débuté au XIXeme siècle,
marque les territoires et les paysages.
Les géographes
distinguent trois générations d'industries.
Les indµstries de première génération sont nées
au XIXeme et concernent les secteurs de la mine,
du textile, etc.
L�s industries de deuxième génération
sont nées au xxeme siècle sur de nouvelles énergies
ou de nouveaux procédés de fabrication ( électricité,
pétrole, chimie, automobile, etc.).
Les industries
de troisième génération sont issues de la révolution
informatique et se développent dans les années 1970.
Le dossier traite des espaces et des paysages de la
première génération dans le douaisis.
Il est composé
de deux extraits de cartes I.G.N.
au 1/25 000 ; de trois
photographies actuelles présentant des traces
du passé : une fosse, un coron, un terril ; un texte
informatif explique l'évolution économique de la
région ; enfin un extrait d'un magazine local informe
des mesures concernant les territoires.
Ils nous
amènent à poser cette problématique : « Quelles sont
les permanences et les évolutions qui affectent
les paysages industriels anciens ? » .
• L'exploitation minière a fortement marqué les
espaces et les paysages.
- L'extrait la) de la carte I.G N montre l'ampleur
de l'emprise des houillères.
La région située
à l'est de Douai est caractérisée par la présence
de trois puits de mines (Gayant, Notre Dame
et Bernicourt).
La mine de charbon comprend
les installations souterraines, invisibles sur
les cartes, les paysages et des installations
de surface que l'on peut observer.
Le chevalement
du puit de mine (document 2a) sert à aménager
les galeries, transporter le personnel, le matériel,
le charbon.
A proximité, le lavoir : les berlines
remontent de la houille avec des stériles ; le lavoir
trie le charbon, le calibre avant de le commercialiser.
Le terril (document 2c) est constitué des déchets
rejetés du lavoir.
Les produits sont évacués par voie
ferrée : un chemin de fer, appartenant aux houillères,
relie les mines entre elles.
Le charbon ensuite
est expédié par le réseau de la S.N.C.F.
ou par
le canal à grand gabarit.
Une chaîne d'industries
est liée à l'extraction du charbon : cokeries, centrale
thermique qui utilise les charbons de moindre qualité,
et usine chimique.
- La carte la) montre l'ampleur des cités minières.
Elles ont été construites à l'extérieur du vieux village
de Waziers.
Elles ont des formes diverses en fonction
de leurs dates de construction.
Les plus anciennes
se présentent sous la forme de corons aligp.és
(document 2b).
Ils datent du début du xxeme siècle.
D'autres, plus récents, obéissent à un plan quadrillé
et les maisons sont plus clairsemées, le cadre plus
aéré (cité de la Clochette).
• Cette aventure minière de la région s'achève dans
les années 1960.
Le document 3 avance quelques
causes : difficultés d'exploitation (veines étroites,
faillées, pentues, profondes qui rendent difficile
· la mécanisation), concurrence de nouveaux pays
producteurs (Chine, Pologne, etc.) et de nouvelles
sources d'énergie (le pétrole).
Dès les années 1960,
les politiques mettent en place un programme
de diminution de la production et d'accompagnement
des personnels.
Le dernier puits de mine a fermé en
1990.
Quelles sont les conséquences économiques, spatiales
et paysagères de cette évolution ?
• L'organisation de l'espace industriel en 1956.
If
�\��
%lIl
l;j
l::
""...
� �
4J" e;�
:::!
..,
,'
/
/
I
;
1
1
I.
I
.
i
1
@
�
�\!!
l-...
.
Y> 152:
j! .J
"'
1SX.
"'
0
0,:
,:
a� 8
1
• Les permanences sont marquantes.
- L'habitat est encore marqué par la prégnance
des corons.
Ils ont été réhabilités en fonction
des normes de sécurité et de confort actuelles.
Les logements issus des houillères représentent
dans tout le bassin Nord-Pas-de-Calais 83 000
logements (une ville de 250 000 habitants).
1
1
�
- Les terrils marquent encore l'espace et les paysa
ges.
Il en reste 330, répartis sur 110 km.
Après avoir
été des objets de« haine» témoignant de l'exploi
tation des hommes, ils sont devenus des« monu
ments » symboliques marquant....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓