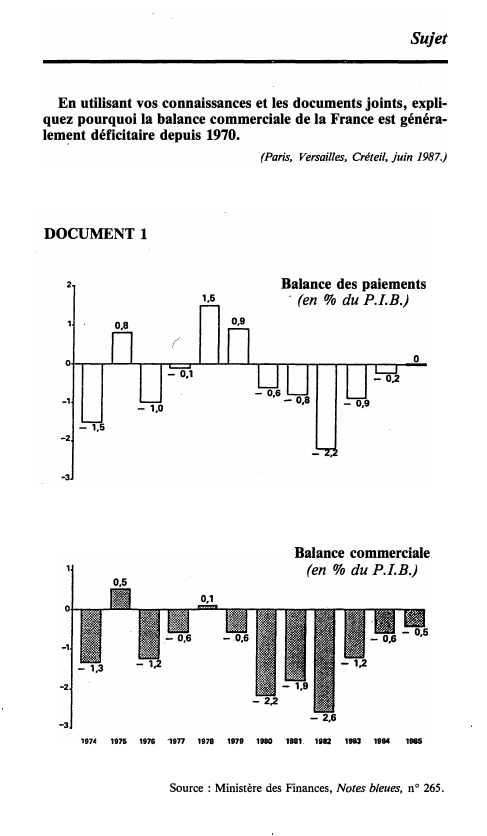Sujet En utilisant vos connaissances et les documents joints, expli quez pourquoi la balance commerciale de la France est généra...
Extrait du document
«
Sujet
En utilisant vos connaissances et les documents joints, expli
quez pourquoi la balance commerciale de la France est généra
lement déficitaire depuis 1970.
(Paris, Versailles, Créteil, juin 1987.)
DOCUMENT 1
Balance des paiements
- (en % du P.I.B.)
1,5
0,9
-2
- 1,5
- 2.2
Balance commerciale
(en % du P.I.B.)
-2
-3
1974
1976
1976
·1977
1978
1979
1980
1981
1912
1981
1984
1985
Source : Ministère des Finances, Notes bleues, n ° 265.
DOCUMENT2
Solde des échanges de marchandises par produits
(en milliards de francs)
100
--
50
AGRC).ALtMENTAIRE ==
0
--
·-
-50
-100
50
0
-50
-
-150
-200
100
INDUSTRIE
-100
'
ENERGt�==
-
:= ,;.150
11114 11115 1111e 111n 11178 111111 111eo 111a1 111&2 11183 11114 11185
-200
Source : Ministère des Finances, Notes bleues, n ° 265.
DOCUMENT3
Commerce extérieur en 1985
(en milliards de francs)
BIENS INTERMtDIA/RES
Les secteurs déficitaires
Les secteurs excédentaires
Source : Centre français !lu commerce extérieur, !_ 985.
DOCUMENT4
Part de marché dans les importations en provenance
de l'O.C.D.E.
1970
1978
1983
1984 19851
Parts détenues dans les importations
japonai�es par
- les Etats-Unis ............
- la R.F.A.
...............
- le Royaume-Uni ...........
- la France ...............
55,7
6,1
4,0
1,9
46,3
6,2
4,3
2,4
51,7
5,0
4,1
2,7
50,7
5,0
4,2
2,3
52,6
5,3
3,2
2,4
Parts détenues dans les importations
américaines par :
- le Japon ...
" ...........
- la R.F.A.
............
' .
.
- le Royaume-Uni ...........
- la France ...............
20,5
10,9
7,7
3,3
25,6
10,4
6,7
4,2
27,5
8,5
8,3
4,0
28,9
8,6
7,3
4,1
30,8
9,1
6,3
4,4
Parts détenues dans les importations
allemandes par :
- la France ...............
- les États-Unis ............
- le Royaume-Uni ...........
- le Japon ......
' ' .
' .
' .
16,4
14,2
5,0
2,1
15,5
9,6
6,6
4,0
15,0
9,3
9,1
5,0
13,0
9,4
10,0
5,6
14,0
9,7
10,6
5,6
Parts détenues dans les importations
britanni9ues par
- les Etats-Unis ............
- la R.F.A.
...............
- la France ...............
- le Japon ...............
19,6
9,2
6,1
2,2
14,9
15,9
11,3
4,5
13,9
17,9
9,4
6,2
14,7
17,3
9,2
5,9
16,92
17,1
9,1
5,6
..
1.
Moyenne du premier semestre.
2.
Moyenne des quatre premiers mois de l'année.
Source : B.N.P.
DOCUMENTS
Conjoncture
Les prix industriels à l'exportation pénalisent la France
dans ses échanges commerciaux
Les échanges commerciaux de la France ne se sont pas amé
liorés en 1985 par rapport à 1984: le déficit restera de l'ordre de
20 milliards de francs.
Les analyses qui sont faites à propos de
cette stagnation font état du défaut de compétitivité des prix
français, notamment ceux des produits manufacturés.
« En ter
mes de coûts unitaires relatifs de main-d'œuvre, nous avons
rejoint nos principaux partenaires européens, mais en termes de
prix relatifs à l'exportation, nous sommes encore trop chers par
rapport à nos concurrents», indique la Banque nationale de
Paris (B.N.P.) dans sa lettre de conjoncture de novembre.
Ce constat est largement développé par l'O.F.C.E.
(Observa
toire français des conjonctures économiques) dans sa Lettre du
25 décembre.
Si les prix à l'exportation des produits manufactu
rés se sont stabilisés au troisième trimestre de 1985, ils ont sensi
blement plus augmenté que les prix de production au cours des
cinq dernières années.
Depuis 1980, les prix des produits expor
tés ont augmenté de 70 % et ceux de la production d'un peu
moins de 50 % .
Toutefois, ces hausses ne sont pas également réparties et
varient selon les marchés d'exportation.
« Vers la C.E.E., indi
que la note de l'O.F.C.E., depuis plus de dix ans, chaque fois
que le franc s'est déprécié (de 1973 à 1978, le mark s'est élevé de
1,60 franc à 2,25 francs), les prix à l'exportation exprimés en
francs ont monté au-delà de sa dépréciation.
Les trois dévalua
tions intervenues d'octobre 1981 à mars 1983 ont accéléré ce
mouvement, le portant à 15 % par an.
Depuis le troisième tri
mestre 1983, en l'absence de nouvelle dévaluation du franc, la
hausse se ralentit mais est encore de 8 % par an.
»
L'influence de la valeur du franc sur les prix se vérifie dans les
échanges avec les pays de !'O.C.D.E., hors Communauté euro
péenne: les prix suivent l'évolution du dollar.
« Lorsque le dol
lar passe de 4, 14 francs en 1979 à plus de 10 francs au début de
1985, les prix s'élèvent de 15 % par an.
» Ils reculent aussitôt
que le dollar baisse.
Source : François Simon, Le Monde, 31 décembre 1985.
DOCUMENT6
Croissance et contrainte extérieure 1
110
96
Il
Ill
1984
IV
Il Ill
1985
IV
Il
1986
Source : Le Monde, 15 août 1986.
1.
Quand la croissance repart en France, · les importations
redémarrent de plus belle.
D'une part, les ménages consomment
beaucoup de produits étrangers pour leur équipement brun
(téléviseurs, magnétoscopes...) et blanc (réfrigérateurs, machi
nes à laver...).
De l'autre, les entreprises ne trouvent pas sur le
territoire toutes les machines nécessaires à l'augmentation de
leur productivité ou de leurs capacités.
Ainsi, au cours du deuxième trimestre 1986, les achats de
biens d'équipement ménager ont augmenté de 11 OJo (la Coupe
du monde aidant), les investissements des entreprises industriel
les de 5,1 OJo et les importations de produits manufacturés de
8,3 0/o.
La réduction de la facture pétrolière permet, pour l'ins
tant, de supporter cette contrainte extérieure, mais l'hypothè
que demeure.
DOCUMENT7
Évolution des échanges
de vêtements féminins
entre la France et la R.F.A.
Source : Le Monde, 13 septembre 1986.
DOCUMENTS
Compétitivité
La montée en puissance de l'Allemagne s'explique par une
organisation tout industrielle du vêtement féminin.
Celui-ci a
bien changé depuis la Seconde Guerre mondiale, alors que le
berceau de la confection était à Berlin.
Essentiellement tenu par
des artisans juifs, il a été décimé par le régime nazi.
Reconstruit,
le secteur est désormais très concentré : trois entreprises, Steil
man, Betty Barclay et Sink Gruppe, réalisent plus de 300 mil.
lions de deutschemarks de chiffre d'affaires.
Leur stratégie consiste autant à abaisser au maximum les
coûts de production qu'à satisfaire les exigences de la grande
distribution.
Du côté production, les Allemands de l'Ouest ont obtenu des
prix inférieurs de 20 Ofo aux moyennes françaises en délocalisant
leur production à l'extrême : pour 60 Ofo, celle-ci est traitée en
Asie, en Europe de l'Est ou sur le pourtour méditerranéen.
Au
point de forcer les Français à les imiter, dans un important revi
rement stratégique.
Du côté de la distribution, les Allemands ont mis leur rigueur
au service de leur dynamisme commercial.
A l'exportation, ils
respectent à la lettre le b a ba du métier - conformité du pro
duit au modèle présenté, respect des délais de livraison - que
négligent trop souvent les Français.
Prompts à sentir les nou
veaux besoins du marché, ils présentent désormais quatre à six
collections par an, quand les Français en sont encore à deux.
Ils
se heurtent certes, en France ou en Italie, à l'obstacle que repré
sente le réseau éclaté des petites boutiques.
Mais ils profitent,
pour progresser, de la part croissante occupée, dans ces pays,
par la grande distribution.
Source : Le Monde, 13 septembre 1986.
■ Il s'agit d'un sujet classique et relativement simple à traiter,
car il n'est pas ambigu.
REMARQUES GÉNÉRALES
■ Il faut naturellement commencer par définir la balance com
merciale.
Commençons par la balance des paiements : C'est un docu
ment comptable qui mesure l'ensemble des transactions d'un
pays avec l'étranger, avec une incidence monétaire.
La balance des paiements se décompose de la manière sui
vante:
• Balance des transactions courantes :
- balance commerciale (importations, exportations);
- balance des invisibles (commerces, services, transferts).
• Balance des mouvements de capitaux :
- balance des capitaux à long terme· (investissements directs,
emprunts, etc.);
- balance des capitaux à court terme.
■ Le sujet ici proposé est limité à la balance commerciale, qui
pose un problème à la France.
Il faut cependant observer que la
balance des invisibles dans un pays ne suit évidemment pas
automatiquement la tendance de la balance commerciale.
■ Rappelons que la comptabilisation des opérations commer
ciales peut se faire « franco à bord» (F.A.B.) ou « coût, assurance, fret compris» (C.A.F.).
Les importations sont généralement comptabilisées C.A.F.,
et les exportations F.A.B.
■ Il faut, enfin, rappeler ce que signifie un déficit de la
balance commerciale.
D'une part, cela traduit un problème dans les structures
industrielles du pays, si ce déficit n'est pas accidentel; d'autre
part, un déficit provoque des sorties de devises.
■ La balance commerciale renvoie, évidemment à ce que le
pays considéré vend et achète (au niveau des marchandises),
mais il faut tenir compte des réalités monétaires : ainsi, une
dévaluation peut, pour les entreprises exportatrices du pays
considéré, être favorable (en les rendant plus compétitives à
l'extérieur et sur le marché intérieur).
Quand il y a dévaluation dans un pays, le prix des biens que le
pays importe (exprimé dans la monnaie de ce pays) augmente,
et les quantités de biens importés par ce pays auront tendance à
diminuer pour cette raison.
A l'inverse, les prix des marchandi
ses exportées exprimés en monnaie étrangère (c'est-à-dire dans
la monnaie des partenaires commerciaux du pays qui dévalue)
auront tendance à baisser, et donc les exportations seront favo
risées.
Pour la balance commerciale, la situation sera positive si les
effets sur les quantités échangées (importations et exportations)
sont assez importants pour entraîner une diminution en valeur
des importations et une augmentation en valeur des exporta
tions.
Le rôle des entreprises du pays considéré est essentiel: il
ne faut pas qu'elles se servent des dévaluations pour augmenter
leurs marges de profit sur les produits qu'elles exportent.
■ La nature des échanges commerciaux évolue: en cas de diffi
cultés commerciales, il est certain que les pays n'ont pas tous les
mêmes marges de manœuvre : tous les pays qui doivent
s'approvisionner à l'extérieur pour l'énergie, par exemple,
même s'ils sont très dépendants, ne sont pas dans une situation
comparable : lors de la première hausse pétrolière, toutes les
économies capitalistes industrielles ont été frappées, mais le
Japon n'a pas eu les mêmes délais pour rétablir l'équilibre de sa
balance commerciale: tout dépend de ce que l'on doit impérati
vement acheter, mais aussi de ce que l'on vend: et sur ce point,
il faut bien préciser que plus le produit est sophistiqué, moins il
y a de concurrents pour le vendre, et donc plus on est sûr de
pouvoir acheter son énergie ou son alimentation, sans pro
blème, pour équilibrer ses comptes.
De plus, on peut aussi estimer que lorsque l'on produit des
biens intégrant une technologie avancée, on est plus libre d'en
fixer le prix: la fiabilité importe alors plus pour les clients que le
coût.
Premier plan : à proscrire.
Premièrepartie: Ce qui fait une bonne balance commerciale.
Deuxième partie: Les causes des difficultés françaises.
Un plan de ce type n'en est pas un et conduit, de plus, à des
redites.
De même, il faut impérativement proscrire ce que nous avons
appelé dans les « Conseils aux candidats», les « plans catalo
gues» : par exemple ici, analyser, type de produits par type de
produits, la situation commerciale de la France.
PROPOSiîIONS DE PLANS
Il semble assez difficile d'échapper .à des plans classiques,
pour ne pas dire des plans « bateaux».
PREMIÈRE PROPOSITION DE PLAN
I.
Les problèmes au niveau de la production
A.
Qui produit?
P.M.E.
ou F.M.N.
par exemple.
B.
Que produite?
Il faut insister sur l'aspect essentiel de la recherche-dévelop
pement et de l'innovation.
C.
Comment produire?
La combinaison productive.
DEUXIÈME PROPOSmON DE PLAN
Il n'y a pas de fatalité du déficit.
I.
Il faut investir
A.
De quoi dépend le financement de l'investissement
net : le profit, le poids de la fiscalité?
Le rôle de l'État et des entreprises (doc.
8 et 7).
B.
ll faut un «bon» investissement
Son lien avec la productivité.
Il.
Il faut ensuite savoir affronter la mondialisation des
.
échanges.
A.
Le problème .des prix s'atténue
C'est la technologie qui est essentielle; d'où le problème
majeur : savoir produire en fonction de l'évolution de la
demande.
B.
La France a des carences traditionnelles
Exemple: face à la R.F.A.
• Ce que cela implique en cas de relance interne (doc.
6).
• La question des créneaux porteurs.
C.
La France doit apprendre à anticiper
• Elle ne doit pas se cantonner à ses productions « classiques »
où elle est du reste talonnée, par exemple par l'Allemagne ou
l'Italie.
• Il faut apprendre à vendre: techniques et comportements de
vente.
• Il faut vouloir partir à la conquête de nouveaux marchés;
mais il existe une limite: celle de la solvabilité de ces nouveaux
marchés.
TROISIÈME PROPOSITION DE PLAN
I.
Introduction
Il faut, évidemment, définir la balance commerciale, la
balance des paiements, et reconnaître que le....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓