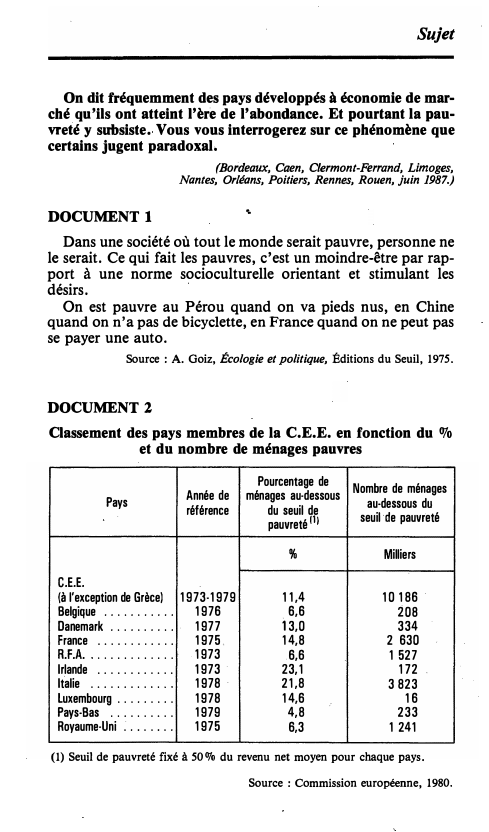Sujet On dit fréquemment des pays développés à économie de mar ché qu'ils ont atteint l'ère de l'abondance. Et pourtant...
Extrait du document
«
Sujet
On dit fréquemment des pays développés à économie de mar
ché qu'ils ont atteint l'ère de l'abondance.
Et pourtant la pau
weté y subsiste.
Vous vous interrogerez sur ce phénomène que
certains jugent paradoxal,
(Bordeaux, Caen, Ctermont-Fe"and, Limoges,
Nantes, Orllans, Poitiers, Rennes, Rouen, juin 1987.)
DOCUMENT1
Dans une société où tout le monde serait pauvre, personne ne
le serait.
Ce qui fait les pauvres, c'est un moindre-être par rap
port à une norme socioculturelle orientant et stimulant les
désirs.
On est pauvre au Pérou quand on va pieds nus, en Chine
quand on n'a pas de bicyclette, en France quand on ne peut pas
se payer une auto.
Source : A.
Goiz, Écologie et politique, tlditions du Seuil, 1975.
DOCUMENT2
Classement des pays membres de la C.E.E.
en fonction du 0/o
et du nombre de ménages pauvres
Pays
Année de
référence
C.E.E.
(à l'exception de Grèce) 1973-1979
Belgique ...........
1976
Danemark ..........
1977
France
1975.
............
Irlande .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Italie .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Luxembourg .........
Pays-Bas .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
R.F.A..............
Royaume-Uni ..
• ..
• ..
1973
1973
1978
1978
1979
1975
Pourcentage de
Nombre de ménages
ménages au-dessous
au-dessous du
du seuil de
seuil de pauvreté
pauvreté 111
%
Milliers
11,4
6,6
13,0
14,8
.6,6
23,1
21,8
14,6
4,8
6,3
10 186
208
334
2 630
1 527
172
3 823
16
233
1 241
(1) Seuil de pauvreté fixé à 50 Ofo du revenu net moyen pour chaque pays.
Source: Commission européenne, 1980.
DOCUMENT3
Selon le dernier rapport (1982) du très officiel « Bureau of the
Census » sur les caractéristiques de la population aux États-Unis
au-dessous du niveau de pauvreté, on comptait plus de pauvres
en 1982 qu'en 1965 (34,39 millions).
Pourtant, le montant des
différents programmes sociaux a été multiplié par 3,8 pendant
la même période.
La collectivité dépensait 78 milliards de dol
lars ($ constants en 1982) en 1965 et 300 milliards en 1982.
(...)
La forte réduction de la pauvreté dans les années 60 résulte de
l'action combinée de la croissance économique, de l'augmenta
tion de l'emploi et de l'accroissement des transferts.
La crois
sance des revenus de transfert jusqu'en 1976 permet de faire
face à une situation économique dégradée.
La stagnation des
mêmes transferts à partir de 1979 relance la pauvreté.
Source: F.
Verillaud, Revue française des affaires sociales,
janvier/mars 1986.
DOCUMENT4
Les nouveaux pauvres sont apparus très vite après le premier
choc pétrolier, dès que le chômage a dépassé le volant quasi
incompressible de 2 à 3 % de la population active.
Ce qui les
distingue des autres? Ils n'ont pas l'habitude! Les autres, au
moins, savent ce qu'est la pauvreté : le père a déjà été au chô
mage plusieurs fois, la mère se met ou se remet au travail, les
enfants aussi, même s'il faut arrêter les études.
Tout autre est la
réaction dans une famille de cadres moyens ou supérieurs.
Les
ASSEDIC ont constaté souvent que le père, durant de longues
semaines, n'annonce pas son licenciement et part de chez lui
son attaché-case à la main, comme à l'ordinaire : il redoute la
réaction d'une épouse habituée au confort, ou simplement
consciente de l'endettement familial, comme celle d'enfants
lancés dans des études longues.
Il a honte.
Parfois, il s'effon
dre.
Il ne se bat plus pour retrouver un emploi : de longues
années de bons salaires.
et de protection sociale tous azimuts
(...) l'ont déshabitué de la lutte.
Source: R.
Lenoir, Le Monde, 28 décembre 1984.
DOCUMENTS
Cycle de pauvreté dans une famille nombreuse
d'un groupe défavorisé
Pas de
Peu
d'éducation
ou
logement
ou logement
insalubre
dangereux
Conception
prénuptiale
et famille
nombreuse
Mortalité
infantile
Morbidité
Peu de
consommations
de biens
et services
«utiles»
Mortalité
très forte
Pas de loisirs
Pas de détente
forte
Les enfants sont dans des conditions particulièrement défavorisées
Ils·s'intègrent très difficilement
au système scolaire
Ils ne possèdent qu'une
éducation très médiocre
Source : L.
Stoléru, Vaincre la pauvreté dans les pays riches,
Flammarion, 1977.
DOCUMENT6
L'inégalité est considérée comme nécessaire au niveau de la
production : c'est par la différence des salaires versés qu'est
entretenue la motivation au travail; c'est la situation privilégiée
faite aux cadres qui permet à l'entreprise capitaliste de trouver
des auxiliaires qui s'identifient à son sort.
Cette inégalité est
également nécessaire au niveau de la consommation : le mode
de vie des classes privilégiées sert de modèle pour la diffusion
périodique de nouveaux biens ou services.
Elle est nécessaire
enfin au niveau de l'investissement, dans la mesure où celui-ci
est assuré par une épargne qui s'alimente elle-même dans les
revenus les plus élevés.
Source: N.
Questiaux, J.
Fournier, Le Pouvoir du social,
P.U.F., 1980.
DOCUMENT7
Au-delà de ses aspects humains, la résurgence d'un phéno
mène de pauvreté pose un problème politique.
Au premier sens
du terme, d'abord: celui de l'organisation de la cité.
Certes, les
temps d'expansion continue et illimitée des «Trente Glorieu.
ses» sont derrière nous.
Mais nous gardons un niveau de vie et
des équipements collectifs auxquels les plus optimistes
n'auraient pas osé rêver il y a vingt ans.
Même si la tendance
n'est pas bonne, nous sommes toujours dans une société
d'abondance.
Comment, dans ces conditions, tolérer cette nou
velle pauvreté qui prouverait, si elle se développait, notre inca
pacité à concevoir une organisation économique et sociale digne
de ce nom?
Source : Express, 26 octobre 1984.
REMARQUES GÉNÉRALES
■
Il faut au préalable définir ce que l'on entend par «ère
d'abondance» (Galbraith et «the affluent society»).
■ Il faut aussi définir la pauvreté : distinguer entre pauvreté
absolue et pauvreté relative, bien préciser ce qui les unit
(l'exclusion et la transmission aux générations qui suivent, par
exemple), mais aussi ce qui les différencie; dans un cas, la pau
vreté relative, c'est avoir moins; dans l'autre, la pauvreté abso
lue, c'est ne pas avoir, c'est être dans la misère, à la limite c'est
ne pas exister, ne pas être.
Et qui parle au nom des pauvres, et à
quel titre?
■ On ne peut confondre : la pauvreté relative entraîne une
forme de frustration (amplifiée par l'effet de démonstration
énoncé par Duesenberry et largement repris), et se maintient (et
c'est là qu'il n'y a pas vraiment de paradoxe), du fait même
qu'il y a abondance : «chaque nouvelle richesse crée une nou
velle pauvreté» dit Illich, car il y a toujours des privilégiés face
à la consommation, ceux qui ont davantage, et mieux, ou plus
vite que les autres ; et, il y a une autre pauvreté, y compris dans
nos pays riches, la pauvreté absolue : c'est le dénuement,
l'appel à la charité non plus pour vivre, mais pour survivre, et là
il y a un réel paradoxe : dans nos sociétés il y a des chiens obèses
et des vieillards qui meurent solitaires et dans le dénuement
total.
C'est une réalité qui correspond à une logique : il y a un
marché solvable pour les aliments des animaux domestiques,
leur toilettage, les pauvres ont des besoins; mais ils ne sont pas
solvables.
Enfm il faut bien préciser que la pauvreté est, évi
demment matérielle mais elle est aussi autre chose : elle est cul
turelle au sens -large, les uns se transmettent un patrimoine, les
autres se transmettent la pauvreté.
PROPOSfflONS DE PLANS
PREMIÈRE PROPOSfflON
I.
La pauvreté absolue et relative existent réellement dans
les pays riches et elles s'étendent
A.
Le cas des U.S.A.
et de la C.E.E.
B.
Et pourtant des politiques existent
• Les moyens mis en œuvre.
• Leurs limites (doc.
3).
C.
Rn'est pas admissible qu'il y ait richesse, sans moyen
pour faire reculer actuellement la pauvreté
• Les dépenses collectives (doc.
7).
• Les problèmes.
II.
Deuxième partie : Mais est-ce vraiment un paradoxe?
A.
La crise a remplacé les« Trente Glorieuses»
• Aggravation du chômage (doc.
3).
• La pauvreté absolue gagne du terrain.
• Le problème du financement social.
B.
ll y a une logique de la pauvreté (doc.
5 et 6)
C.
Les inégalités font partie de tout système et s 'aggra
vent face à la crise
• Rôle traditionnel de l'effet de démonstration (doc.
1).
• Des gens «basculent» dans la pauvreté.
• Elle n'est pas seulement matérielle (doc.
4).
DEUXIÈME PROPOSITION DE PLAN
I.
La pauvreté répond à une logique, y compris dans les
pays riches
A.
n n'y a pas d'égalité
Il y a des privilégiés dans toutes les sociétés.
• La pauvreté relative (doc.
1).
• Liée aux inégalités retransmises (doc.
5).
Rôle notamment de
l'éducation.
• L'accumulation de handicaps.
B.
Les États luttent
• L'élévation du niveau de vie, liée à la croissance.
• L'effort sur les dépenses collectives (éducation, santé, etc.) et
les aides.
C.
La pauvreté n 'est,pas que matérielle
L'effet de domination, les «leaders» (doc.
6).
II.
C'est la pauv�eté absolue qui choque ou qui dérange
A.
Le rôle de la crise et du chômage (doc.
3 et 4)
B.
Mais les politiques sont limitées et répondent-elles à
une véritable volonté générale? (doc.
7)
C.
Les résultats
• L'inégalité face aux consommations essentielles : santé, édu
cation.
• L'extension de la pauvreté (doc.
2).
TROISIÈME PROPOSITION DE PLAN
I.
Première partie : Que signifie la pauvreté ?
Un manque, sinon à gagner, «un manque à consommer».
A.
Rest....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓