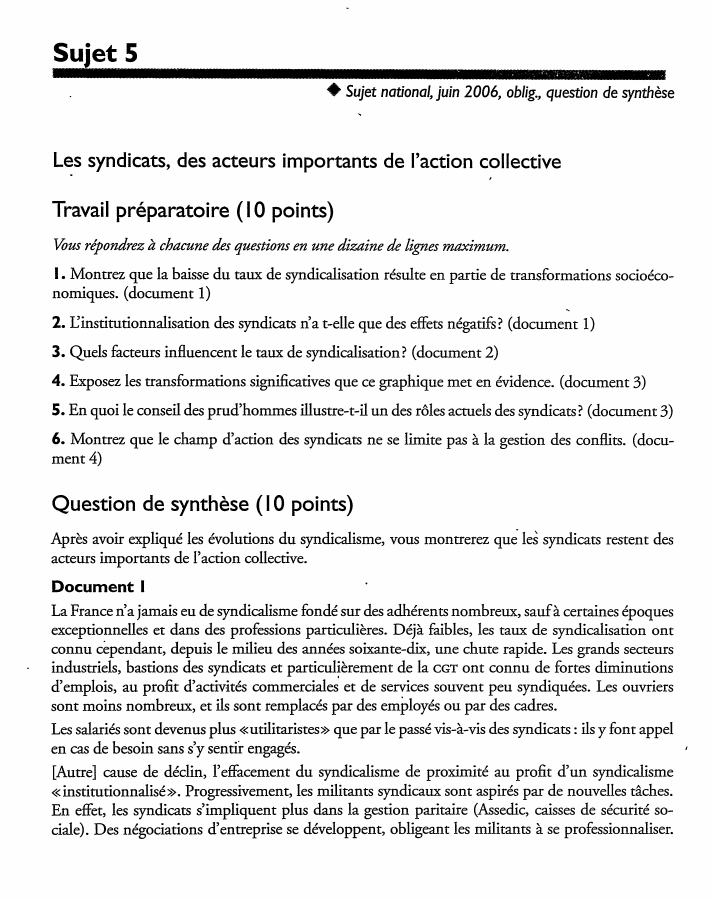Sujet S ♦ Sujet national, juin 2006, oblig., question de synthèse L~s syndicats, des acteurs importants de l'action collective Travail...
Extrait du document
«
Sujet S
♦ Sujet national, juin 2006, oblig., question de synthèse
L~s syndicats, des acteurs importants de l'action collective
Travail préparatoire ( 10 points)
Vous répondrez à chacune des questions en une dizaine de lignes maximum.
1.
Montrez que la baisse du taux de syndicalisation résulte en partie de transformations socioéconomiques.
(document 1)
2.
Linstitutionnalisation des syndicats n'a t-elle que des effets négatifs? (document 1)
3.
Quels facteurs influencent le taux de syndicalisation? (document 2)
4.
Exposez les transformations significatives que ce graphique met en évidence.
(document 3)
S.
En quoi le conseil des prud'hommes illustre+il un des rôles actuels des syndicats? (document 3)
6.
Montrez que le champ d'action des syndicats ne se limite pas à la gestion des conflits.
(document 4)
Question de synthèse ( 10 points)
Après avoir expliqué les évolutions du syndicalisme, vous montrerez que les syndicats restent des
acteurs importants de l'action collective.
Document 1
La France n'a jamais eu de syndicalisme fondé sur des adhérents nombreux, sauf à certaines époques
exceptionnelles et dans des professions particulières.
Déjà faibles, les taux de syndicalisation ont
connu cependant, depuis le milieu des années soixante-dix, une chute rapide.
Les grands secteurs
industriels, bastions des syndicats et particulièrement de la CGT ont connu de fortes diminutions
cl' emplois, au profit cl' activités commerciales' et de services souvent peu syndiquées.
Les ouvriers
sont moins nombreux, et ils sont remplacés par des employés ou par des cadres.
Les salariés sont devenus plus que par le passé vis-à-vis des syndicats : ils y font appel
en cas de besoin sans s'y sentir engagés.
[Autre] cause de déclin, l'effacement du syndicalisme de proximité au profit d'un syndicalisme
.
Progressivement, les militants syndicaux sont aspirés par de nouvelles tâches.
En effet, les syndicats s'impliquent plus dans la gestion paritaire (Assedic, caisses de sécurité sociale).
Des négociations d'entreprise se développent, obligeant les militants à se professionnaliser.
Dans certaines entreprises, seuls les élus sont encore syndiqués, et il ne leur est plus possible de
mener une action au quotidien, faute de relais à la base.
Source: Michel Cézard, Jean-Louis Dayan, Données sociales, « Les relations professionnelles en mutation>>, INSEE, 1999.
Document2
Syndicalisation et présence syndicale selon l'employeur, la taille de l'établissement et les conditions
d'emploi en France en 2003
En % des salariés
Taux de syndicalisation
Présence syndicale sur le lieu de
travail
État, collectivités locales,
hôpitaux publics
15,1
52,7
Entreprises publiques, Sécurité
sociale
15,6
70,7
Entreprises privées
5,2
31,2
Établissements de moins de
50 salariés
3,5
8,3
Établissements de 500 salariés et
plus
8,7
81,2
Salariés en contrat à durée
déterminée ou en intérim
2,4
23,2
Salariés en contrat à durée
indéterminée à temps complet
9,5
42,5
Ensemble des salariés
8,2
38,5
Source:
Premières synthèses, n°44 DARES, octobre 2004.
Lecture: en 2003, 52,7% des salariés de l'État, des collectivités locales ou des hôpitaux publics
déclarent qu'un syndicat est présent sur leur lieu de travail.
Document3
Résultats des élections prud'homales en% (collège des salariés)
80..------------------------+--Abstention
---CGT
.....,_CFDT
~FO
-::K-CFTC
--e---cGC
10
1979
1982
--1987
---Autres
1992
1997
2002
Source: D.
Andolfatto (sous la direction de), Les Syndicats en France, La Documentation française, 2004.
En % des inscrits pour l'abstention, en % des exprimés pour les syndicats.
Le conseil des prud'hommes traite des litiges individuels entre employeurs et salariés, les conseils prud'homaux qui jugent
ces litiges sont constimés à parité de représentants élus des organisations syndicales et patronales.
CGT: Confédération générale du travail.
CFDT : Confédération française démocratique du travail
FO : Force ouvrière
CFTC : Confédération française des travailleurs chrétiens
CGC : Confédération générale des cadres
Document4
Impliqué dans la cogestion des entreprises, le syndicalisme allemand est puissant et, à la différence de la plupart des syndicats européens, a connu une faible désyndicalisation au cours de la
dernière période.
Près de 40 % des salariés sont syndiqués et les syndicats allemands regroupaient
en 1993 environ 13 millions d'adhérents.
La cogestion est une pierre angulaire du système social.
Elle concerne les entreprises de plus de 500 salariés.
Salariés et organisations syndicales sont représentés, avec voix délibérative, au sein du conseil de surveillance des entreprises.
Ce dernier se
prononce sur les grandes orientations et désigne le directoire qui assure la conduite effective de
l'entreprise.
[...]Avec plus de 80 % d'adhérents, le taux de syndicalisation en Suède est un des plus
élevés du monde.
Le syndicalisme, outre ses fonctions revendicatives de base, la défense des intérêts
professionnels des salariés, assume la gestion des caisses de chômage en lieu et place de l'État.
Source: H.
Landier, D.
Labbé, Les organisations syndicales en France, Éd.
Liaisons, 2004.
Corrigé
Travail préparatoire
1.
Même si le syndicalisme français n'a jamais été un syndicalisme de masse, le taux de syndicalisation actuel atteint son niveau historique le plus bas avec environ 8 %.
Ce recul tient bien
sûr en partie à des facteurs socio-économiques nombreux tels que la désindustrialisation, la tertiarisation, la hausse du niveau des qualifications, le travail des femmes, la moyennisation de la
société, la montée de l'individualisme ou bien encore la précarisation de la population active.
Le
syndicalisme a ainsi perdu une large partie de son assise socioprofessionnelle avec la disparition des
bastions syndicaux qu'étaient la sidérurgie, la construction navale ou bien encore les mines.
Parallèlement, les nouvelles catégories issues de ces mutations structurelles ne se retrouvent pas dans des
organisations syndicales quis' étaient principalement construites autour des ouvriers de l'industrie,
et ces mêmes centrales syndicales ont du mal à se redéployer pour atteindre ces nouvelles catégories
d'actifs.
2.
L:institutionnalisation des syndicats et de leur action est souvent présentée comme un facteur
explicatif de la crise.
Il convient de rappeler la signification de ce terme qui désigne la structuration et la reconnaissance légale du syndicalisme, ce qui en fait une institution incontournable de la
régulation sociale.
Cette évolution présente évidemment des incidences positives à plusieurs titres.
D'une part, les syndicats siègent dans les instances représentatives de la vie économique et sociale
du pays et, en ce sens, rendent un service collectif incontestable (Sécurité sociale, prud'hommes ...
).
D'autre part, ils constituent des interlocuteurs compétents et expérimentés pour les pouvoirs publics et les entreprises lors des négociations.
Enfin, ils disposent de moyens matériels et humains
pour organiser et réguler les actions collectives.
3.
Le document 2 propose une étude comparative du taux de syndicalisation à travers la prise en
compte de trois critères.
Le premier est relatif au statut de l'employeur par une étude comparative du taux de syndicalisation dans le secteur public et le secteur privé.
Qu'il s'agisse des administrations publiques ou des
entreprises publiques, le taux de syndicalisation est trois fois plus élevé que dans les entreprises
privées: plus de 15 % contre 5,2 %.
Le second est relatif à la taille de l'établissement.
Il apparaît sans surprise que le taux de syndicalisation est d'autant plus élevé que la taille de l'établissement est importante.
Ainsi, le taux de
syndicalisation pour les établissements de moins de 50 salariés était de 3,5 % en 2003 contre 8,7 %
pour les établissements de 500 salariés et plus.
Si l'on considère la présence syndicale dans l'entreprise, l'écart est encore plus significatiE Les salariés des établissements d'au moins 500 salariés sont
dix fois plus nombreux à déclarer qu'un syndicat est présent sur leur lieu de travail.
Le dernier critère pris en compte, le contrat de travail, confirme une tendance bien connue selon
laquelle les salariés les moins syndiqués sont ceux dont le contrat de travail est le plus précaire.
Le
taux de syndicalisation des salariés sous contrat atypique de type CDD ou intérim est de 2,4 % au
lieu de 9,5 % pour les salariés en cm à temps complet.
4.
Ce document présente l'évolution des résultats aux élections prud'homales e~tre 1979 et 2002.
Il permet d'établir trois constats principaux.
:[;information la plus significative de ce document est la montée considérable de l'abstention
aux élections prud'homales.
Elle atteint pratiquement 70 % en 2002, alors qù elle nétait que
de 38 % en 1979.
Cela atteste du désintérêt des salariés pour cette institution essentielle et de
l'incapacité des syndicats à mobiliser sur ce sujet Cela remet également fortement en cause la
représentativité des syndicats.
La seconde information est la perte d'influence de la CGT (Confédération générale du travail) pour
ces élections.
En effet, la plus ancienne centrale syndicale française voit ses suffrages passer de 43 %
en 1979 à 32 % en 2002.
Ses rivales les plus directes, que sont la CFDT (Confédération française
démocratique du travail) et FO (Force ouvrière), voient leur audience globalement se maintenir
pour ces élections avec un résultat respectif de 25 % et 19 %.
La dernière information est la relative progression des syndicats, qui correspond à l' apparition de nouvelles organisations.
Ce dernier point peut apparaître comme le signe à la fois de
tensions internes aux centrales à l'origine de scissions et comme l'expression d'une dispersion de
l'audience syndicale.
S.
Le rôle joué par les syndicats dans le cadre des conseils de prud'hommes illustre l'institutionnalisation de leur rôle à travers la participation à des organismes paritaires, ce qui en fait de plus
en plus des gestionnaires du social.
:raction des représentants syndicaux dans le cadre des conseils
de prud'hommes vient également illustrer une individualisation de l'action syndicale alors que son
champ d'action initial portait essentiellement sur la défense collective des salariés.
6.
Même si on associe traditionnellement l'action syndicale à la gestion des conflits, leur fonction
principale aujourd'hui se trouve dans le domaine plus large de la régulation sociale, avec une implication de plus en plus significative dans des institutions représentatives des salariés et gestionnaires
du social.
En France, les exemples les plus explicites sont la participation au système de protection
sociale dans le cadre d'une gestion paritaire de la Sécurité sociale à travers l'assurance chômage,
l'assurance vieillesse ou bien encore l'assurance maladie.
Au sein des entreprises, les syndicats ont
également, et dans une certaine mesure, un rôle de cogestion avec leur participation en tant qu'élus
à des instances représentatives telles que les comités d'entreprise.
Bien que présent en France, ce
rôle n'est pas aussi développé qù en Allemagne où les syndicats sont pleinement cogestionnaires du
système social ou en Suède où les syndicats assument l'ensemble de la gestion des caisses d' assurance chômage.
Question de synthèse
Introduction
Alors que depuis la ni° république, qui régularise les syndicats avec la loi Waldeck Rousseau de
1884, leur rôle en tant qu'acteur central de l'action collective n'avait cessé de se développer, les
deux dernières décennies semblent marquées par une crise du syndicalisme.
Cette lecture de l'évolution du syndicalisme, cest-à-dire d'organisations dont la finalité est de
défendre les droits et les intérêts professionnels des catégories sociales qu'elles représentent, ne
paraît pas apporter une analyse complète de la situation.
Pour véritablement apprécier l'évolution
du syndicalisme, il faut non seulement apprécier l'audience syndicale mais également considérer
son rôle en matière de gestion du social dans une acception plus large.
Ainsi, nous nous demanderons au-delà de l'évolution du syndicalisme et de ses facteurs explicatifs
en quoi....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓