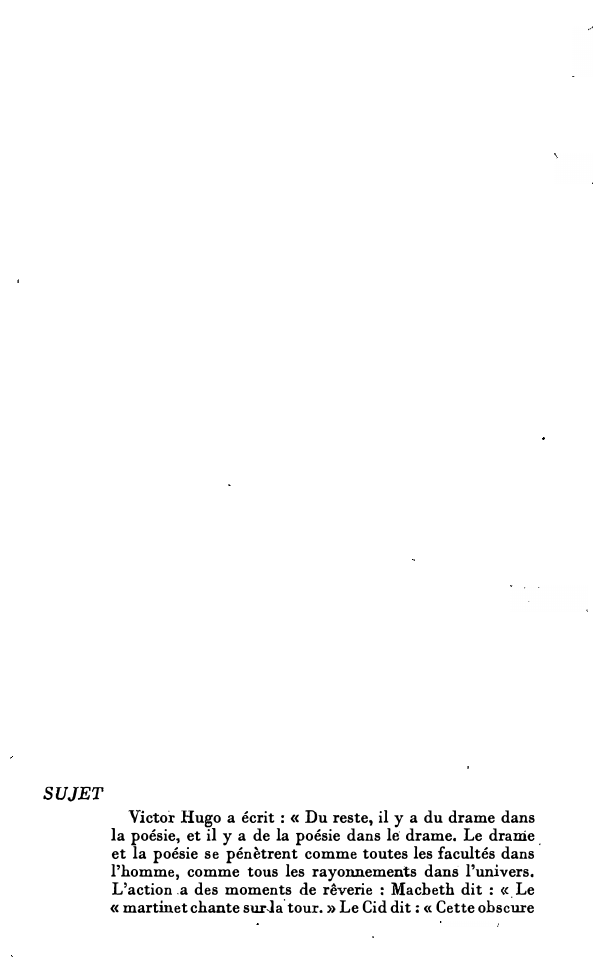SUJET Victor Hugo a écrit : « Du reste, il y a du drame dans la poésie, et il y...
Extrait du document
«
SUJET
Victor Hugo a écrit : « Du reste, il y a du drame dans
la poésie, et il y a de la poésie dans le drame.
Le drame .
et la poésie se pénètrent comme toutes les facultés dans
l'homme, comme tous les rayonnements dans l'univers.
L'action .a des moments de rêverie : Macbeth dit : « Le
« martinet chante surJa'tour.
» Le Cid dit:« Cette ohsc�e
« clarté qui tombe des étoiles.» Scapin dit : « Le ciel s'est
« déguisé ce soir en Scaramouche.
» Nul ne se dérobé
dans ce monde au ciel bleu, aux arbres verts, à la nuit
sombre, au bruit du vent, au chant des oiseaux.
Aucune
créature ne peut s'abstraire de la création.
« De son côté;la rêverie a des minutes d'action.
L'idylle
à Gal!us est pathétique comme un Ve acte, le IVe livre
de l'Enéide est une tragédie, il y a une ode d'Horace
qui est devenue une comédie de Molière.
Donec gratus
eram tibi, .c'est Le Dépit amoureux » (Les Rayons et les
Ombres, Préface, 1840).
Étudier, avec quelques exemples précis, ces rapports
de la poésie et du drame.
(C.A.
Jeunes Filles, Lettres 1947.)
RÉFLEXIONS PRÉLIMINAIRES
1.
Le texte a cc de l'allure», il est plein d'idées intéressantes, mais Hugo
ne s'est sans doute guère soucié de leur portée exacte dans l'histoire
littéraire et ses exemples semblent fort discutables.
Il faudra donc
tenir compte de ces derniers, mais les discuter soigneusement, sinon
dans la copie, du moins da,is la préparation du de1,1oir; ainsi l'exemple
de Scapin n'est pas bien con1,1aincant : il s'agit d'une réflexion jetée
en passant et elle contribue simplement à la manière un peu fantaic
siste de Comédie italienne qui caractérise les Fourberies; de même,
parler de rê1,1erie à propos du 1,1ers du Cid : cc Cette obscure clarté qui tombe
des étoiles» est nettement abusif (Rodrigue, loin de rê1,1er, fait au roi
un récit de combat et le détail a surtout une 1,1aleur stratégique).
Enfin
il est arbitraire de considérer le JVe chant de l'Énéide comme un
li1,1re particulièrement tragique (c'est plutôt un épisode romanesque, à la
manière alexandrine, au sein d'une épopée classique).
2.
A1algré toùt, on fera très attention au texte de Hugo, 1'iche d'aYenues
di1,1erses.
D'abord une voie essentielle : le théâtre, étant le monde
ramené à l'unité, est éminemment lyrique par sa nature même; donc
,ous les genres qui ramènent le monde à l'unité sont à la fois lyriques
et dramatiques (idée féconde qui est à la base de toute la dramaturgie
de Wagner).
Ensuite, des voies secondaires :
a) une idée dramatique intéressante : au théâtre, quand l'action s'arrête,
il y a place pour le lyrisme (nombreuses confirmations historiques);
b) irwersement, de la rê1,1erie sort soupent l'action.
Ici les conceptions
de Hugo paraissent un peu confuses et les èxemples qu'il donne ne
sont pas de nature à les éclairer; il 1,1eut dire probablemeTJ,t que des
poèmes lyriques peu1,1ent facilement fournir le sujet de pièces de théâtre,
ce qui semble juste, mais n'est pas très riche de conséquences.
Pour
nous, il sera intéressant de dépasser cette idée pour remarquer que le
lyrisme a une tendance interne qui le pousse au théâtre (Yoi1· notam
ment dans l'Antiquité la lyrique chorale engendrant la tragédie).
3.
Pour simplifier le 'débat et malgré l'exemple de l'Énéide, nous rai
sonnerons exclusif)ement sur Ili.poésie lyrique.
Si l'on !)eut s 1 engager
dans les rapports de la poésie didactique, épique, etc ...
açec l� théâtre,
on n'en sortira jamais.
De même, nous ne chercherons pas trop
à préciser le sens du mot drame.
Les exemples de Hugo sont tirés de ·
Shakespeare, Corneille, Molière : par drame, il entend tout simple
ment le genre théâtral.
Nous ne traiterons pas directement le sujet donné au C.
A., mais
nous proposerons quelques éléments pour un parallèle' entre le lyrisme
et le drame.
ÉLÉMENTS POUR UN PARALLP:LE ENTRE LE LYRISME
ET LE DRAME
I.
Historiquement, le parallèle s'impose.
A.
Dans l'Antiquité grecque, le théâtre sort de la grande lyrique
chorale.
Mécanisme de transformation : la lyrique grecque com
porte un récitant qui raconte les aventures du héros et un chœur
qui dit son admiration.
Du jour où l'on met deux, puis trois
récitants qui dialoguent devant le chœur, le théâtre est né.
Ce· théâtre reste longtemps lyrique : en effet le chqmr continue
à exister, il apprécie l'aventure des héros, e_n tire la leçon religieuse
·et morale.
Pour cela, il use toujours des formes lyriques (strophes,
antistrophes, épodes).
L'action est menée d'�une façon qui con-·
firme tout à fait la thèse de Hugo, par alternance d'épisodes
(dialogues et action) et, dans les temps d'arrêt, de stasima, c'est
à-dire de pauses, réservées au lyrisme choral.
On peut clone hien
dire : t< L'action a des moments de rêverie.
J>
'.13.
• Dans p.otre littérature.
:L.
Au Moyen Age, les rapports sont un peu moins nets, mais pourtant
on peut les déceler :
u)....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓