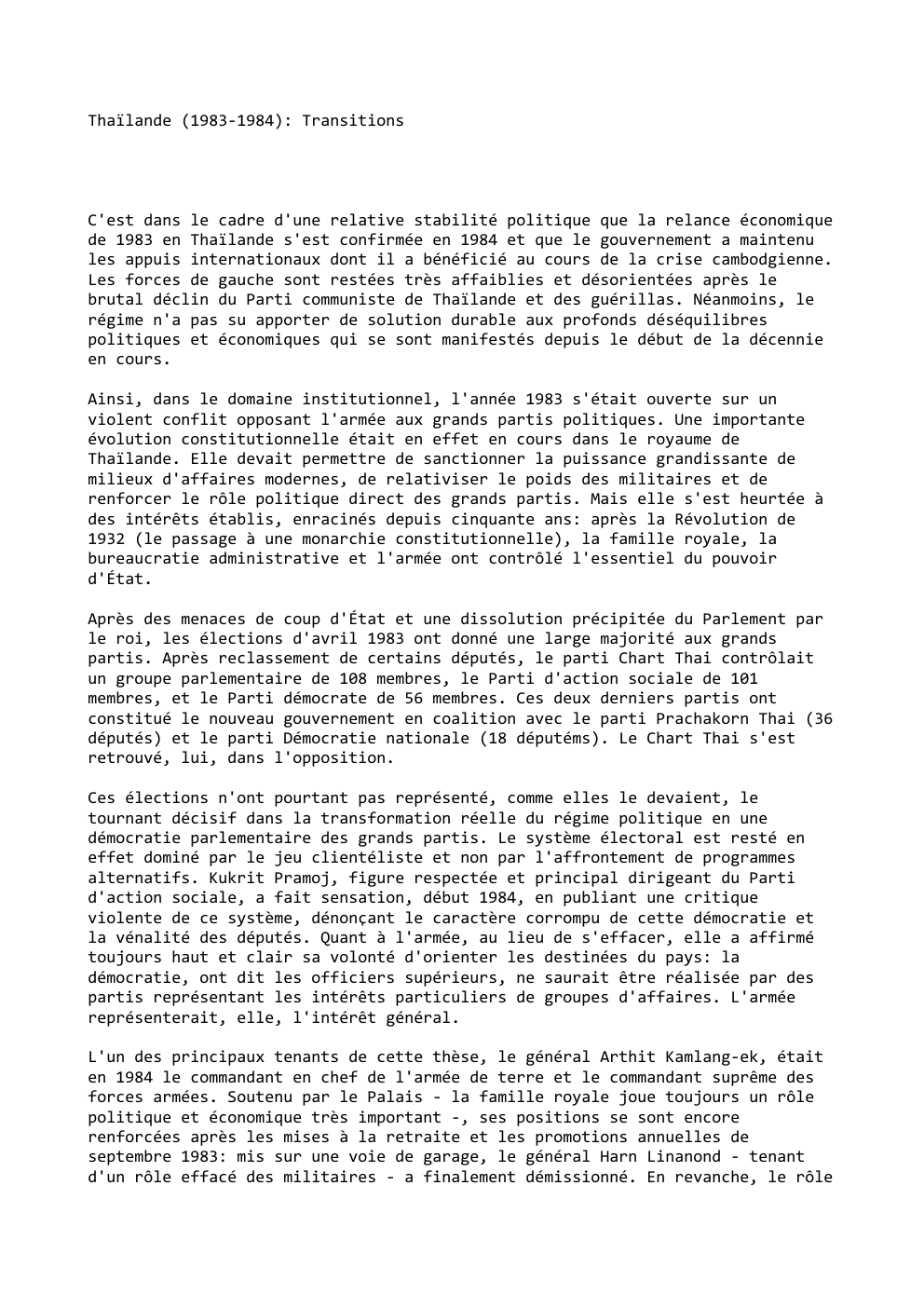Thaïlande (1983-1984): Transitions C'est dans le cadre d'une relative stabilité politique que la relance économique de 1983 en Thaïlande s'est...
Extrait du document
«
Thaïlande (1983-1984): Transitions
C'est dans le cadre d'une relative stabilité politique que la relance économique
de 1983 en Thaïlande s'est confirmée en 1984 et que le gouvernement a maintenu
les appuis internationaux dont il a bénéficié au cours de la crise cambodgienne.
Les forces de gauche sont restées très affaiblies et désorientées après le
brutal déclin du Parti communiste de Thaïlande et des guérillas.
Néanmoins, le
régime n'a pas su apporter de solution durable aux profonds déséquilibres
politiques et économiques qui se sont manifestés depuis le début de la décennie
en cours.
Ainsi, dans le domaine institutionnel, l'année 1983 s'était ouverte sur un
violent conflit opposant l'armée aux grands partis politiques.
Une importante
évolution constitutionnelle était en effet en cours dans le royaume de
Thaïlande.
Elle devait permettre de sanctionner la puissance grandissante de
milieux d'affaires modernes, de relativiser le poids des militaires et de
renforcer le rôle politique direct des grands partis.
Mais elle s'est heurtée à
des intérêts établis, enracinés depuis cinquante ans: après la Révolution de
1932 (le passage à une monarchie constitutionnelle), la famille royale, la
bureaucratie administrative et l'armée ont contrôlé l'essentiel du pouvoir
d'État.
Après des menaces de coup d'État et une dissolution précipitée du Parlement par
le roi, les élections d'avril 1983 ont donné une large majorité aux grands
partis.
Après reclassement de certains députés, le parti Chart Thai contrôlait
un groupe parlementaire de 108 membres, le Parti d'action sociale de 101
membres, et le Parti démocrate de 56 membres.
Ces deux derniers partis ont
constitué le nouveau gouvernement en coalition avec le parti Prachakorn Thai (36
députés) et le parti Démocratie nationale (18 députéms).
Le Chart Thai s'est
retrouvé, lui, dans l'opposition.
Ces élections n'ont pourtant pas représenté, comme elles le devaient, le
tournant décisif dans la transformation réelle du régime politique en une
démocratie parlementaire des grands partis.
Le système électoral est resté en
effet dominé par le jeu clientéliste et non par l'affrontement de programmes
alternatifs.
Kukrit Pramoj, figure respectée et principal dirigeant du Parti
d'action sociale, a fait sensation, début 1984, en publiant une critique
violente de ce système, dénonçant le caractère corrompu de cette démocratie et
la vénalité des députés.
Quant à l'armée, au lieu de s'effacer, elle a affirmé
toujours haut et clair sa volonté d'orienter les destinées du pays: la
démocratie, ont dit les officiers supérieurs, ne saurait être réalisée par des
partis représentant les intérêts particuliers de groupes d'affaires.
L'armée
représenterait, elle, l'intérêt général.
L'un des principaux tenants de cette thèse, le général Arthit Kamlang-ek, était
en 1984 le commandant en chef de l'armée de terre et le commandant suprême des
forces armées.
Soutenu par le Palais - la famille royale joue toujours un rôle
politique et économique très important -, ses positions se sont encore
renforcées après les mises à la retraite et les promotions annuelles de
septembre 1983: mis sur une voie de garage, le général Harn Linanond - tenant
d'un rôle effacé des militaires - a finalement démissionné.
En revanche, le rôle
du général Chaovalit Yongchaiyut - idéologue de la "responsabilité" sociale et
politique des militaires -, et du général Pichit Kullavanich - chef de la région
militaire de Bangkok, la capitale - a été confirmé.
Si les grands partis détenaient en 1984 la majorité des portefeuilles
gouvernementaux, le général Prem Tinsulanond restait Premier ministre et le roi
Bhumibol Adulayadej (Rama IX) chef de l'État.
Dans ces conditions, il semblait
très probable que le conflit institutionnel - "démocratie affairiste" des partis
ou "démocratie musclée" des militaires - rebondisse à l'avenir.
Malgré une
relative stabilité politique, le pays connaît en effet une réelle instabilité
constitutionnelle.
Le rôle des grands partis liés aux milieux d'affaires et celui de l'armée se
sont renforcés à l'occasion de la crise profonde qui a déchiré le Parti
communiste de Thaïlande.
En l'absence de perspectives révolutionnaires, des
formations comme le Parti d'action sociale de Kukrit Pramoj et le parti
Démocrate nationale de l'ancien Premier ministre Kriangsak Chonanan peuvent
incarner l'aspiration aux réformes politiques.
Par contre, l'état-major a pu se
prévaloir du succès de sa politique de contre-insurrection.
Surtout, l'influence
de fractions militaires s'est renforcée jusqu'au sein du mouvement ouvrier
lui-même.
Ce problème est aujourd'hui au coeur de la division syndicale et
notamment de la scission qui a frappé la principale confédération, le Labor
Congress of Thaïland (LCT).
L'année 1983 a confirmé un autre trait de la situation politique en Thaïlande.
Le régime s'est affirmé plus démocratique que souvent dans le passé.
Mais, grâce
au recul des guérillas et à la désorganisation du mouvement de masse (il n'y a....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓