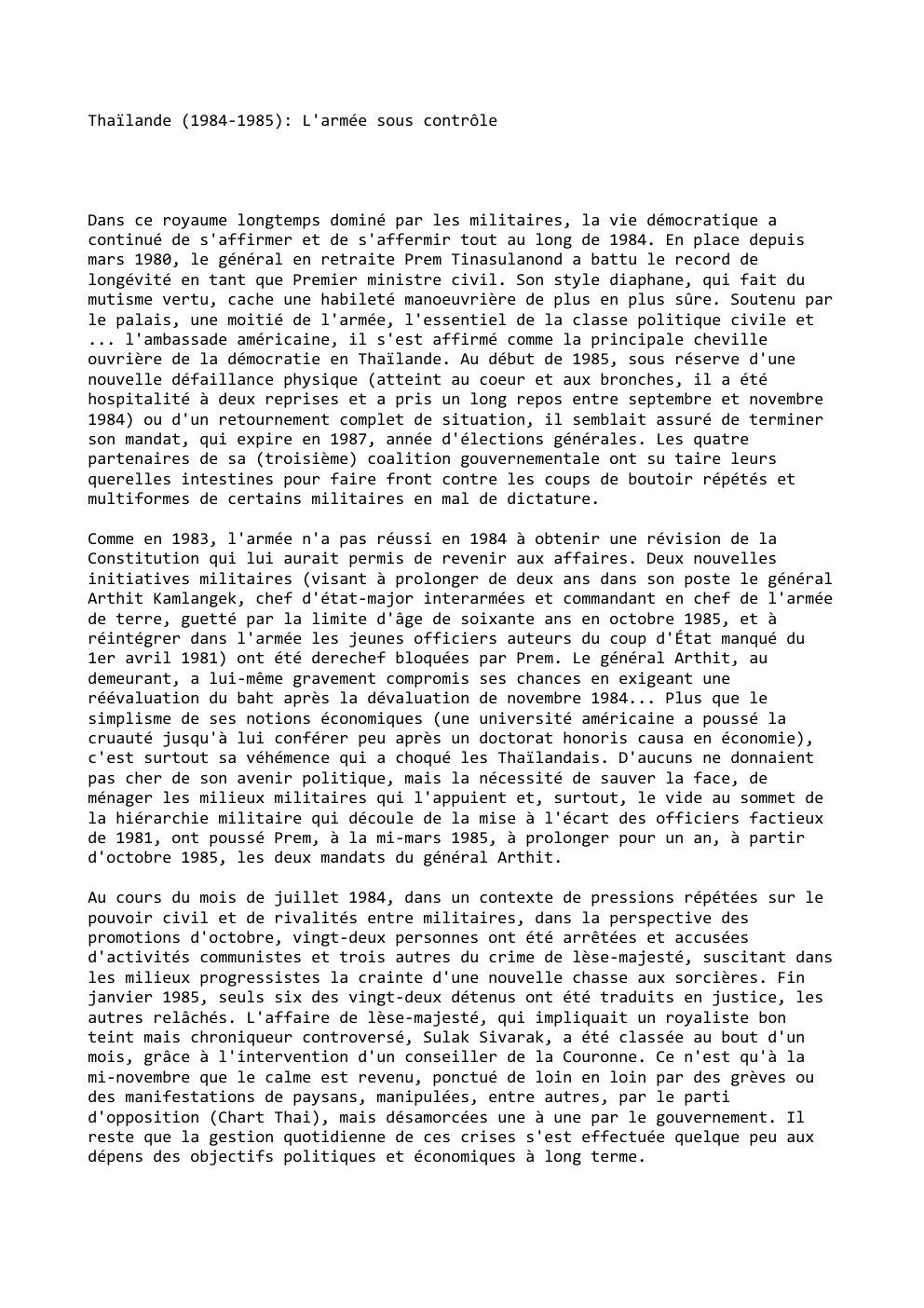Thaïlande (1984-1985): L'armée sous contrôle Dans ce royaume longtemps dominé par les militaires, la vie démocratique a continué de s'affirmer...
Extrait du document
«
Thaïlande (1984-1985): L'armée sous contrôle
Dans ce royaume longtemps dominé par les militaires, la vie démocratique a
continué de s'affirmer et de s'affermir tout au long de 1984.
En place depuis
mars 1980, le général en retraite Prem Tinasulanond a battu le record de
longévité en tant que Premier ministre civil.
Son style diaphane, qui fait du
mutisme vertu, cache une habileté manoeuvrière de plus en plus sûre.
Soutenu par
le palais, une moitié de l'armée, l'essentiel de la classe politique civile et
...
l'ambassade américaine, il s'est affirmé comme la principale cheville
ouvrière de la démocratie en Thaïlande.
Au début de 1985, sous réserve d'une
nouvelle défaillance physique (atteint au coeur et aux bronches, il a été
hospitalité à deux reprises et a pris un long repos entre septembre et novembre
1984) ou d'un retournement complet de situation, il semblait assuré de terminer
son mandat, qui expire en 1987, année d'élections générales.
Les quatre
partenaires de sa (troisième) coalition gouvernementale ont su taire leurs
querelles intestines pour faire front contre les coups de boutoir répétés et
multiformes de certains militaires en mal de dictature.
Comme en 1983, l'armée n'a pas réussi en 1984 à obtenir une révision de la
Constitution qui lui aurait permis de revenir aux affaires.
Deux nouvelles
initiatives militaires (visant à prolonger de deux ans dans son poste le général
Arthit Kamlangek, chef d'état-major interarmées et commandant en chef de l'armée
de terre, guetté par la limite d'âge de soixante ans en octobre 1985, et à
réintégrer dans l'armée les jeunes officiers auteurs du coup d'État manqué du
1er avril 1981) ont été derechef bloquées par Prem.
Le général Arthit, au
demeurant, a lui-même gravement compromis ses chances en exigeant une
réévaluation du baht après la dévaluation de novembre 1984...
Plus que le
simplisme de ses notions économiques (une université américaine a poussé la
cruauté jusqu'à lui conférer peu après un doctorat honoris causa en économie),
c'est surtout sa véhémence qui a choqué les Thaïlandais.
D'aucuns ne donnaient
pas cher de son avenir politique, mais la nécessité de sauver la face, de
ménager les milieux militaires qui l'appuient et, surtout, le vide au sommet de
la hiérarchie militaire qui découle de la mise à l'écart des officiers factieux
de 1981, ont poussé Prem, à la mi-mars 1985, à prolonger pour un an, à partir
d'octobre 1985, les deux mandats du général Arthit.
Au cours du mois de juillet 1984, dans un contexte de pressions répétées sur le
pouvoir civil et de rivalités entre militaires, dans la perspective des
promotions d'octobre, vingt-deux personnes ont été arrêtées et accusées
d'activités communistes et trois autres du crime de lèse-majesté, suscitant dans
les milieux progressistes la crainte d'une nouvelle chasse aux sorcières.
Fin
janvier 1985, seuls six des vingt-deux détenus ont été traduits en justice, les
autres relâchés.
L'affaire de lèse-majesté, qui impliquait un royaliste bon
teint mais chroniqueur controversé, Sulak Sivarak, a été classée au bout d'un
mois, grâce à l'intervention d'un conseiller de la Couronne.
Ce n'est qu'à la
mi-novembre que le calme est revenu, ponctué de loin en loin par des grèves ou
des manifestations de paysans, manipulées, entre autres, par le parti
d'opposition (Chart Thai), mais désamorcées une à une par le gouvernement.
Il
reste que la gestion quotidienne de ces crises s'est effectuée quelque peu aux
dépens des objectifs politiques et économiques à long terme.
En politique extérieure, l'année 1984 a été marquée par l'accession de la
Thaïlande fin octobre au Conseil de sécurité des Nations Unies (elle a été
préférée à la Mongolie), par une diversification de son activité diplomatique
globale, par un regain de tension avec le Laos (à la suite de l'invasion en juin
et de l'occupation par l'armée thaïlandaise de trois villages frontaliers dans
l'Ouest laotien) et par la saga de la frontière cambodgienne: offensives
viêtnamiennes d'avril et, à nouveau, de novembre 1984 à mars 1985.
Cette
dernière s'est traduite pour la Thaïlande par l'accueil plus ou moins volontaire
et assurément provisoire de quelque 230 000 réfugiés cambodgiens dans des camps
de fortune de l'intérieur.
En mai 1985, Bangkok annonçait son intention de
renvoyer ces réfugiés dans leur pays.
Au nom des impératifs de sécurité, l'abcès cambodgien continue de légitimer (dès....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓