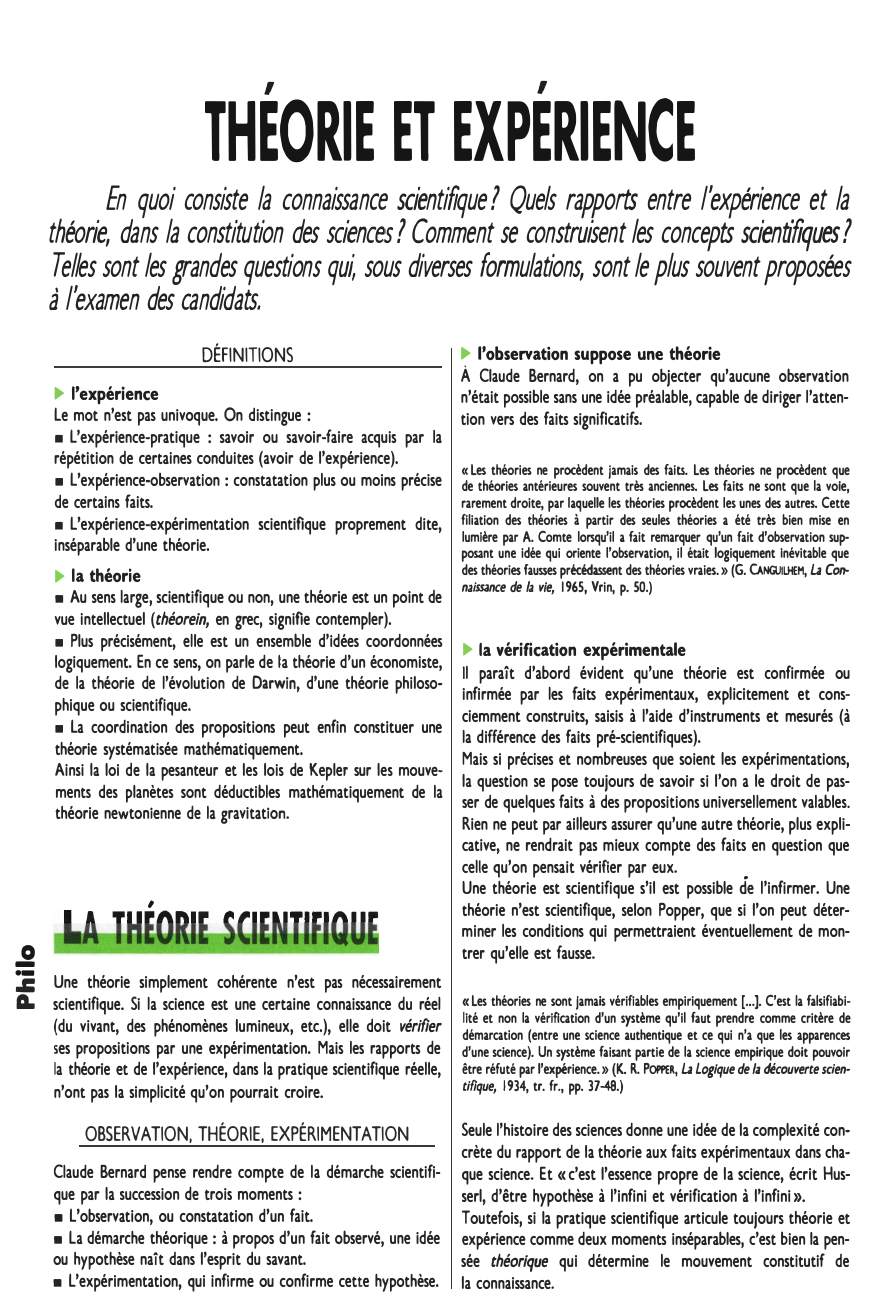, , THEORIE ET EXPERIENCE En quoi consiste la connaissance scientifique? Quels rapports entre l'expérience et la théorie, dans la...
Extrait du document
«
,
,
THEORIE ET EXPERIENCE
En quoi consiste la connaissance scientifique? Quels rapports entre l'expérience et la
théorie, dans la constitution des sciences? Comment se construisent les concepts scientifiques?
Telles sont les grandes questions qui, sous diverses formulations, sont le plus souvent proposées
à l'examen des candidats.
DÉFINITIONS
► l'expérience
Le mot n'est pas univoque.
On distingue :
■ L'expérience-pratique : savoir ou savoir-faire acquis par la
répétition de certaines conduites (avoir de l'expérience).
■ L'expérience-observation : constatation plus ou moins précise
de certains faits.
■ L'expérience-expérimentation scientifique proprement dite,
inséparable d'une théorie.
► la théorie
Au sens large, scientifique ou non, une théorie est un point de
vue intellectuel (théorein, en grec, signifie contempler).
■ Plus précisément, elle est un ensemble d'idées coordonnées
logiquement.
En ce sens, on parle de la théorie d'un économiste,
de la théorie de l'évolution de Darwin, d'une théorie philoso
phique ou scientifique.
■ La coordination des propositions peut enfin constituer une
théorie systématisée mathématiquement.
Ainsi la loi de la pesanteur et les lois de Kepler sur les mouve
ments des planètes sont déductibles mathématiquement de la
théorie newtonienne de la gravitation.
■
-.c
,
0
Une théorie simplement cohérente n'est pas nécessairement
A.
scientifique.
Si la science est une certaine connaissance du réel
(du vivant, des phénomènes lumineux, etc.), elle doit vérifier
ses propositions par une expérimentation.
Mais les rapports de
la théorie et de l'expérience, dans la pratique scientifique réelle,
n'ont pas la simplicité qu'on pourrait croire.
OBSERVATION, THÉORIE, EXPÉRIMENTATION
Claude Bernard pense rendre compte de la démarche scientifi
que par la succession de trois moments :
■ L'observation, ou constatation d'un fait.
■ La démarche théorique : à propos d'un fait observé, une idée
ou hypothèse naît dans l'esprit du savant.
■ L'expérimentation, qui infirme ou confirme cette hypothèse.
► l'observation suppose une théorie
À Claude Bernard, on a pu objecter qu'aucune observation
n'était possible sans une idée préalable, capable de diriger l'atten
tion vers des faits significatifs.
« Les théories ne procèdent jamais des faits.
Les théories ne procèdent que
de théories antérieures souvent très anciennes.
Les faits ne sont que la vole,
rarement droite, par laquelle les théories procèdent les unes des autres.
Cette
filiation des théories à partir des seules théories a été très bien mise en
lumière par A.
Comte lorsqu'il a fait remarquer qu'un fait d'observation sup
posant une idée qui oriente l'observation, il était logiquement Inévitable que
des théories fausses précédassent des théories vraies.» (G.
CANGulLHEH, u Con
naissance de la vie, 1965, Vrin, p.
50.)
► la vérification expérimentale
Il paraît d'abord évident qu'une théorie est confirmée ou
infirmée par les faits expérimentaux, explicitement et cons
ciemment construits, saisis à l'aide d'instruments et mesurés (à
la différence des faits pré-scientifiques).
Mais si précises et nombreuses que soient les expérimentations,
la question se pose toujours de savoir si l'on a le droit de pas
ser de quelques faits à des propositions universellement valables.
Rien ne peut par ailleurs assurer qu'une autre théorie, plus expli
cative, ne rendrait pas mieux compte des faits en question que
celle qu'on pensait vérifier par eux.
Une théorie est scientifique s'il est possible de l'infirmer.
Une
théorie n'est scientifique, selon Popper, que si l'on peut déter
miner les conditions qui permettraient éventuellement de mon
trer qu'elle est fausse.
« Les théories ne sont jamais vérifiables empiriquement [...].
C'est la falsifiabi
lité et non la vériflcation d'un système qu'il faut prendre comme critère de
démarcation (entre une science authentique et ce qui n'a que les apparences
d'une science).
Un système faisant partie de la science empirique doit pouvoir
être réfuté par l'expérience.» (K.
R.
POPPER, u logique de la découverte scien
tifique, 1934, tr.
fr., pp.
37-48.)
Seule l'histoire des sciences donne une idée de la complexité con
crète du rapport de la théorie aux faits expérimentaux dans cha
que science.
Et « c'est l'essence propre de la science, écrit Hus
serl, d'être hypothèse à l'infini et vérification à l'infini».
Toutefois, si la pratique scientifique articule toujours théorie et
expérience comme deux moments inséparables, c'est bien la pen
sée théorique qui détermine le mouvement constitutif de
la connaissance.
« L'expérimentation, et même la simple observation,
sont des théories en acte.
Un objet scientifique (le
soleil, l'atome de carbone) est une théorie cristal
lisée; un instrument d'expérience, ce type particulier
d'objet scientifique, est "une pensée construite, une
pensée en partie réalisée par la technique".» (Bache
lard in J.
ULLMO, La Pensée scientifique moderne,
1969, Flammarion, p.
97.)
► « la raison doit prendre les devants» (Kant)
Réfléchissant sur l'essor des sciences expérimentales, Kant en
dégage le trait essentiel.
Depuis Galilée, les faits sont -deve
nus intelligibles parce que la raison les organise, les structure
selon ses propres exigences.
On ne comprendrait pas, sans cela,
l'accord des structures mathématiques, construites par l'esprit,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓