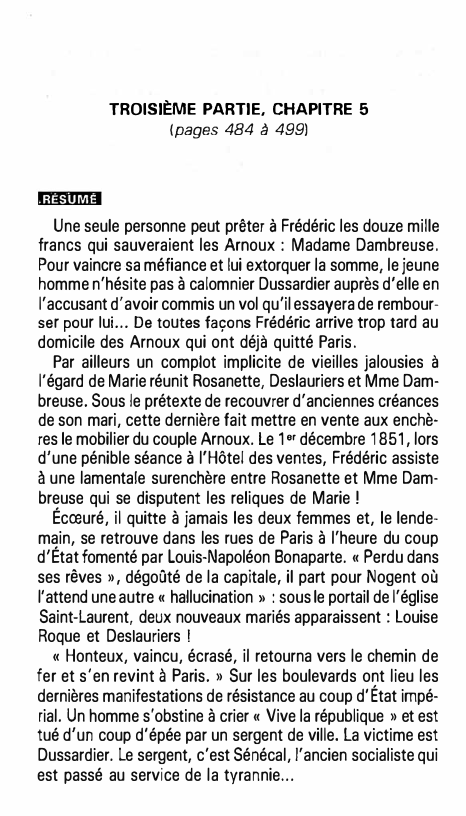TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE 5 (pages 484 à 499) l;Utiil©l:I Une seule personne peut prêter à Frédéric les douze mille francs...
Extrait du document
«
TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE 5
(pages 484 à 499)
l;Utiil©l:I
Une seule personne peut prêter à Frédéric les douze mille
francs qui sauveraient les Arnoux : Madame Dambreuse.
Pour vaincre-sa méfiance et lui extorquer la somme, le jeune
homme n'hésite pas à calomnier Dussardier auprès d'elle en
l'accusant d'avoir commis un vol qu'il essayera de rembour
ser pour lui.
..
De toutes façons Frédéric arrive trop tard au
domicile des Arnoux qui ont déjà quitté Paris.
Par ailleurs un complot implicite de vieilles jalousies à
l'égard de Marie réunit Rosanette, Deslauriers et Mme Dam
breuse.
Sous le prétexte de recouvrer d'anciennes créances
de son mari, cette dernière fait mettre en vente aux enchè·
res le mobilier du couple Arnoux.
Le 1e, décembre 1851, lors
d'une pénible séance à l'Hôtel des ventes, Frédéric assiste
à une lamentale surenchère entre Rosanette et Mme Dam
breuse qui se disputent les reliques de Marie !
Écœuré, il quitte à jamais les deux femmes et, le lende
main, se retrouve dans les rues de Paris à l'heure du coup
d'État fomenté par Louis-Napoléon Bonaparte.« Perdu dans
ses rêves », dégoûté de la capitale, il part pour Nogent où
l'attend une autre« hallucination » : sous le portail de l'église
Saint-Laurent, deux nouveaux mariés apparaissent : Louise
Roque et Deslauriers !
« Honteux, vaincu, écrasé, il retourna vers le chemin de
fer et s'en revint à Paris.
» Sur les boulevards ont lieu les
dernières manifestations de résistance au coup d'État impé
rial.
Un homme s'obstine à crier« Vive la république » et est
tué d'un coup d'épée par un sergent de ville.
La victime est
Dussardier.
Le sergent, c'est Sénécal, l'ancien socialiste qui
est passé au service de la tyrannie...
COMMENTAIRE DÉTAI LLE
cc Une extrême fatigue »
Au fil des trois derniers chapitres du roman, pourtant très courts,
le rythme des événements et de l'histoire va s'accélérer spectaculairement.
l'ouverture du chapitre 5 témoigne de cette accélération en
aggravant la thématique de la dégénérescence et du pourrissement
initiée dans la séquence précédente.
Après sa course désespérée à la
poursuite du couple Arnoux, Frédéric« se sentait tout délabré, écrasé,
anéanti ...
» (p.
487).
En face de la « chose hideuse» qu'est devenue
la dépouille de son fils sous le pinceau de Pellerincomme sous le regard
de Flaubert (« le petit mort était méconnaissable •l.
le jeune homme
apparaît de plus en plus - à l'inverse des modèles balzaciens - comme
une force qui se défait, comme un anti-héros dont toutes les énergies
et ambitions fondent dans la débâcle d' « une extrême fatigue ».
Puisque son « éducation », ou du moins l'itinéraire paradoxal que
cache ce concept ironique, n'a été que« sentimentale », il lui faut maintenant se défaire des trois femmes (Rosanette, Mme Dambreuse et
Louise) qui ont, chacune à son tour et à sa manière, fait écran à celle
à qui « il pensait» encore, comme « un véritable époux», devant le
cadavre de l'enfant: Mme Arnoux.
Les dix pages qui suivent décrivent cette triple épreuve de dépouillement et de renoncement.
Adieu Rosanette ...
Le quiproquo, né de l'origine obscure de la mise en vente des biens
Arnoux (p.
490), est aussi la cause de la scène de ménage qui consomme la rupture emre Frédéric et Rosanette (pp.
491-492!.
Une rupture entièrement évoquée par le romancier sur un mode stylistique qui ne lui est pas le plus familier : un dialogue au style direct,
d'une authenticité exceptionnelle.
Outre cette justesse du ton, où s'affrontent cruauté, amertume et
jalousie, on relèvera l'intensité fulgurante des deux aveux qui rendent
pathétique cette scène par la juxtaposition de deux vérités psychologiques et romanesques désormais irréconciliables : « Je n'ai jamaisaimé
qu'elle 1•.
dit Frédéric;« C'est absurde ! Je t'aime 1», répond Rosanette.
Plus que le quiproquo de circonstance, nous touchons là au quiproquo fondamental : la fatalité de l'unique et impossible amour de
Frédéric en face de l'entêtement sincère de l'affection de celle qui lui
a donné un fils.
En l'abandonnant, lejeune homme apparaît aussi injuste
dans sa conduite de personnage, de « caractère », que terriblement
juste dans l'achèvement de la passion contrariée dont Flaubert l'a fait
le« symbole».
En tout cas; dans ce roman entièrement tissé d'allers et retours, géographiques et sentimentaux, le cycle des navettes et des va-et-vient
est réellement brisé : « Oh ! oh ! tu me reviendras ! - Jamais de la
vie 1» (p.
492).
Adieu Madame Dambreuse ...
Seulement présente dans cette première scène par son nom et plus
encore par le pronom (« elle »l qui la désigne, Marie Arnoux, dans l'épisode qui suit de !'Hôtel des ventes, voit sa tierce présence augmentée
encore du spectacle des objets et vêtements qui furent les siens : « On
exhiba les meubles de la chambre à coucher [...J C'était comme des
parties de son cœur qui s'en allaient avec ces choses ...
»(p.
494).....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓