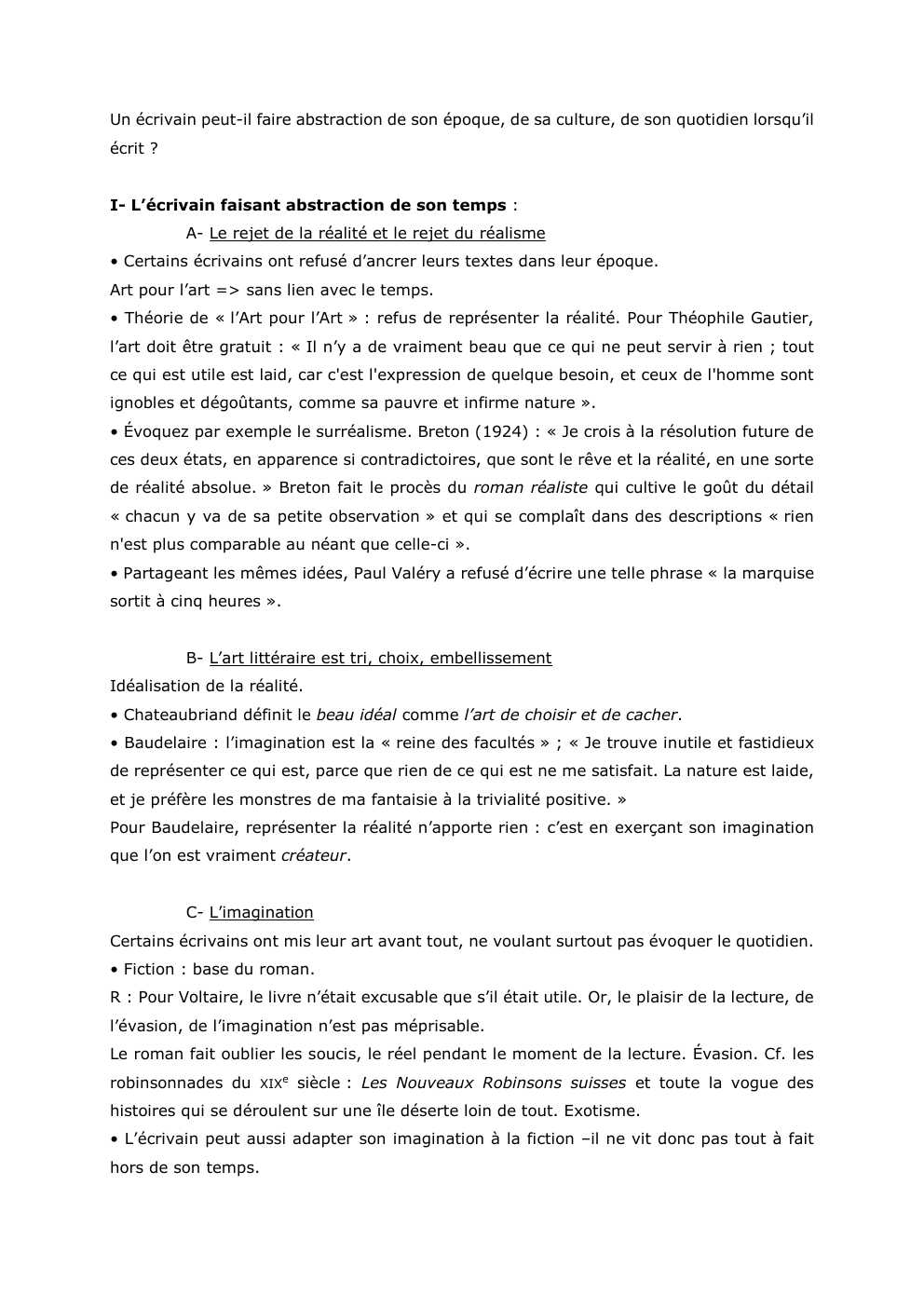Un écrivain peut-il faire abstraction de son époque, de sa culture, de son quotidien lorsqu’il écrit ? I- L’écrivain faisant...
Extrait du document
«
Un écrivain peut-il faire abstraction de son époque, de sa culture, de son quotidien lorsqu’il
écrit ?
I- L’écrivain faisant abstraction de son temps :
A- Le rejet de la réalité et le rejet du réalisme
• Certains écrivains ont refusé d’ancrer leurs textes dans leur époque.
Art pour l’art => sans lien avec le temps.
• Théorie de « l’Art pour l’Art » : refus de représenter la réalité.
Pour Théophile Gautier,
l’art doit être gratuit : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout
ce qui est utile est laid, car c'est l'expression de quelque besoin, et ceux de l'homme sont
ignobles et dégoûtants, comme sa pauvre et infirme nature ».
• Évoquez par exemple le surréalisme.
Breton (1924) : « Je crois à la résolution future de
ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte
de réalité absolue.
» Breton fait le procès du roman réaliste qui cultive le goût du détail
« chacun y va de sa petite observation » et qui se complaît dans des descriptions « rien
n'est plus comparable au néant que celle-ci ».
• Partageant les mêmes idées, Paul Valéry a refusé d’écrire une telle phrase « la marquise
sortit à cinq heures ».
B- L’art littéraire est tri, choix, embellissement
Idéalisation de la réalité.
• Chateaubriand définit le beau idéal comme l’art de choisir et de cacher.
• Baudelaire : l’imagination est la « reine des facultés » ; « Je trouve inutile et fastidieux
de représenter ce qui est, parce que rien de ce qui est ne me satisfait.
La nature est laide,
et je préfère les monstres de ma fantaisie à la trivialité positive.
»
Pour Baudelaire, représenter la réalité n’apporte rien : c’est en exerçant son imagination
que l’on est vraiment créateur.
C- L’imagination
Certains écrivains ont mis leur art avant tout, ne voulant surtout pas évoquer le quotidien.
• Fiction : base du roman.
R : Pour Voltaire, le livre n’était excusable que s’il était utile.
Or, le plaisir de la lecture, de
l’évasion, de l’imagination n’est pas méprisable.
Le roman fait oublier les soucis, le réel pendant le moment de la lecture.
Évasion.
Cf.
les
robinsonnades du XIXe siècle : Les Nouveaux Robinsons suisses et toute la vogue des
histoires qui se déroulent sur une île déserte loin de tout.
Exotisme.
• L’écrivain peut aussi adapter son imagination à la fiction –il ne vit donc pas tout à fait
hors de son temps.
Cf.
roman policier, roman d'aventures, romans fleuves, romans rocambolesques => le
lecteur est pris dans l’histoire, oublie son quotidien.
Les grandes fresques familiales =>
Les Thibaut, La Chronique des Pasquier, les Semailles et les Moissons… : le lecteur suit la
vie des personnages dans le temps ou des personnages puis de leurs enfants…
II- Un écrivain ancré dans son époque :
L’écrivain vit dans une époque.
Même si en tant qu’artiste, il peut parfois faire
figure de marginal, il appartient à son temps et le lecteur peut avoir envie d’avoir son
propre regard sur son époque par exemple.
A Une vision du monde par le texte de l’écrivain :
• La sensibilité de l’écrivain => L’écrivain est souvent un homme sensible : ressent de
manière plus intense les événements.
Écriture qui rassemble une grande quantité
d'émotions (VS prose ou théâtre qui sont souvent de longs développements).
Ex : « il a deux trous rouges dans la poitrine » Rimbaud dépeint en quelques mots toute
l'horreur de la guerre.
• Les témoignages d'écrivains sur les événements historiques présentent un intérêt pour
le lecteur s’il recherche le pittoresque, un texte plus sensible ou engagé que neutre et
complet.
• Le sens des détails et du pittoresque : S’il est bien témoin des événements, l’auteur peut
raconter, décrire la scène avec précision (puisqu’il la vécue), avec des détails, en utilisant
les mots justes.
=> le lecteur peut ainsi revivre la scène historique.
Cf.
la deuxième lettre que Mme de Sévigné envoie à sa fille pour lui parler de la mort de
Vatel le 26 avril 1671.
Beaucoup de détails, texte très soigné, vivant… Le lecteur peut très
bien s’imaginer cette mort tragique.
B- Le tableau réaliste
Au XIXe siècle, le roman voulait être un miroir de la société => dénonciation des
injustices sociales.
Sartre (XXe) : « Nous ne voulons pas avoir honte d’écrire et nous
n’avons pas envie de parler pour ne rien dire.
(...) nous voulons que l’écrivain embrasse
étroitement son époque.
»
• Lorsque l’auteur crée un personnage => le lecteur peut s’y attacher : touché par ses
misères.
Cf.
la pauvre Fantine qui est réduite à se faire couper les cheveux, puis arracher
les dents et enfin se prostituer pour aider sa petite Cosette (les Thénardier sont des escrocs
en plus => encore plus pathétique).
=> Au XIXe siècle, le roman voulait être un miroir de la société : dénonciation des injustices
sociales.
Hugo dénonce la misère dans Les Misérables, à travers plusieurs personnages touchants
et vivants.
Ce ne sont pas des types ; ont leurs défauts et leurs qualités => ressemblent
au lecteur.
Cf.
Cosette, Fantine, Valjean…
• Le roman témoin de l’époque : Lorsque le roman raconte toute l’histoire d’une famille…
=> peint aussi une époque, des mentalités… => Intérêt historique, sociologique.
Cf.
la peinture des idéologies et de la vie avant la guerre 14-18 ; puis l’évocation de la vie
pendant la guerre à travers l’histoire des Thibaut.
Cf.
la vie à Paris lorsque le mari d’Amélie est dans les tranchées dans Amélie des Semailles
et des Moissons de Troyat.
Cf.
l’arrivée des Français en Russie en 1812 dans Le Moscovite
de Troyat.
Cf.
l’image qui est donnée d’un certain....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓