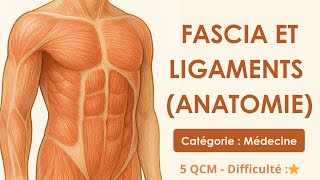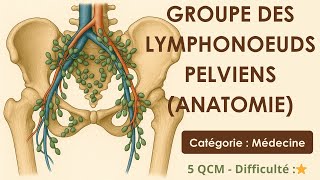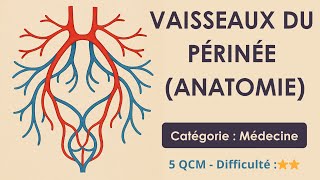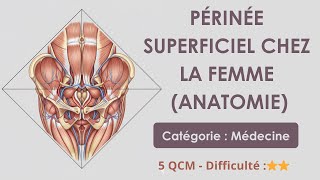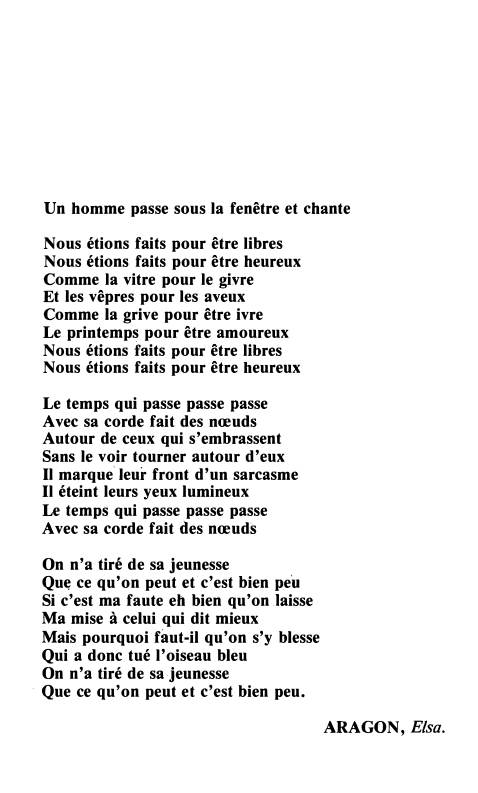Un homme passe sous la fenêtre et chante Nous étions faits pour être libres Nous étions faits pour être heureux...
Extrait du document
«
Un homme passe sous la fenêtre et chante
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Comme la vitre pour le givre
Et les vêpres pour les aveux
Comme la grive pour être ivre
Le printemps pour être amoureux
Nous étions faits pour être libres
Nous étions faits pour être heureux
Le temps qui passe passe passe
Avec sa corde fait des nœuds
Autour de ceux qui s'embrassent
Sans le voir tourner autour d'eux
Il marque'Ieur front d'un sarcasme
Il éteint leurs yeux lumineux
Le temps qui passe passe· passe
Avec sa corde fait des nœuds
On n'a tiré de sa jeunesse
Que ce qu'on peut etc'est bien peu
Si c'est ma faute eh bien qu'on laisse
Ma mise à celui qui dit mieux
Mais pourquoi faut-il qu'on s'y blesse
Qui a donc tué l'oiseau bleu
On n'a tiré de sajeunesse
· Que ce qu'on peut et c'est bien peu.
ARAGON, Elsa.
Ili Sentiments éprouvés par le poète certes et communs à
tous
(«Ah! insensé qui crois que je ne suis pas toi!»
s'excl�me Hugo le romantique.)
■ Mais ici Aragon efface son moi (ce qu'il fait rare
ment!) et prend en quelque sorte l'aspect du Destin.
Cf..
dans Electre.: le Jardinier (Giraudoux), dans Les
Mouches : le voyageur qui est d'ailleurs Jupiter (Sartre),
dans Madame Bovary: la lancinante chanson de l'aveu
gle, passant lui aussi sous les fenêtres (Flaubert), ou dans
le film de Carné Les Enfants du Paradis, le mendiant
vendeur de ballons.
II.
Le renouvellement du thème lyrique.
■ On pourrait dire encore que la facture d'ensemble du
poème : une chanson - l'homme«chante» - est tradi
tionnelle...
Cf.
chansons médiévales,.
ou poètes chansonniers
actuels : Léo Ferré, Brassens, Brel...
■ .
.
.
Que le choix mêni.e du vers est traditionnel dans
l'élégie : l'octosyllabe est èelui des chanso.ns de Rutebeuf
ou de Ch.
d'Orléans, parfois aussi de Villon, celui de
bien des poèmes lyriques du xvre siècle, celui que retrou
vent aussi romantiques ou modernes lorsqu'ils repren
nent les thèmes traditionnels.
Cf.
Jehan Rictus.
■ Mais justement c'est là qu'apparaît l'originalité
d'Aragon : une construction mélodique domine toute la
structure du poème.
■ 3 strophes de huit octosyllabes cerclées de deux vers
repris en refrain.
■ Rimes disposées symétriquement d'une strophe à
l'autre, véritable support musical.
■ Rimes répétées trois fois par strophes :
«libres/givre/ivre; h�ureux/aveux/amoureüx» par
exemple.
■ Plus proches de l'assonance que de la rime sévère de
Malherbe ; «passe/embrasse/sarcasme» par exemple'.
■
Non grammaticales, mais musicales par leur tracé.
Il Cependant ces rimes servent également d'appui aux
images qui se construisent d'un vers à l'autre et sont
particulièrement choisies pour renouveler le thème usé.
■ Importance des associations d'images pour cetranifüge du.
surréalisme.
■ Du jeu verbal presque précieux qui fut d'abord exer� ·
.
dce métaphorique (cf Feu de joie; 1917), Aragon gar
dera, comme tous les écrivains issus de ·cette école, la
maîtrise d'une image «:qui conim_ande la texture du
chant» (A.
Breton).
■ Simplicité et modernisme à la fois de cet art où le
.
créateur laisse au lecteur le soin de trouver le rythine
musical....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓