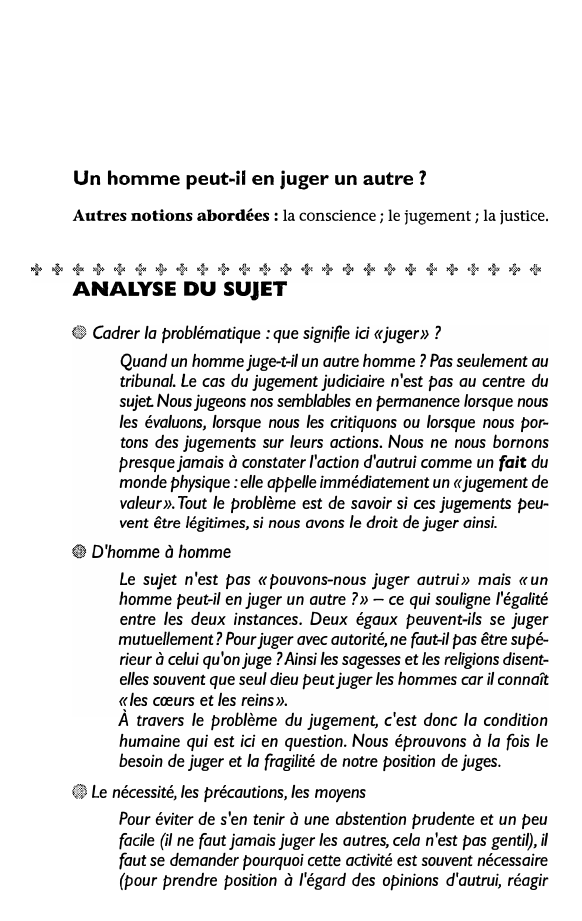Un homme peut-il en juger un autre ? Autres notions abordées : la conscience ; le jugement ; la justice....
Extrait du document
«
Un homme peut-il en juger un autre ?
Autres notions abordées : la conscience ; le jugement ; la justice.
ANALYSE DU SUJET
Cadrer la problématique : que signifie ici «juger» ?
Quand un homme juge-t-il un autre homme ? Pas seulement au
tribunal.
Le cas du jugement judiciaire n'est pas au centre du
sujet Nous jugeons nos semblables en permanence lorsque nous
les évaluons, lorsque nous les critiquons ou lorsque nous por
tons des jugements sur leurs actions.
Nous ne nous bornons
presque jamais à constater l'action d'autrui comme un fait du
monde physique : elle appelle immédiatement un «jugement de
valeur».
Tout le problème est de savoir si ces jugements peu
vent être légitimes, si nous avons le droit de juger ainsi.
@ D'homme à homme
Le sujet n'est pas « pouvons-nous juger autrui» mais « un
homme peut-il en juger un autre ? » - ce qui souligne l'égalité
entre /es deux instances.
Deux égaux peuvent-ils se juger
mutuellement? Pour juger avec autorité, ne faut-il pas être supé
rieur à celui qu'on juge ? Ainsi les sagesses et /es religions disent
elles souvent que seul dieu peut juger les hommes car il connaît
« /es cœurs et /es reins».
À travers le problème du jugement, c'est donc la condition
humaine qui est ici en question.
Nous éprouvons à la fois le
besoin de juger et la fragilité de notre position de juges.
Le nécessité, les précautions, les moyens
Pour éviter de s'en tenir à une abstention prudente et un peu
facile (il ne faut jamais juger les autres, cela n'est pas gentil), il
faut se demander pourquoi cette activité est souvent nécessaire
(pour prendre position à l'égard des opinions d'autrui, réagir
face à l'inadmissible, sanctionner /es infractions, résoudre les
litiges); quelles sont /es précautions à prendre (quelle est mon
autorité pour juger ? quels sont mes critères ? est-ce que je juge
au nom de mon humeur, de mes convictions, de mes habitudes,
de la loi ?) ; et enfin quels sont /es moyens pour garantir la légitimité du jugement d'un homme à l'égard d'un autre Ouger non
la personne mais /es actes, évaluer non l'individu mais ses performances, ne pas se poser en juge tout-puissant mais en référer à des normes ou à la loi).
®'i Mobiliser des références
- Platon oppose le jugement des hommes, faussé parce que
l'âme d'autrui ne nous apparaît jamais telle quelle mais toujours
à travers une apparence, et /e jugement des dieux devant qui /es
âmes passent nues et dépouillées de leur enveloppe charnelle.
- Les textes religieux, notamment dans la Bible et /es Évangiles,
mettent souvent en scène la prudence face au jugement d'autrui : «que celui qui n'a jamais péché lui jette la première
pierre!» dit Jésus à ceux qui veulent lapider une prostituée.
Il
cite également /e proverbe se/on lequel un homme voit plus facilement la paille qui est dans l'œil de son voisin que la poutre
qui est dans /e sien.
- La philosophie moderne du droit (Rousseau, Hegel entre
autres) développe l'idée du jugement portant sur /es actes et
non sur /es personnes.
- La Chute d'Albert Camus est un roman entièrement consacré à cette problématique :sa figure centrale est un «juge-pénitent», ancien avocat qui se confesse aux hommes pour mieux
/es obliger à se juger - et à se condamner.
Plan détaillé
Introduction
« Que-celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ! » - Cet avertissement de Jésus aux bien-pensants qui veulent lapider une prostituée vient
58
poser de façon provocante la question du jugement d'autrui : un homme
peut-il en juger un autre? Nul n'étant parfait, qui peut prétendre avoir le
droit de juger son prochain ? Et pourtant juger est un acte habituel et souvent nécessaire.
Il est donc important de préciser le bien-fondé et les limites
du jugement de l'homme par l'homme.
Nous étudierons dans un premier temps le processus par lequel la question elle-même apparaît : pratiquant quotidiennement le jugement, nous
prenons conscience, en subissant celui d'autrui, de la difficulté d'un jugement légitime et juste.
Nous préciserons alors les raisons qui semblent interdire à quiconque de juger son prochain ; nous verrons enfin qu'il n'est
pourtant pas souhaitable de renoncer à toute activité de jugement et qu'il
convient donc de se fixer des règles.
I.
Du jugement au scrupule
€0 Juger autrui, une vieille habitude
Kant rappelle, dans la Oitique de la raison pratique, qu'il n'y a pas de passetemps plus courant dans la société que de juger son voisin ; Rousseau précise, dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les
hommes, que ce phénomène est lié à la vie en société : nous sommes
constamment sous le regard d'autrui et l'amour-propre est le produit du souci
de valoir aux yeux d'autrui.
(&;
L'expérience de l'injustice
Le même Rousseau évoque aussi cependant la cruauté du jugement de
l'homme sur l'homme : si l'homme est un loup pour....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓