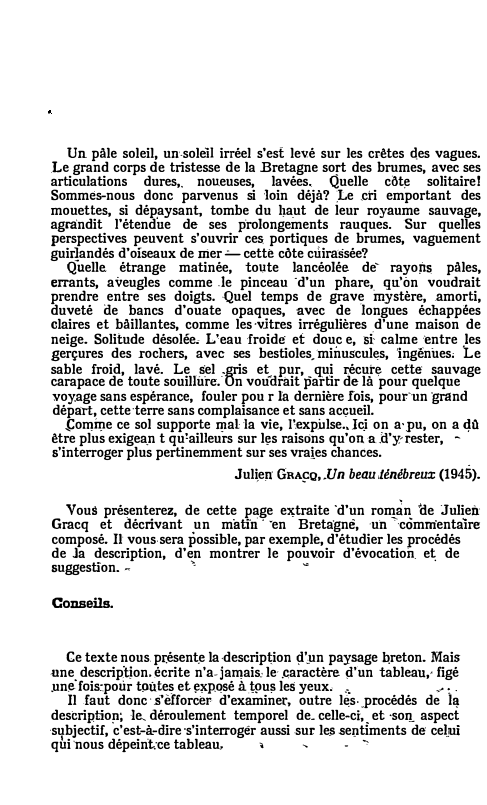Un pâle soleil, un-sole11 irréel s'est levé sur les crêtes cles vagues. Le grand corps de tristesse de la Bretagne...
Extrait du document
«
Un pâle soleil, un-sole11 irréel s'est levé sur les crêtes cles vagues.
Le grand corps de tristesse de la Bretagne sort des brumes, avec ses
articulations dures,.
noueuses, lavées.
Quelle côte solitaire!
Sommés-nous donc parvenus si loin déjà? :Le .cri emportant des
mouettes, si dépaysant, tombe du l).aut de leur royaume sauvage,
agrandit l'étendue de ses prolongements rauques.
Sur quelles
perspectives peuvent s'ouvrir ces.
portiques de brumes, vaguement
guirlandés d'oiseaux de mer-=- cette côte cuirassée?
Quelle.
étrange matinée, toute lancéolée de' rayoµs pâles,
errants, aveugles comme Je pinceau 'd'un phare, qu'on voudrait
prendre entre ses doigts.
-Quel temps de grave mystère, .amorti,
duveté de bancs d'ouate opaques, avec de longues échappées
claires et bâillantes, comme les-vitres irrégulières _d'une maison de
neige.
Solitude désolée.
L'eau froide et dou_c e, si- calme ;entre .Jes
gerçures des rochers, avec ses bestioles,'minuscules, 'ingénues, Le
sable froid, lavé.
Le _sel _.gris et pur, qui récure cette sauvage
carapace de toute souil!Ure.
On vouârait partir de là pour quelque
voy.age sans espêrance,_ fouler po_u r fa dernière fois, pourun grand
départ, cette-terre sans complaisance et sans accueil.
.Çom�e ce sol supporte I!lalla vie, rexpùlse..
Ic_i on a·pu, on a 411
être plus exigea_n t qu!ailleurs sur l�s raisons qu'on a.d'y- rester, s'interroger plus pertinemment sur ses vraies chances.
Jul�e11 GRAf:Q,.Un beau,iénébreux (1945).
Vous présenterez, de cette page e,çtraite 'd'un rom�n 'de Julien
Gracq et décrivant un mati'Ii · ·en Bretagnè, -un "·commentaire
composé.
Il vous-sera possible, par exemple, d'étudier les procédés
de Ja description, d'�n montrer le pouvoir d'évocation.
e� de
�
suggestion.
Conseils.
Ce texte-nous.
pr.ésent_e la-descrip\ion !f'0un paysage .Qreton.
Mais
une descriptjon.
écrite.
n'a.
jamais, le· .caractère d'Un tableau,•- figé
.une.'fois::poùr toütes et �l'PQSé à t9ui; les yeux, -�
_, ! .
Il faut donc· .s'èfforcer d'examiner, outre lès- _procédés de 1�
descriptioµ; le, dér.oulement temporel de.
celle-ci,.
et ·soQ aspect
·subjectif, c'est-à-dire ·s'interroger aussi .sur le.s septiments de cel_ui
qhi•nous dépeint:ce tableau,
•
,
- .,
Lectures.
J.GRACQ.:
Un Beau Ténébreux,
Au château d'Àrgol.
Le Rivage des Syrtes,
Cahiers de ['Herne sur Julien Gracq.
BALZAC: Béatrix.
PLAN
nu
DEVOm
Introduction
a) Situation du passage
b) Idée générale
c) Thëmes développés ensuite
Développement
A ,La.description comme ui:e symphonie
1) clôtures et ouvertures-cadences
2) évolution du regard
3) procédés descriptifs-mystère et netteté
B Lq.
description comme unlldieu
l) tristesse et négativité
·· 2) échec dans l'approche
·3) La Mort.
Conclusion
a) Bilan sur.le texte
b)- Situation dansl .'œuvre de Gracq.
DEVOm RÉDIGÉ
L'action du roman de Julien Gracq Un Beau Ténébreux, publié
en 1945, se situe en Bretagne, où un petit groupe de jeunes gens
entretenant des relations privilégiées vit dans un climat :�e tension
angoissée.
T-out au long du roman·, la nature est omniprésente.
Les
descriptions de la côte, .de la mer, se renouvellent sans cesse,
'comme se,enouvellent les vagues, comme si•l'auteur rie parvenait
pas, par sa parole, à épuiser les richesses du- paysage.
La
description que' nous avons sous les yeux se situe vers )a fin du
roman, au milieu d'une conversation très tendue entre deux
personnages, et cette place ne 'lui a pas été conférée au ·hasard.
Il
.semble que œtableau .ne soit pas un élément décoratif surajouté,
mais une· pièce maitresse pour le déroulement de la partie qui se
'
joue entre les personnages, pour la pensée de cliacun..Cette description peut donc être lue à ·deux niveaux�- d'abord
comme un tableau, qui nous rendrait parfaitement les ·sensations
éprouvées par le spectateur devant ce lever de soleil dans la
brume, mais aussi comme une tentative d'approche p_lus intime,
plus personnelle, du.
narrateur au paysage,
La vision de· eette côte bretonne que nous suggère le narrateur
pr�sente un double caractère, plastique en ée sens qu'elle nous
peint un tableau, et musiçal par le déroulement temporel de la
description, sa lente émergence, ses reprises.
e da capo » comme
dans une symphonie.
La première impression que donne le ·texte,
·c'est celle d'une succession de· clôtures et d'ouvertures 011, pour
parler le langage des musiciens, ·d'une succession de cadences.
L'impression d'un discours qui.
toujours ·va se finir faute, de
trouver une prise sur son objet, mais: qui toujours reprend.
La
•premièrè phrase déjà, par le jeu de ses sonorités en miroir, a ·l'air
de se clore sur elle-même
un pâle solèil, un soleil irréel, s'est levé sur-les crêtes des vagues.
ê
a
a
è
e
é
è.
è
De même, dans la suite de la description, le texte ne .progresse·
pas de façon continue, comme progresserait une rivière mais, à la
manière des vagues venant battre un rivage� par saccades
indépendantes.
Les phrases ne prennent pas appui l'une sur
l'autre: ,pas 1,1n seul mot de liaison dans ce texte; et la similitude
même.
du d!!but de nombre d'entre elles accentue leur ressem
blance avec des vague.s
Quelle côte solitaire
Quelle étrange matinée
Quel temps de grave·mystère•
Or cette succession sempiternelle,n.'engendre.pas.
l'uniformité.
Il
y a dans ce texte un déroulement temporel; nous suivons le regard
du spectateur à la découverte du paysage.
c�est d'abord l'émer:
gence de ln côte, avec celle du soleil
« _un pâle soleil...
•s'est levé / le grand corps.., sort »
C'est d'abord l'étendue de ces rochers, de ce 'Ciel, que G.racq
susèite, en son abs.ence de limites, son caractère infini
« sur quelles perspectives peuvent s'ouvrir...
»
C'est enfin, quand l'œil, ivre de s'être perdu dans le jeu des
lignes horizontales, -s'abaisse, la peinture des détails, et jusqu'aux
plus petits : « ses bestioles minuscules, ingénues >>.
De même qu'il nous fait suivre le regard de Gérard, spectateur
de ce tableau, Gracq nous fait partager ses impressions· face .au
paysage, qui-exerce sur lui µn,charme dù-à un mélange de mystère
et de netteté.
Mystère d'abord, auquel le spectateur se heurte dès Je départ :
« un soleil irréel ».
Le- corps de la Bretagne s'est enveloppé de
brumes, le paysage tout entier n'est ·perçu· qu'à travers un
bn1uillard : a ces portiques de brumes-».
Tout :le vocl!,bulaire
.employé par l'auteur, ses phrases interrogatives, sont ·destinées à
nous faire ressentir -cette impression d'étrangeté: o.
Sommes-nous
donc parvenus si loin .déjà? o a Quelle étrange matinée...
» a Quel
temps de grave mystère.
• Il semble même parfois que les sens de
l'homme soient impuissants à comprendre et à ress�ntir ce
tableau, qu'il- faudrait .des moyens plus puissants et plus fins,
-inconnus.
L'auteur opère donc un savant mélange de sensations.:
,Je .cri des mouettes est emportant .(participe qui suggère une
action -physique), il « agrandit.
l'étendue.
de ses prolongements
.rauques o.
L'accouplement.
de mots appartenant à des....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓