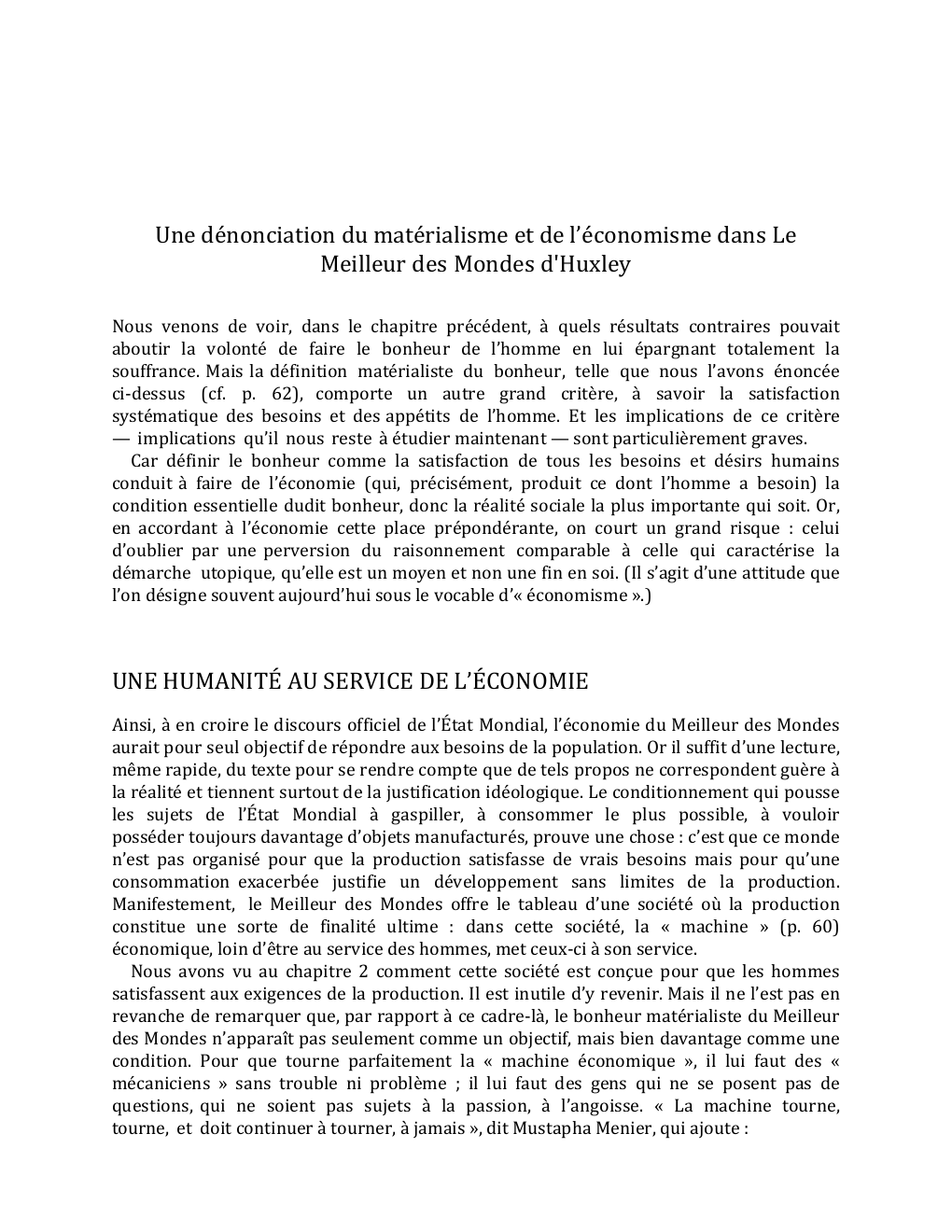Une dénonciation du matérialisme et de l’économisme dans Le Meilleur des Mondes d'Huxley Nous venons de voir, dans le chapitre...
Extrait du document
«
Une dénonciation du matérialisme et de l’économisme dans Le
Meilleur des Mondes d'Huxley
Nous venons de voir, dans le chapitre précédent, à quels résultats contraires pouvait
aboutir la volonté de faire le bonheur de l’homme en lui épargnant totalement la
souffrance.
Mais la définition matérialiste du bonheur, telle que nous l’avons énoncée
ci-dessus (cf.
p.
62), comporte un autre grand critère, à savoir la satisfaction
systématique des besoins et des appétits de l’homme.
Et les implications de ce critère
— implications qu’il nous reste à étudier maintenant — sont particulièrement graves.
Car définir le bonheur comme la satisfaction de tous les besoins et désirs humains
conduit à faire de l’économie (qui, précisément, produit ce dont l’homme a besoin) la
condition essentielle dudit bonheur, donc la réalité sociale la plus importante qui soit.
Or,
en accordant à l’économie cette place prépondérante, on court un grand risque : celui
d’oublier par une perversion du raisonnement comparable à celle qui caractérise la
démarche utopique, qu’elle est un moyen et non une fin en soi.
(Il s’agit d’une attitude que
l’on désigne souvent aujourd’hui sous le vocable d’« économisme ».)
UNE HUMANITÉ AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE
Ainsi, à en croire le discours officiel de l’État Mondial, l’économie du Meilleur des Mondes
aurait pour seul objectif de répondre aux besoins de la population.
Or il suffit d’une lecture,
même rapide, du texte pour se rendre compte que de tels propos ne correspondent guère à
la réalité et tiennent surtout de la justification idéologique.
Le conditionnement qui pousse
les sujets de l’État Mondial à gaspiller, à consommer le plus possible, à vouloir
posséder toujours davantage d’objets manufacturés, prouve une chose : c’est que ce monde
n’est pas organisé pour que la production satisfasse de vrais besoins mais pour qu’une
consommation exacerbée justifie un développement sans limites de la production.
Manifestement, le Meilleur des Mondes offre le tableau d’une société où la production
constitue une sorte de finalité ultime : dans cette société, la « machine » (p.
60)
économique, loin d’être au service des hommes, met ceux-ci à son service.
Nous avons vu au chapitre 2 comment cette société est conçue pour que les hommes
satisfassent aux exigences de la production.
Il est inutile d’y revenir.
Mais il ne l’est pas en
revanche de remarquer que, par rapport à ce cadre-là, le bonheur matérialiste du Meilleur
des Mondes n’apparaît pas seulement comme un objectif, mais bien davantage comme une
condition.
Pour que tourne parfaitement la « machine économique », il lui faut des «
mécaniciens » sans trouble ni problème ; il lui faut des gens qui ne se posent pas de
questions, qui ne soient pas sujets à la passion, à l’angoisse.
« La machine tourne,
tourne, et doit continuer à tourner, à jamais », dit Mustapha Menier, qui ajoute :
« Il faut que les rouages tournent régulièrement, mais ils ne peuvent tourner sans qu’on
en ait soin.
Il faut qu’il y ait des hommes pour les soigner, aussi constants que les rouages sur
leurs axes, des hommes sains d’esprit, stables dans leur satisfaction.
Criant : « Mon bébé, — ma mère, — mon seul, mon unique amour » ; gémissant : « Mon
péché, mon Dieu terrible » ; hurlant de douleur, marmottant de fièvre, geignant sur la
vieillesse et la pauvreté, comment peuvent-ils soigner les rouages ? » (p.
60-61).
La métaphore mécanique de Menier a le mérite de la plus grande clarté.
Pour
l’Administrateur, les hommes sont les servants de la machine économique ; les qualités qu’on
leur demande sont celles mêmes d’une machine, régularité, stabilité, fiabilité ; et pour créer
en eux lesdites qualités, on leur procure un bonheur matériel total, synonyme à bien des
égards d’abrutissement.
Ainsi, la vision matérialiste du bonheur entraîne la sacralisation de l’économie, laquelle
justifie à son tour une adaptation intégrale de l’humanité aux exigences de la production.
Tel
est bien le « message » d’Huxley : quand on donne la primauté absolue aux jouissances et aux
biens matériels, on risque d’oublier que ceux-ci devraient être faits pour l’homme et non
l’inverse.
On risque d’en venir à priver l’être humain de ses rêves, de ses idéaux, de sa liberté,
de ses sentiments, au nom d’une production quasiment divinisée.
UNE CONDAMNATION DU « FORDISME »
Bien sûr, l’univers dépeint dans Le Meilleur des Mondes est une caricature, une société
imaginaire où le culte de l’économie aurait été poussé jusqu’à ses plus extrêmes limites.
Mais
il n’en reste pas moins qu’Huxley pouvait observer dans la réalité des années 1920-1930 des
phénomènes qui rendaient fort plausible, à plus ou moins long terme, l’avènement de son
anticipation.
Nous avons évoqué ci-dessus (p.
13) de quelle manière les pays occidentaux, et
surtout les Etats-Unis, commençaient alors à connaître les effets d’une modernisation
accélérée, la production de masse, l’effondrement des valeurs traditionnelles au profit d’un
« culte » matérialiste de l’activité industrielle et de la consommation.
Un nom est symbolique de ces évolutions, de ces changements : celui de l’industriel nordaméricain Henry Ford (1863-1947) dont Huxley a fait très significativement, nous allons y
revenir, le « Messie » du Meilleur des Mondes.
Ford et le taylorisme
Ford, en effet, fut le premier chef d’entreprise à installer dans ses usines des chaînes de
montage mobiles qui permirent dès 1909 (chose qui ne s’était jusque-là jamais vue dans
l’histoire industrielle) la production en masse d’un objet mécanique complexe : la célèbre
automobile du modèle T.
Il fut aussi le premier à mettre en application, pour obtenir un tel
résultat, ce qu’il est convenu d’appeler le taylorisme, c’est-à-dire un ensemble de méthodes
« scientifiques » d’organisation industrielle, définies à la fin du XIXe et au début du XXe siècle
par des ingénieurs comme Taylor (1856-1915).
Or lesdites méthodes ont pour objectif de rationaliser entièrement le processus de
production, et, pour cela, de spécialiser étroitement le rôle des ouvriers, l’intervention de
chacun d’eux étant réduite à un petit nombre d’actes simples et soigneusement étudiés.
Cette
rationalisation du travail industriel conduit ainsi à ôter aux ouvriers toute forme d’initiative
et de maîtrise de leur activité.
Elle conduit parallèlement à rendre indésirables chez eux les
qualités de compétence et de réflexion — considérées comme frustrantes pour des
travailleurs auxquels on demande seulement de répéter à l’infini une brève série de gestes
élémentaires.
Le taylorisme aboutit de la sorte à définir comme prototype de l’ouvrier idéal
un être quelque....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓