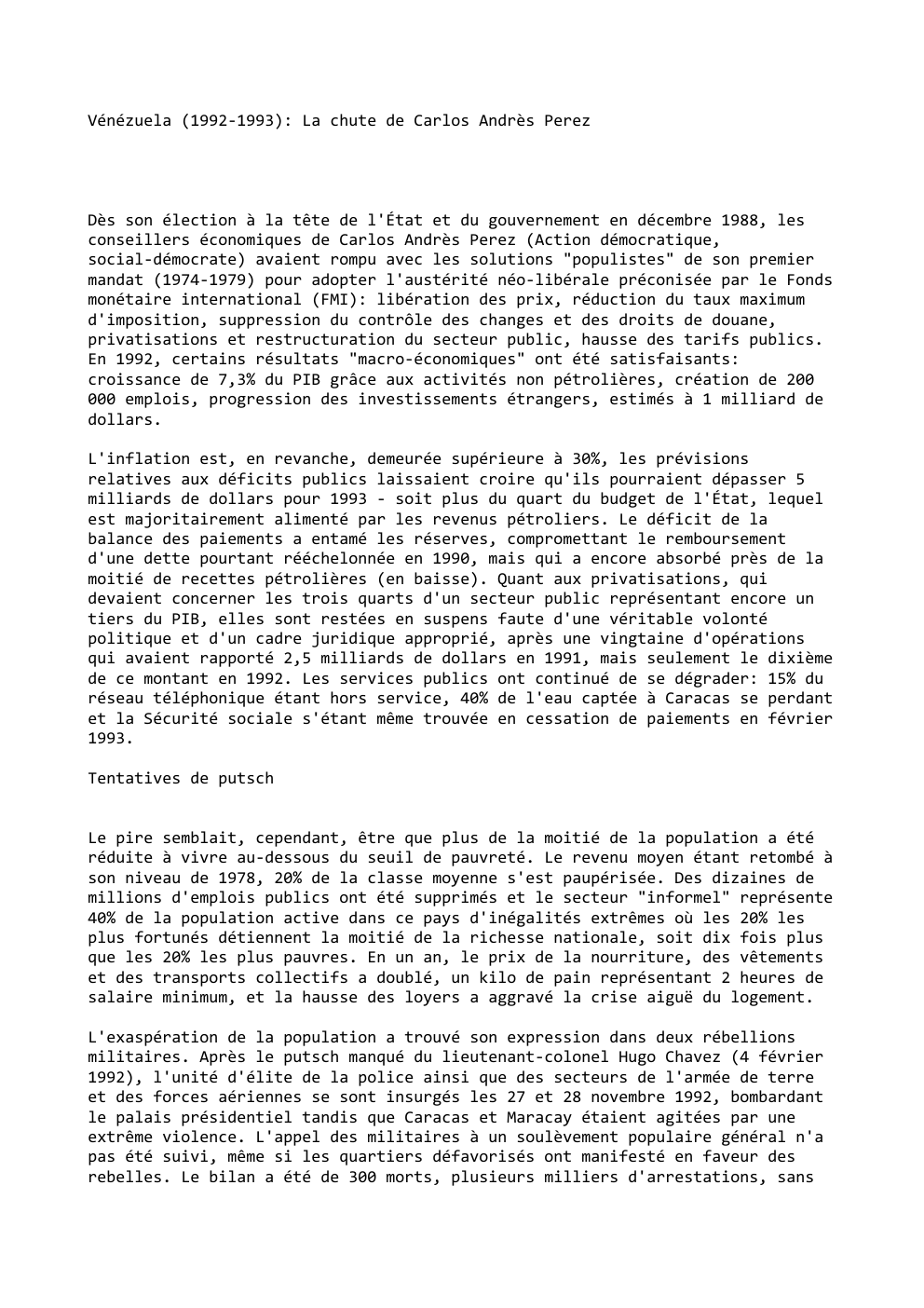Vénézuela (1992-1993): La chute de Carlos Andrès Perez Dès son élection à la tête de l'État et du gouvernement en...
Extrait du document
«
Vénézuela (1992-1993): La chute de Carlos Andrès Perez
Dès son élection à la tête de l'État et du gouvernement en décembre 1988, les
conseillers économiques de Carlos Andrès Perez (Action démocratique,
social-démocrate) avaient rompu avec les solutions "populistes" de son premier
mandat (1974-1979) pour adopter l'austérité néo-libérale préconisée par le Fonds
monétaire international (FMI): libération des prix, réduction du taux maximum
d'imposition, suppression du contrôle des changes et des droits de douane,
privatisations et restructuration du secteur public, hausse des tarifs publics.
En 1992, certains résultats "macro-économiques" ont été satisfaisants:
croissance de 7,3% du PIB grâce aux activités non pétrolières, création de 200
000 emplois, progression des investissements étrangers, estimés à 1 milliard de
dollars.
L'inflation est, en revanche, demeurée supérieure à 30%, les prévisions
relatives aux déficits publics laissaient croire qu'ils pourraient dépasser 5
milliards de dollars pour 1993 - soit plus du quart du budget de l'État, lequel
est majoritairement alimenté par les revenus pétroliers.
Le déficit de la
balance des paiements a entamé les réserves, compromettant le remboursement
d'une dette pourtant rééchelonnée en 1990, mais qui a encore absorbé près de la
moitié de recettes pétrolières (en baisse).
Quant aux privatisations, qui
devaient concerner les trois quarts d'un secteur public représentant encore un
tiers du PIB, elles sont restées en suspens faute d'une véritable volonté
politique et d'un cadre juridique approprié, après une vingtaine d'opérations
qui avaient rapporté 2,5 milliards de dollars en 1991, mais seulement le dixième
de ce montant en 1992.
Les services publics ont continué de se dégrader: 15% du
réseau téléphonique étant hors service, 40% de l'eau captée à Caracas se perdant
et la Sécurité sociale s'étant même trouvée en cessation de paiements en février
1993.
Tentatives de putsch
Le pire semblait, cependant, être que plus de la moitié de la population a été
réduite à vivre au-dessous du seuil de pauvreté.
Le revenu moyen étant retombé à
son niveau de 1978, 20% de la classe moyenne s'est paupérisée.
Des dizaines de
millions d'emplois publics ont été supprimés et le secteur "informel" représente
40% de la population active dans ce pays d'inégalités extrêmes où les 20% les
plus fortunés détiennent la moitié de la richesse nationale, soit dix fois plus
que les 20% les plus pauvres.
En un an, le prix de la nourriture, des vêtements
et des transports collectifs a doublé, un kilo de pain représentant 2 heures de
salaire minimum, et la hausse des loyers a aggravé la crise aiguë du logement.
L'exaspération de la population a trouvé son expression dans deux rébellions
militaires.
Après le putsch manqué du lieutenant-colonel Hugo Chavez (4 février
1992), l'unité d'élite de la police ainsi que des secteurs de l'armée de terre
et des forces aériennes se sont insurgés les 27 et 28 novembre 1992, bombardant
le palais présidentiel tandis que Caracas et Maracay étaient agitées par une
extrême violence.
L'appel des militaires à un soulèvement populaire général n'a
pas été suivi, même si les quartiers défavorisés ont manifesté en faveur des
rebelles.
Le bilan a été de 300 morts, plusieurs milliers d'arrestations, sans
compter les destructions infligées à l'université centrale par la Garde
nationale.
Plusieurs centaines de militaires qui affirmaient vouloir "rétablir
la démocratie et éradiquer la corruption gouvernementale" ont été jugés en cour
martiale, tandis qu'une centaine s'étaient réfugiés au Pérou.
Le chef de l'État qui, après le premier putsch, avait appelé au sein du
gouvernement des opposants démocrates-chrétiens - démissionnaires en juin 1992 puis confié le ministère des Affaires étrangères au général Fernando Antich
Ochoa, a estimé qu'il ne s'agissait que d'un simple "soubresaut" contestataire
mais reconnu que les réformes de fond annoncées en février n'avaient été que
très partiellement mises en oeuvre.
Certes, le salaire minimum et les soldes des
militaires ont été augmentés de 30% et des "bons alimentaires" distribués aux
enfants pauvres scolarisés, tandis qu'étaient lancés des programmes sociaux pour
les plus démunis, cofinancés par la Banque mondiale.
Mais le mécontentement
social a persisté, aggravé par la corruption.
Quant aux réformes
institutionnelles et fiscales (97% des revenus échapperaient à l'impôt), elles
ont été bloquées par le Congrès.
C.A.
Perez était ainsi apparu plus isolé que
jamais, tant de la population, dont le taux de désapprobation avait atteint 92%
en 1992, que de son propre parti.
Rejet du président et de la corruption
Le 6 décembre 1992, les électeurs ont été appelés pour la seconde fois en
trente-quatre ans - à la suite d'une réforme du président Perez en 1989 - à
élire directement 22 gouverneurs,....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓