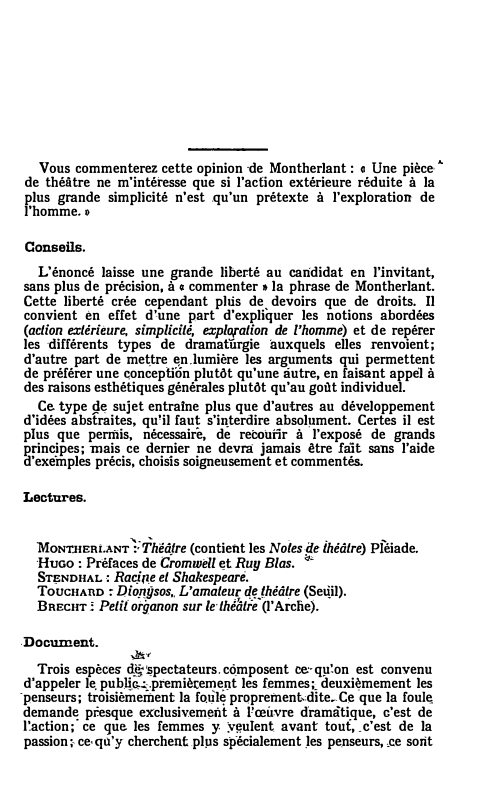Vous commenterez cette opinion ·de Montherlant: o Une pièce, de théâtre ne m'intéresse que si l'action extérieure réduite à la...
Extrait du document
«
Vous commenterez cette opinion ·de Montherlant: o Une pièce,
de théâtre ne m'intéresse que si l'action extérieure réduite à la
plus grande simplicité n'est .qu'un prétexte à l'exploration de
l'homme.
o
Conseils.
L'énoncé laisse une grande liber-té au candidat en l'invitant,
sans plus de précision, à � commenter & la phrase de Montherlant.
Cette liberté crée cependant phis de devoirs que de droits.
Il
convient en effet d'.une part d'expliquer les notions abordées
(action extérièure, simplicité, exploration de l'homme) et de repérer
les différents types de dramaturgie auxquels elles renvoient;
d'autre part de met_tre �n.Iumière les arguments qui permettent
de préférer une conception plutôt qu'une âutre, en faisant appel à
des raisons esthétiques générales plutôt qu'au goût individuel.
Ce type �e sujet entraîne plus que d'autres au développement
d'idées abstraites, qu'il fau! s'iflterdire absol:ument.
Certes il est
plus que permis, nécessaire, de recoui'ir à l'exposé de grands
principes; mais ce dernier ne devra jamais être fait sans l'aide
d'exemples précis, choisis soigneusement et commentés.
Lectures.
MoNT,HERi.ANT�:ThëâJre (contient les Notesjie ihéâtre) Pléiade.
Huoo : Préfaces de Cromwell {lt Ruy Blas.
""
STi,;:NDHAL : Rac_in,e et Shakespeare.
ToucHARD = ])io!!J}sos,, L'amateu{ d,tlhéât_re (Seqil).
BRECHT.: Petit otganon sur le' théâtie (l'Arclie).
-Document.
,J!t·<
Trois espèces dJ�:'�pectateurs.
cô_mposent ce« qµ'.on est convenu
d'appeler le.
pub,ij_c,�.ptemiète�e.1,1t les fommes;� deuxi�mement les
·penseurs; troisièmement la fo.1�I� proprement,,diter.Ce que la foui�
demandi: pr.esque exclusivement à Fœùvre d'ramàti_que, c'est de
!'.action; ce que les femmes y :Veulent avant tout, .c'est de la
passion;- ce•qù'y cherchent .plµs sj::iécialement _les pe_nseurs"c.e sont
des car�ctères.
Si.
l'on étudie attentivement ces trois classes de
spectateurs, voici ce que l'on remarque: la foule est tellement
amoureuse de l'actiori qu'au besoin elle fait bon marché des
cara�tères et des passions.
Les femmes, que l'action int.éresse
d'ailleurs, sont si absorbées par les développements de la passion
qu'elles se préoccupent peu du dessin des ·caractères; quant aux
penseurs, ils ont un tel goût de voir des caractères, c'est-à-dire des
hommes, vivre sur la scèn�, que, tout en accueillant volontiers la '
passion comme incident naturel dans l'œuvre dramatique, ils en
viennent presque à être i�portunés par l'action; Cela tient à ce
que la foule dem1;1nde surtout au théâtre des sensations; Ja femme,
des émotions; lt: penseur, des méditations.
Tous veulent un
plaisir; ceux-ci le plaisir des yeux; celles-là le -plaisir, du
cœur; les derniers, le plaisir de l'esprit.
De là, sur notre scène,
trois espèces d'œuvres bien distinctes: l'une vulgaire et inférieure,
les deux autres illustres et supérieures, mais qui toutes les trois
satisfont un besoin: le mélodrame pour la foule; pour les femmes,
la ti:agéQ,ie .qui analyse la passion; pour les penseurs, la comédie
qui peint l'humanité.
HuGo, Préface de Ruy· Blas.
SUJET DÉVELOPPÉ
Introduction
S'il faut en croire les traditions scolaires et universitaires,
l'étude de l'homme et de ses mystères est la fin ultime - et
suprême - de la littérature.
Les .écrivains sont enrôlés bon gré
mal gré dans cette quête : il semble même que le critère essentiel
permettant d'introduire un auteur dans le panthéon de la
littérature soit le progrès qu'il a fait accomplir à la connaissance
de l'homme.
Montaigne, Pascal, Balzac, sont à,,ranger, à 'ce titre
parmi.Jes tout premiers.
C'est par ce biaîs.aussi1-qu'une critique la
plupart du temps moralisante s'annexe ceux qu'elle voudrait
rejèter, mâis que.
la faveur du public a classés parmi les grands
écrivains : elle reconnaît que, malgré leur immoralité, ils ont fait
mieux connaître telle ou telle partie de la nature humaine;
Baudelaire, entre autres, a dù passer par là.
Mais le théâtre a sans
doute eu plus à sm.iffrir que d'autres genres Œttéraires de cette
prééminenèe de l'humanisme dans les valeurs universitaires :
l'étude d'une pièce de théâtre ne se résume-t-ellëpas la plupart du
temps à l'èfude minùtieuse de la o psychologie :des personnages o,
négligeant à la fois la construction de l'intrigue, la valeµr
scénique, et ce· qui fait l'intérêt réel de la pièce pour le spectateur
qui la voit représentée au lieu de la lire.
Une telle, démarche
semble trop partielle pour être adoptée par un dramaturge
soucieux, lui, de faire représenter sa pièce et, selon' le mot de
Molière, de plaire.
II paraît donc surprenant de lire sous la plume
.d1Henry de- Montherlant: o Une pièce de théâtre· ne m'intéresse
que si l'action extérieure réduite à la plus grande simplicité n'est
qu'un prétexte à l'exploration de l'homme.» .Ce jugement, sans
doute, se pr:ésente comme une simple préférence de Montherlant,
sans valeur générale.
II est cependant permis de s'interroger sur la
.conception théâtrale que recouvre ce goût un peu paradoxal; car
,loin d'.exprimer une opinion isolée, Montherlant apporte sa
contribution, utile'puisqu'il est lui-même un- homme de théâtre, à
la controverse soulevée par les Romantiques et qui, pour paraitre
dépassée, n'influence pas moins le théâtre d'aujourd'hui.
Car il est
intéressant d'examiner les solûtions adoptées, de propos délibéré,
par certains dramaturges modernes, au moment précisément où
l'abolition des contraintes qui !l'exiirçaient jadis sur les créateurs
leur laisse toute liberté d'écrire· des pièces de théâtre selon leur
cœur.
Développement
La citation de Montherlant demande d'abord à être éclairée
quelque peu.
L'auteur y parle de a pièce de théâtre• sans
référence à un genre particulier.
II ne s'agit pas là d'une
concession à la coutume contemporaine qui est de ne pas
caractériser d'emblée les œuvres dramatiques: Montherlant lui
même appelle a drame• plusieurs de ses pièces, La Reine morte par
exemple, et o comédie• Un incompris.
Sa volonté est donc de
réunir dans le même jugement tous les genres dramatiques qu'il
prétend apprécier selon les mêmes critères: l'o exploration de
l'homme·• qui s'y accomplit.
Ce terme est suffisamment vague
pour recouvrir à -la fois l'analyse d'un caractère ou d'un type
(l'avare, l'atrabilaire amoureux) et l'étude psychologique- d'un
individu (Rodrigue, Andromaque).
Enfin il faut expliquer « la
simplicité de l'action extérieure• qui renvoie à la simplicité de
l'intrigue telle qu'elle était définie au xvue siècle; mais, par ce
mot imagé et expressif, Montherlant oppose apparemment l'exté
rieur, c'est-à-dire l'aspect scénique et dramatique de la, pièce, aux
ressorts purement humains du personnage.
On voit qu'il se veut
par là résolument classique, faisant même référencEf.à l'homme.
éternel sorti de son milieu et de son époque.
Cette attitude, :nous l'avons dit, est paradoxale en ce qu'elle
semble .élire pour modèle une époque très Isolée de notre
littérature car le classicisme, dans l'histoire du théâtre, n'est
qu'un bref intermède.
dans un courant ininterrompu où, pour
paraphraser Stendhal, Shakespeare l'emporte nettement sur
Racine.
Au xvue siècle même, le théâtre classique n'a jamais fait
disparaitre des formes b_eaucoup plus populaires de spectacle où.
la
psychologie des personnages est plus que sommaire : la pièce à
machines et, surtout, la tragi-comédie; là triomphent les combats
sur scène, les déguisements, les enlèvements, les ·quiproquos, les
reconnaissances; en un mot, tout est dans l'intrigue ·et ni les
bienséances ni la vraisemblance ne sont respectées.
Qu'on rem
place la médi9crité de Mairet ou de Scudéry par le génie d'Hugo,
et c'est le drame romantique qu'on· définit ainsi à peu de choses
près.
Sans doute Hugo a-t-il d'autres prétentions lorsqu'il
·compose ses drames� les préfaces de Cromwel_l et de· Ruy· Blas
manifestent une volonté de synthèse entre la comédie et la
tragédie d'une part, entre l'action, le& caractères et les passions
d'autre part.
Cependant, soit que l'auteur y ait été contraint par
des.
nécessités dramatiqu·es, soit que son propre tempérament l'ait
porté plus volontiers vers, l'action que vers l'exploration de
l'homme, ces synthèses qui, en théorie du moins, devaient être
équitables, se font aux dépens de la psychologie des personnages.
Le-théâtre classique présente des héros certes-actifs, mais au- sein
d'une- crise à laquelle ils qe peuvent en aucune façon imposer une
issue parTaction; la pièce dépeint alors leurs hésitations qui sont
d'autant plus tragiques que la durée des événements est limitée à
vingt-quatre heures.
Le drame romantique, au contraire dépeint
le héros dans l'action: ainsi HernQ[li pourrait facilel!lent être
qualifié de pièce d'auentures; les ·cinq actes présentent le héros
dans différente!!_ situations;,il y manifeste sa bravoure, son sens de
l'honneur, son amour; mais ces traits· sont évidents des· la
première scène et n'évoluent pas au cours de la pièce, pas plus q�e
le héros ne se tro�ve confronté à un di�emme, -où s'approfondir�it
la dimension humaine de son personnage: l'action est son se'ul
moyen d'expression.
On voit donc que c'est la volonté même
d'introduire l'action sur le théâtre qui diminue l'épaisseur
psychologique des personnages, et par là même.
l'intérêt des
spectateur§..soucieux avant tout de l' t exploration de I'h.omme ».
La richesse romantique, richesse en couleurs; en décors, en
costumes, en personnages (ce qui diminue d'àutant l'attention que
l'auteur peut porter à chacun d'eux) se caractérise plus par le
foisonnement que par la profondeur : elle trouve son apogée �veè
le théâtre rle Rostand, remarquable agencement de scènes de
genre, de reconstitutions historiques, de grands déploiements de
foule, mais: dans.
lesquels la œnnais.sance· qu'a le Sj)ectate.ur de
l'âme des personnages est �xtrêmement superiicie11e.
Il reste que Montherlant formule un' goùt personnel, non un
jugement général; peut-on aujourd'hui être intéressé par un
théâtre qui repose uniquement sur l'a:cfion extérieure? Cette
conception dramatique, semble-t-il; s'expliquait assez bien à une
époque où le théâtre, qui ne subissait la concurrence d'aucun
genre artistique, jouait, par force, le rôle de spectacle populaire.
Aujourd'hui, ce rôle est dévolu à d'autres moyens de COf!Imunica
tion, le cinéma et la télévision· en, particulier.
Ces derniers
disposent de m(!yens bieri supérieurs -dans le domaine- du
spectaculaire; scènes tournées,en (jXtérieur, scènes en mouvement,.
_e{(e� spéciaux, figuration, cascade, ,co_stumes-.
On peut dire que
les· films de cape et d'épée et les westerns ont remplacé de nos
jours le théâtre d'acfü:inr .et.
c'est justice, car,.
si l'on cherche
seulement à voir représenter.des faits, pourquoi ne pas préférer le
moyen le plus fidèle de.reproduction de· ces faits?·
II ne faut pas négliger cépendarit la fascination qu'exerce la
scène sur le _pub1ic.
Saturés de cinéma, -dont ils connaissent les
.facilités - u11-plarr peut 'être recommencé de nombreus�s fois et.
dont la réalisation définitive interdit l'êmofion du « direct » des
spectateurs que le théâtre n'attirerait pas en d'autres circons
tances sont ·impressionnés de voir évoluer....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓