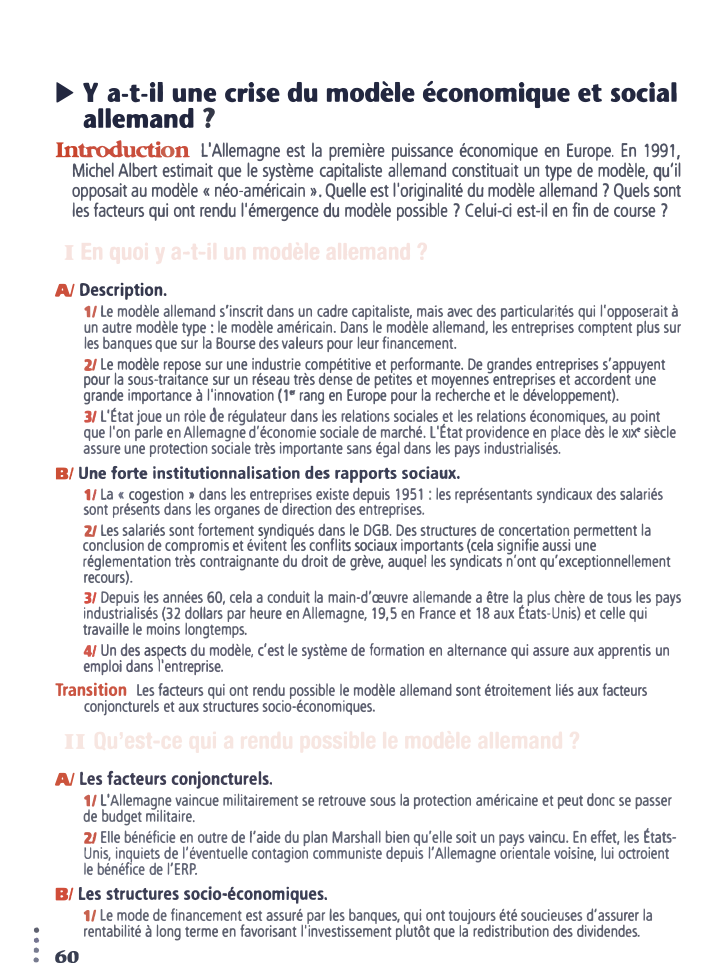► Y a-t-il une crise du modèle économique et social allemand 7 Introduction L'Allemagne est la première puissance économique en...
Extrait du document
«
► Y a-t-il une crise du modèle économique et social
allemand 7
Introduction L'Allemagne est la première puissance économique en Europe.
En 1991,
Michel Albert estimait que le système capitaliste allemand constituait un type de modèle, qu'il
opposait au modèle« néo-américain».
Quelle est l'originalité du modèle allemand? Quels sont
les facteurs qui ont rendu l'émergence du modèle possible? Celui-ci est-il en fin de course?
I En quoi y a-t-il un modèle allemand ?
A/ Description.
1/ Le modèle allemand s'inscrit dans un cadre capitaliste, mais avec des particularités qui l'opposerait à
un autre modèle type : le modèle américain.
Dans le modèle allemand, les entreprises comptent plus sur
les banques que sur la Bourse des valeurs pour leur financement.
2/ Le modèle repose sur une industrie compétitive et performante.
De grandes entreprises s'appuyent
pour la sous-traitance sur un réseau très dense de petites et moyennes entreprises et accordent une
grande importance à l'innovation (1" rang en Europe pour la recherche et le développement).
3/ L'État joue un rôle de régulateur dans les relations sociales et les relations économiques, au point
que l'on parle en Allemagne d'économie sociale de marché.
L'État providence en place dès le XIX' siècle
assure une protection sociale très importante sans égal dans les pays industrialisés.
B/ Une forte institutionnalisation des rapports sociaux.
1/ La « cogestion , dans les entreprises existe depuis 1951 : les représentants syndicaux des salariés
sont présents dans les organes de direction des entreprises.
2/ Les salariés sont fortement syndiqués dans le DGB.
Des structures de concertation permettent la
conclusion de compromis et évitent les conflits sociaux importants (cela signifie aussi une
réglementation très contraignante du droit de grève, auquel les syndicats n'ont qu'exceptionnellement
recours).
3/ Depuis les années 60, cela a conduit la main-d'œuvre allemande a être la plus chère de tous les pays
industrialisés (32 dollars par heure en Allemagne, 19, 5 en France et 18 aux États-Unis) et celle qui
travaille le moins longtemps.
4/ Un des aspects du modèle, c'est le système de formation en alternance qui assure aux apprentis un
emploi dans l'entreprise.
Transition Les facteurs qui ont rendu possible le modèle allemand sont étroitement liés aux facteurs
conjoncturels et aux structures socio-économiques.
II Qu'est-ce qui a rendu possible le modèle allemand ?
A/ Les facteurs conjoncturels.
1/ L'Allemagne vaincue militairement se retrouve sous la protection américaine et peut donc se passer
de budget militaire.
2/ Elle bénéficie en outre de l'aide du plan Marshall bien qu'elle soit un pays vaincu.
En effet, les États
Unis, inquiets de l'éventuelle contagion communiste depuis l'Allemagne orientale voisine, lui octroient
le bénéfice de l'ERP.
B/ Les structures socio-économiques.
•
•
! 60
1/ Le mode de financement est assuré par les banques, qui ont toujours été soucieuses d'assurer la
rentabilité à long terme en favorisant l'investissement plutôt que la redistribution des dividendes.
2/ Une monnaie forte (véritable dogme depuis les années 50) a permis de réduire le prix des matières
premières et de l'énergie importée.
3/ Des exportations excédentaires (depuis 1952): l'Allemagne fondant sa stratégie commerciale sur la
qualité de ses produits et de son service après-vente plutôt que sur des prix bas.
Sa stratégie
commerciale a été facilitée par le fait que l'Allemagne exporte surtout des biens d'équipement
(beaucoup moins de concurrence que pour les biens de consommation)
Transition Depuis les crises des années 70, certains facteurs qui avaient fait la puissance du modèle
allemand connaissent quelques fissures.
Par ailleurs, l'inattendue réunification est venue aggraver
certaines difficultés.
A/ Un modèle de temps de croissance en temps de crise.
1/ Mis en place dans une période de forte croissance, le modèle allemand doit faire face à une période
de croissance ralentie.
2/ La baisse de la compétitivité, due à la crise, pousse à la remise en cause des avantages acquis des
salariés allemands.
3/ La montée du chôma�e traduit les difficultés: le système de l'apprentissage notamment est remis en
cause, dans la mesure ou les employeurs garantissent de moins en moins l'embauche de l'apprenti.
4/ La baisse des exportations pose directement la question des délocalisations autant pour pénétrer de
nouveaux marchés que pour aller à la rencontre d'une main-d'œuvre meilleur marché (la question se
pose d'autant plus que l'effondrement des régimes en Europe centrale a ouvert un'bassin de main
d'œuvre moins chère et relativement qualifiée).
Le patronat allemand rêve de «flexibilité, pour
abaisser le coût de la main-d'œuvre.
B/ Fin de l'�tat providence ?
1/ La tendance est aux restrictions budgétaires liées à la nécessité de respecter les critères de passage à
la monnaie unique.
Cela se traduit par une politique d'austérité (réduction des dépenses de santé et
recul de l'âge de la retraite).
2/ Le vieillissement de la population est un facteur supplémentaire qui pousse l'ftat providence à
réduire ses prestations.
3/ La réunification, en coûtant beaucoup plus cher que prévu, a contribué à réduire les dépenses
sociales.
4/ La puissance des syndicats est entamée par le chômage et par la difficulté que ceux-ci ont à
syndiquer les jeunes et les salariés des nouvelles industries de pointe.
En conclusion Le modèle social et économique allemand a permis à l'Allemagne vain
cue de se redresser sur un État socialement et économiquement régulateur et sur une paix socia
le assurée par un haut niveau de vie....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓