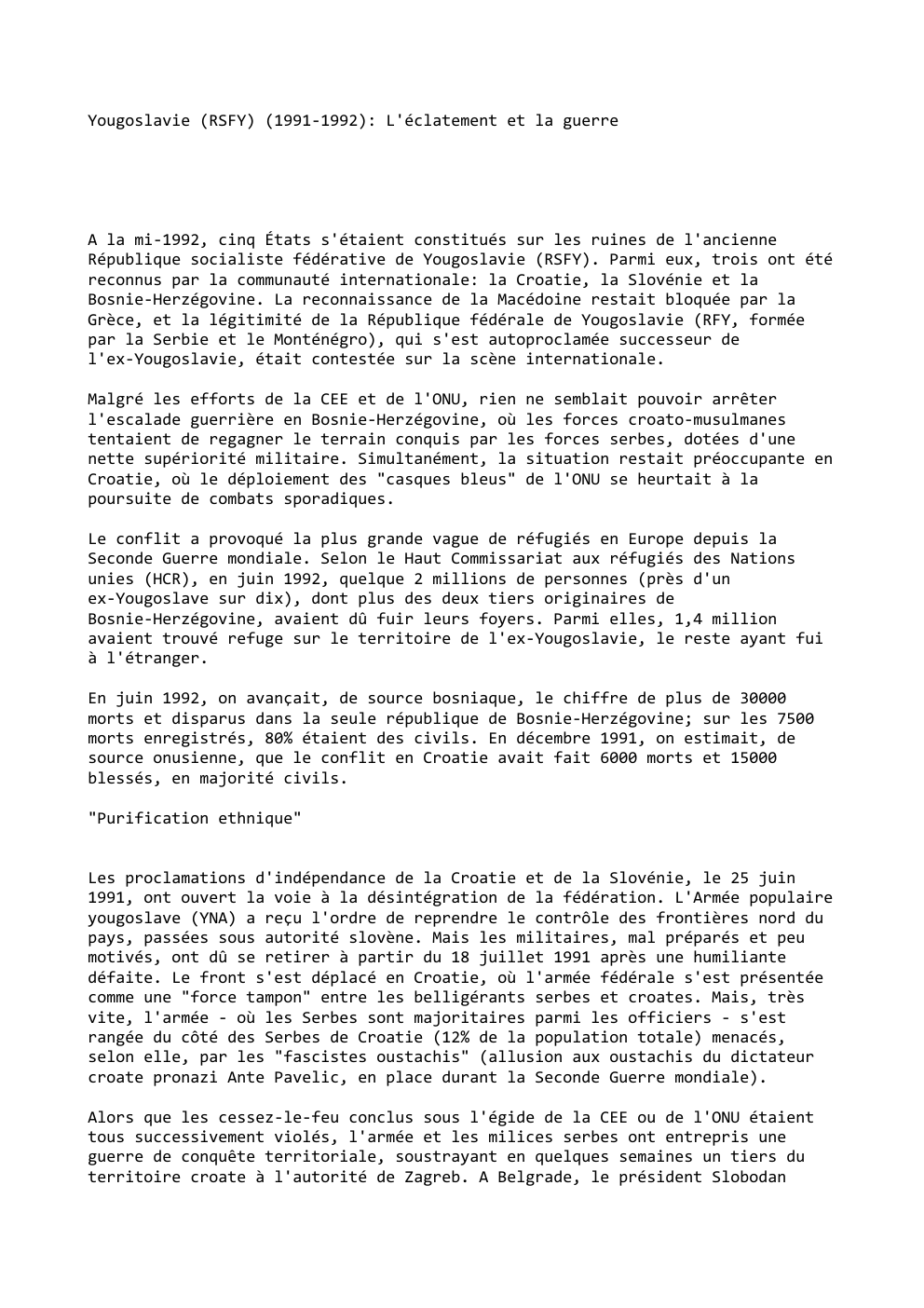Yougoslavie (RSFY) (1991-1992): L'éclatement et la guerre A la mi-1992, cinq États s'étaient constitués sur les ruines de l'ancienne République...
Extrait du document
«
Yougoslavie (RSFY) (1991-1992): L'éclatement et la guerre
A la mi-1992, cinq États s'étaient constitués sur les ruines de l'ancienne
République socialiste fédérative de Yougoslavie (RSFY).
Parmi eux, trois ont été
reconnus par la communauté internationale: la Croatie, la Slovénie et la
Bosnie-Herzégovine.
La reconnaissance de la Macédoine restait bloquée par la
Grèce, et la légitimité de la République fédérale de Yougoslavie (RFY, formée
par la Serbie et le Monténégro), qui s'est autoproclamée successeur de
l'ex-Yougoslavie, était contestée sur la scène internationale.
Malgré les efforts de la CEE et de l'ONU, rien ne semblait pouvoir arrêter
l'escalade guerrière en Bosnie-Herzégovine, où les forces croato-musulmanes
tentaient de regagner le terrain conquis par les forces serbes, dotées d'une
nette supériorité militaire.
Simultanément, la situation restait préoccupante en
Croatie, où le déploiement des "casques bleus" de l'ONU se heurtait à la
poursuite de combats sporadiques.
Le conflit a provoqué la plus grande vague de réfugiés en Europe depuis la
Seconde Guerre mondiale.
Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations
unies (HCR), en juin 1992, quelque 2 millions de personnes (près d'un
ex-Yougoslave sur dix), dont plus des deux tiers originaires de
Bosnie-Herzégovine, avaient dû fuir leurs foyers.
Parmi elles, 1,4 million
avaient trouvé refuge sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, le reste ayant fui
à l'étranger.
En juin 1992, on avançait, de source bosniaque, le chiffre de plus de 30000
morts et disparus dans la seule république de Bosnie-Herzégovine; sur les 7500
morts enregistrés, 80% étaient des civils.
En décembre 1991, on estimait, de
source onusienne, que le conflit en Croatie avait fait 6000 morts et 15000
blessés, en majorité civils.
"Purification ethnique"
Les proclamations d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, le 25 juin
1991, ont ouvert la voie à la désintégration de la fédération.
L'Armée populaire
yougoslave (YNA) a reçu l'ordre de reprendre le contrôle des frontières nord du
pays, passées sous autorité slovène.
Mais les militaires, mal préparés et peu
motivés, ont dû se retirer à partir du 18 juillet 1991 après une humiliante
défaite.
Le front s'est déplacé en Croatie, où l'armée fédérale s'est présentée
comme une "force tampon" entre les belligérants serbes et croates.
Mais, très
vite, l'armée - où les Serbes sont majoritaires parmi les officiers - s'est
rangée du côté des Serbes de Croatie (12% de la population totale) menacés,
selon elle, par les "fascistes oustachis" (allusion aux oustachis du dictateur
croate pronazi Ante Pavelic, en place durant la Seconde Guerre mondiale).
Alors que les cessez-le-feu conclus sous l'égide de la CEE ou de l'ONU étaient
tous successivement violés, l'armée et les milices serbes ont entrepris une
guerre de conquête territoriale, soustrayant en quelques semaines un tiers du
territoire croate à l'autorité de Zagreb.
A Belgrade, le président Slobodan
Milosevic, ancien communiste "reconverti" au nationalisme, n'a cessé de soutenir
le "droit des Serbes à vivre dans un seul État", tandis que, dès la fin 1991, un
plan de "purification ethnique" se mettait en place en Croatie, avec le
relogement de réfugiés serbes dans des régions vidées de leurs habitants
croates.
A l'issue du moratoire de trois mois demandé par la CEE, la Slovénie et la
Croatie ont confirmé, le 8 octobre 1991, leurs déclarations d'indépendance.
Le 4
novembre, la Serbie rejetait le plan proposé par les Douze dans le cadre de la
conférence pour la paix en Yougoslavie et, le 8 novembre, alors que les combats
s'étendaient en Croatie, la CEE décrétait des sanctions économiques contre la
Yougoslavie, lesquelles ont ensuite été levées sauf pour la Serbie et le
Monténégro.
Serbes et Croates ont signé, le 3 janvier 1992, le quinzième cessez-le-feu.
Cette trêve, la première à être globalement respectée, a marqué l'arrêt des
bombardements massifs en Croatie.
De ce fait, le Conseil de sécurité des Nations
unies, qui avait conditionné l'envoi de "casques bleus" au respect de la trêve,
a voté le 21 février une résolution autorisant le déploiement de 14000 hommes
dans quatre "zones protégées" de Croatie, tenues par les Serbes.
Après de longues tergiversations, la CEE a donné son feu vert à la
reconnaissance de la Croatie et de la Slovénie, déjà reconnues de fait par
l'Allemagne, et a conditionné celle de la Bosnie-Herzégovine à la tenue d'un
référendum sur l'avenir de la république.
Estimant avoir "gelé" leurs conquêtes
en Croatie grâce au déploiement des "casques bleus", l'armée s'est repliée en
Bosnie-Herzégovine.
Les premiers affrontements opposant les forces serbes aux
forces croato-musulmanes ont éclaté au lendemain du référendum sur
l'indépendance (29 février-1er mars 1992) qui, boycotté par les Serbes, a été
marqué par une large victoire du "oui".
Le 6 avril 1992, la CEE, suivie le lendemain par les États-Unis, a....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓