ALAIN, Les dieux, ch. VI, Bourgeoisie
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
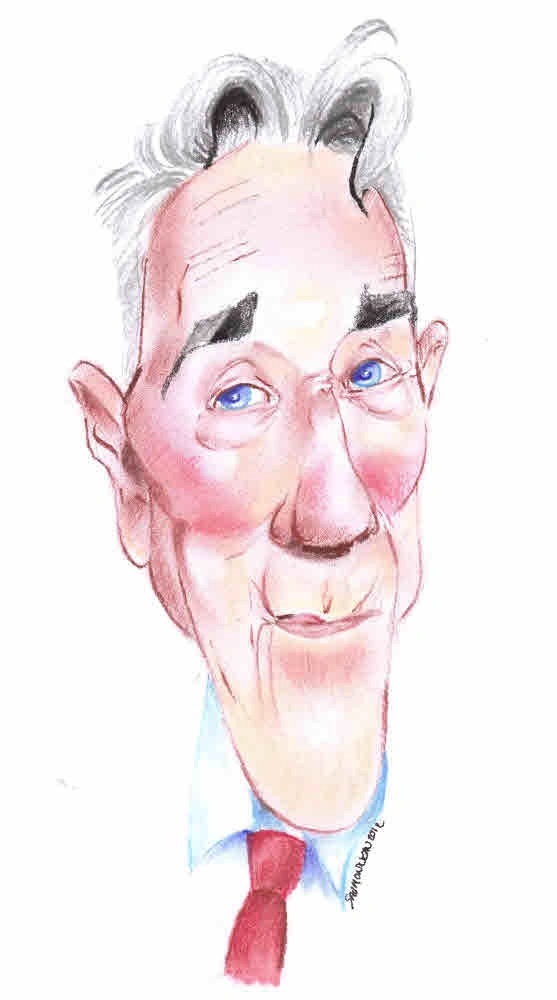
Bourgeois c'est habitant de la ville; et ce mot dit bien ce qu'il veut dire. Il oppose le commerce
aux métiers, et d'abord au métier essentiel, qui est aux champs. L'opposition si naturelle entre
bourgeois et paysans s'est étendue aux ouvriers du bois, et de là aux ouvriers du charbon et de la
mine ; et la définition de bourgeois n'est point changée par là, mais au contraire confirmée. Est
bourgeois ce qui vit de persuader. Le commerçant en sa boutique, le professeur, le prêtre,
l'avocat, le ministre, ne font pas autre chose. Vous ne les voyez point changer la face de la terre,
ni transporter les objets. Ce qui résiste à eux ce n'est point l'objet, c'est l'homme; et de là naissent
et renaissent d'étonnants préjugés, qui ne sont au fond que l'enfance continuée. Le bourgeois
mûrit par l'art de faire marcher les nourrices; et cet art est bien profond dans un roi ; mais ce n'est
toujours qu'une enfance plus habile, et une meilleure baguette d'enchanteur. J'admire un ministre
posant une première pierre ; ce maçon me ravit. Réellement par des discours seulement, il
transporte des pierres. À cet étrange métier on n'apprend point qu'il y a des pierres. Pourquoi
s'étonner des contes ? Il y a tant d'hommes pour qui les palais s'élèvent au commandement. Mais
aussi y a-t-on mis, dans les premiers fondements, quelques monnaies, qui sont en effet le signe.
Cette magie est réelle; et payer n'instruit pas. Mais cuire le repas des moissonneurs, et le leur
porter, c'est encore payer, et cela instruit. N'admirez-vous pas l'enfant qui accompagne la
servante, et qui porte aussi par jeu quelque salière, ou bien la cuiller à soupe ? Tel est ce
bourgeois, toujours tangent au réel. Et nous fûmes tous bourgeois; même les fils d'ouvriers le
sont. Et tout ouvrier le redevient dès qu'il se marchande, car c'est persuader. Je ne parle pas des
négociateurs et chefs de revendication, car ils sont bourgeois tout à fait, et plus que jamais dans
le moment où ils prétendent l'être le moins. Ce mélange de fictions et de réalités qui est la suite
de cette double situation enferme le secret de toutes nos querelles. Les guerres sont toutes de
religion ; mais cela est refusé par tous. Il nous manque de savoir sur quoi nous nous trompons
naturellement, et pourquoi. On aperçoit à ce tournant qu'il s'en faut bien que nos erreurs soient
seulement souvenirs d'enfance. Le spectacle du monde et la vie de société expliqueraient encore
tous les pièges d'imagination, et tous les degrés de religion, qui sont toujours tous ensemble dans
la moindre de nos pensées. Seulement l'enfance est plus à découvert ; et par l'enfance nous
comprenons que nous sommes tous mal partis et qu'il n'en peut être autrement. C'est seulement
en ce sens que le secret des dieux se trouve dans les contes ; et cette première richesse a été
amplement développée, d'après la situation bourgeoise. Mais je dois dire maintenant, ce qui
apparaîtra à sa place dans le développement même, que la situation bourgeoise, et déjà
l'enfantine, développe aussi de précieuses idées, sans lesquelles l'adhérente pensée prolétarienne,
celle qui se, trompe le moins, ne serait jamais parvenue à la conscience d'elle-même. L'animal ne
se trompe jamais ; l'animal n'a point d'autels, ni de statues, ni de faux dieux ; c'est pourquoi il
dort et dormira toujours.
Tout est de religion dans la vie bourgeoise ; c'est que demander et persuader n'ont point de
règles assignables ; tout dépend de l'opinion de celui qu'on veut persuader ; et il y a risque,
évidemment, à négliger un artifice de forme dont on ne voit pas l'utilité. Qui veut être poli n'est
jamais assez poli. C'est pourquoi tous les usages sont outils dans ce métier de demander. Et au
contraire le prolétaire méprise la politesse ; c'est qu'il n'obtient rien par politesse, rien de la terre,
rien du fer, rien du plomb. C'est que le problème bourgeois est le partage des biens, au lieu que le
problème prolétarien et paysan est de les produire. Au reste on est toujours commerçant un peu.
On comprend que le mendiant soit en quelque sorte le pur bourgeois ; car il n'obtient que par un
art de demander, par des signes émouvants ; les haillons parlent. Et le chômeur, par les mêmes
causes, est aussitôt déporté en bourgeoisie. Je ne fais ici que développer l'idée de Marx, d'après
laquelle toutes les connaissances, tous les sentiments et toute la religion d'un homme résultent de
la manière dont il gagne sa vie. Mais cette pensée elle-même a grand besoin d'être appliquée ; ou
bien ce n'est qu'une vision comme une autre. Le prolétaire, autant qu'il vit et pense selon le
travail réel, le travail contre la chose, est naturellement irréligieux. Mais aussi il n'y a pas de
prolétaire pur. Et encore faut-il dire que le risque du prolétaire pur est de se tromper sur la
politesse, sur les signes, sur le crédit, sur la persuasion, et en un mot sur la religion elle-même.
C'est qu'il ne la pense pas vraie. Et il faut, comme j'en ai averti en commençant, que tout soit vrai
finalement ; le non-être n'est rien et ne fait rien.
Tout contrat est un arrangement de signes, qui recouvre une organisation des travaux. Le
premier côté est bourgeois, l'autre est prolétarien. Un procès se meut dans les signes, et veut
accorder les signes ; mais il arrive quelquefois aussi que le tribunal se transporte sur les lieux
mêmes ; c'est réduire l'imagination, ou, pour mieux dire, l'incantation. Toutefois l'excédent, dans
les travaux humains, est tel, que la coutume enfantine, d'agir par signes et sur les signes, suffit à
beaucoup, et longtemps. D'où une dialectique qui est proprement bourgeoise, et que l'on doit
nommer idéaliste. Ce genre de pensée, considéré en sa perfection, consiste à travailler sur les
conceptions mêmes de l'esprit, qui dans le fait ne sont que discours ; le péril du discours c'est la
contradiction ; et le salut du discours c'est la conciliation. Les utopies, comme on voit dans
Jaurès le professeur, consistent premièrement à arranger des discours. Est-il vrai ou n'est-il pas
vrai qu'un arrangement social par contrat explicite, et s'étendant à tout, soit contraire au
développement de l'individu selon ses puissances ? Je ne vois pas, dit le philosophe, qu'on soit
forcé de nier l'un si l'on affirme l'autre ; et je le prouve en affirmant les deux. Telle est la
rhétorique à l'état de pureté ; et elle ne fait pas peu dans les querelles, qui se développent en
discours mal faits. Je trouve admirable que tant d'hommes se soient jugés incapables de changer
le cours des événements, même à portée de leur main, seulement parce que les mots
s'arrangeaient mal. C'est mourir pour la grammaire. Et, au rebours, Pangloss se console de tout
par d'autres discours ; et ce grammairien héroïque n'est pas si loin qu'on pourrait croire de
l'illustre Leibniz, le plus habile des conciliateurs. Toutefois il faut bien en venir à rendre compte
de l'irritation ou de la conciliation par quelque humeur plus ou moins durable. Leibniz avait du
bonheur ; et notre bilieux déterministe n'en a pas assez. L'enfant cesse de crier par la chanson,
mais encore mieux si on le retourne et si on le met au bain. On soupçonne donc que la connexion
apparente des discours, par oui, non, et distinguo, recouvre un autre enchaînement qui se fait
dans la gorge, dans les poumons, et dans tout le corps. C'est de même que la vraie cause du
biberon, n'est pas qu'on l'appelle avec pleurs et cris. Mais la puérilité est toujours bien forte, et se
retrouve toute dans le plus haut sérieux, quand l'objet ne répond jamais, et est tout supposé. Kant
a osé dire, ce qui est aussitôt évident, qu'un arrangement de mots, si parfait qu'il soit, n'annonce
nullement un arrangement des choses ; ce qui d'avance précipitait pour toujours l'argument des
arguments, qui essaie de faire une existence par l'assemblage, en un discours, de toutes les
perfections qu'on peut ou qu'on pourrait dire.
Le peuple sent assez bien le vide de ces discours ; ce serait le ramage des grands enfants qu'il
nourrit et qu'il porte à bras. Mais le peuple soupçonne autre chose, c'est que ce prétendu jeu est la
traduction fort sérieuse d'un état de fait qui s'étend au delà des humeurs et jusqu'aux sources des
humeurs, qui sont nourritures, maisons, chaleur, lumière, et autres biens. Car il faut que les mots
procurent des choses, et telle serait l'ontologie. D'où quelques penseurs obstinés ont formé l'idée
d'une dialectique qu'ils nomment très bien matérialiste, d'après laquelle tous les systèmes
théologiques traduisent une certaine manière de vivre, et exactement un certain métier. On sait
qu'il y a un dieu de chaque métier. Seulement le lien des travaux aux croyances est bien plus
serré que les croyants ne le savent. Et puisque le philosophe exprime naïvement, en ses paroles,
qu'il vit de paroles, il faut une philosophie de la philosophie. On n'a pas fini d'apercevoir
comment l'inférieur porte le supérieur. Il est pourtant vrai que le matérialisme est le seul soutien
de l'esprit. Et c'est ce que la doctrine des religions doit rendre évident, par d'agrestes chemins. Le
dieu Terme règne sur les villes, mais son vrai visage, qui est sans visage, apparaît au coin du
champ.
Liens utiles
- DIEUX (LES), 1934. Alain (Émile Auguste Chartier, dit) - résumé de l'œuvre
- DIEUX (Les) d’Alain (Émile Chartier) (résumé et analyse)
- ALAIN : LES DIEUX (Résumé & Analyse)
- "Le propre du travail, c'est d'être forcé." Alain, les Arts et les dieux, 1943. Commentez cette citation.
- Le corps humain est le tombeau des dieux. Système des beaux-arts Alain, Emile-Auguste Chartier, dit. Commentez cette citation.


