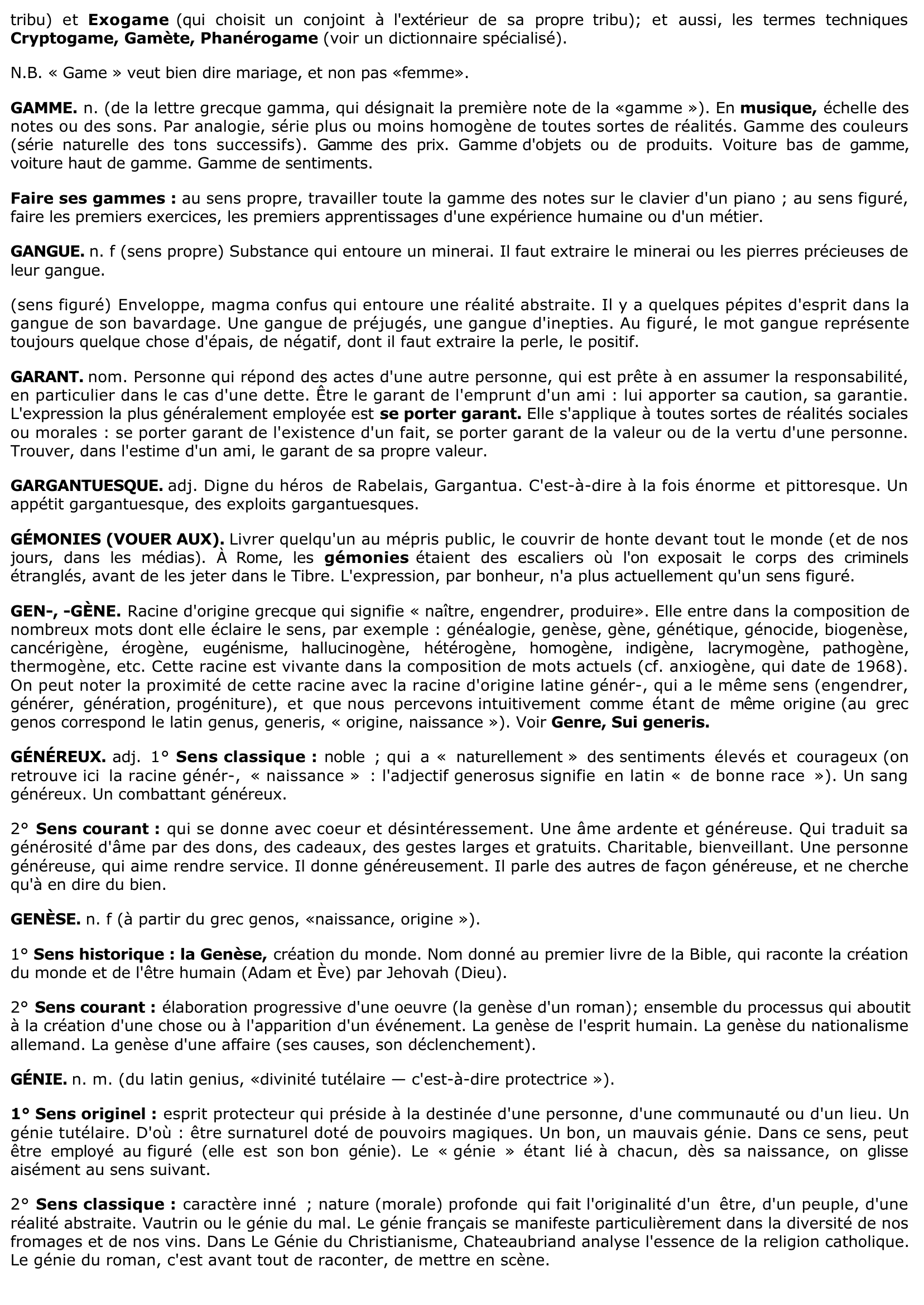DICTIONNAIRE: de GAGE à GYNÉCO
Publié le 13/08/2010

Extrait du document
GAGE. n. m. (du francique waddi) 1° Sens juridique : objet, bien ou valeur que l'on dépose à titre de garantie dans le cadre d'une opération commerciale (prêt sur gage, par exemple). L'objet gagé restera entre les mains du créancier si l'emprunteur ne le rembourse pas. Au XIX° siècle, les gens qui avaient un besoin immédiat d'argent déposaient des objets de valeur au mont-de-piété, en échange desquels on leur prêtait la somme dont ils avaient besoin : ces objets servaient précisément de gage; ils n'étaient restitués que lorsque l'argent était rendu. La notion de gage suppose donc toujours un échange et l'engagement d'un bien comme caution. Lorsque l'on parle de « gage « dans un jeu de société, l'idée reste la même : pour recouvrer un avantage que l'on a perdu, on donne quelque chose en échange, on s'acquitte par une peine plus au moins symbolique. 2° Sens figuré : garantie, assurance, caution morale. Gage de fidélité. Gage d'amour. Au sens figuré, le gage suppose toujours un échange symbolique, auquel on apporte une garantie plus ou moins concrète : un objet de valeur sentimentale, une manifestation de tendresse, un service. On « engage « toujours quelque chose à titre de garantie, même s'il s'agit d'une réalité morale : le verbe engager signifie littéralement mettre en gage. Lorsqu'il s'agit de s 'engager dans une entreprise, une action militante ou une décision, c'est soi-même que l'on apporte comme gage, comme garantie. Jadis, gager, au sens de parier, signifiait de même mettre en gage son argent ou sa parole : on risquait sa réputation ou sa fortune pour bien montrer son assurance. 3° Au pluriel, les gages : salaire d'un domestique (en échange des services qu'il rend). L'idée d'échange demeure, les gages représentant la garantie financière équivalant au service rendu. Idem dans l'expression Tueur à gages (le paiement n'est donné qu'à condition que l'assassinat soit dûment effectué). N.B. Le mot gage est intéressant à connaître en raison de l'éclairage qu'il apporte aux mots de même famille : gageure, engager, dégager, etc. GAGEURE. n. (à partir du verbe gager, « parier «. Prononcer « gajure«). Action quasi irréalisable, projet très risqué; opinion ou hypothèse hautement improbable. Se lancer dans la traversée de la mer avec une simple barque, c'est une véritable gageure. Se fier à l'humanité d'un dictateur, quelle gageure ! On retrouve dans ce mot l'idée d'engagement, de risque, de pari aventureux. GALANT. nom. Homme qui aime faire la cour aux femmes. Soupirant, partenaire amoureux. adj. 1° Relatif à la galanterie. Se dit d'un homme empressé auprès des femmes, ou simplement courtois, poli, attentionné. Il est galant et délicat. 2° Qui concerne les relations amoureuses. Des propos galants. La poésie galante. Une entreprise galante. En galante compagnie. Une femme galante (de moeurs légères). 3° En littérature (et en arts) : qui relève d'un ton raffiné, léger, gracieux. «Ah ! qu'en termes galants ces choses-là sont dites « (Molière). Le style galant. L'atmosphère galante des toiles de Watteau. GALIMATIAS. n. m. Langage embrouillé, écrit inintelligible. Qu'est-ce que c'est que ce galimatias : vous appelez cela un résumé de texte ? Charabia, style abscons (quasi incompréhensible). GALLICANISME. n. m. (à partir du latin médiéval gallicanus, «gaulois «) Historiquement, en France, opposition de l'Eglise catholique à l'autorité excessive du Pape. Cette résistance au pouvoir de Rome avait notamment pour enjeu la nomination des évêques, sur laquelle le pouvoir royal et le pouvoir papal étaient en conflit. Plus globalement, c'est l'indépendance de l'Église de France en matière institutionnelle et liturgique qui était en question au XVIIe siècle. Au gallicanisme s'opposait l'ultramontanisme, mouvement favorable au pouvoir absolu du Pape dans la gestion politique et administrative de l'Église de France (ultramontain veut dire textuellement «au-delà des monts «, c'est-à-dire des Alpes). Comme l'a montré la querelle de Port-Royal, le débat ne porte pas seulement sur des problèmes institutionnels, mais sur la forme même de la sensibilité religieuse : les Jansénistes s'inscrivaient dans le mouvement de résistance gallicane à la hiérarchie romaine, alors que les Jésuites étaient des partisans convaincus de l'ultramontanisme. N.B. Ne pas confondre avec Gallicisme (tournure ou expression propre à la langue française, qu'on peut trouver dans une autre langue — comme l'anglais !). GALVAUDER. y. tr. Gâter quelque chose de valeur par un mauvais usage, par un emploi dégradant. Galvauder son talent dans des articles de circonstance. Galvauder son esprit dans des plaisanteries faciles. Galvauder sa réputation en fréquentant des individus peu recommandables. Une expression galvaudée (usée). Se galvauder : s'abaisser, se dégrader. -GAME, -GAMIE. Racines d'origine grecque signifiant « mariage «, et parfois « reproduction « (termes botaniques). On trouve ainsi Bigame (qui a deux conjoints simultanément) et Bigamie ; Polygame (qui contracte légitimement plusieurs mariages : homme ayant plusieurs femmes ou femme ayant plusieurs maris) et Polygamie ; Monogame (qui ne contracte qu'un mariage, n'a qu'un seul conjoint) et Monogamie, Endogame (qui se marie dans sa propre tribu) et Exogame (qui choisit un conjoint à l'extérieur de sa propre tribu); et aussi, les termes techniques Cryptogame, Gamète, Phanérogame (voir un dictionnaire spécialisé). N.B. « Game « veut bien dire mariage, et non pas «femme«. GAMME. n. (de la lettre grecque gamma, qui désignait la première note de la «gamme «). En musique, échelle des notes ou des sons. Par analogie, série plus ou moins homogène de toutes sortes de réalités. Gamme des couleurs (série naturelle des tons successifs). Gamme des prix. Gamme d'objets ou de produits. Voiture bas de gamme, voiture haut de gamme. Gamme de sentiments. Faire ses gammes : au sens propre, travailler toute la gamme des notes sur le clavier d'un piano ; au sens figuré, faire les premiers exercices, les premiers apprentissages d'une expérience humaine ou d'un métier.
GANGUE. n. f (sens propre) Substance qui entoure un minerai. Il faut extraire le minerai ou les pierres précieuses de leur gangue.
(sens figuré) Enveloppe, magma confus qui entoure une réalité abstraite. Il y a quelques pépites d'esprit dans la gangue de son bavardage. Une gangue de préjugés, une gangue d'inepties. Au figuré, le mot gangue représente toujours quelque chose d'épais, de négatif, dont il faut extraire la perle, le positif.
GARANT. nom. Personne qui répond des actes d'une autre personne, qui est prête à en assumer la responsabilité, en particulier dans le cas d'une dette. Être le garant de l'emprunt d'un ami : lui apporter sa caution, sa garantie. L'expression la plus généralement employée est se porter garant. Elle s'applique à toutes sortes de réalités sociales ou morales : se porter garant de l'existence d'un fait, se porter garant de la valeur ou de la vertu d'une personne. Trouver, dans l'estime d'un ami, le garant de sa propre valeur. GARGANTUESQUE. adj. Digne du héros de Rabelais, Gargantua. C'est-à-dire à la fois énorme et pittoresque. Un appétit gargantuesque, des exploits gargantuesques. GÉMONIES (VOUER AUX). Livrer quelqu'un au mépris public, le couvrir de honte devant tout le monde (et de nos jours, dans les médias). À Rome, les gémonies étaient des escaliers où l'on exposait le corps des criminels étranglés, avant de les jeter dans le Tibre. L'expression, par bonheur, n'a plus actuellement qu'un sens figuré. GEN-, -GÈNE. Racine d'origine grecque qui signifie « naître, engendrer, produire«. Elle entre dans la composition de nombreux mots dont elle éclaire le sens, par exemple : généalogie, genèse, gène, génétique, génocide, biogenèse, cancérigène, érogène, eugénisme, hallucinogène, hétérogène, homogène, indigène, lacrymogène, pathogène, thermogène, etc. Cette racine est vivante dans la composition de mots actuels (cf. anxiogène, qui date de 1968). On peut noter la proximité de cette racine avec la racine d'origine latine génér-, qui a le même sens (engendrer, générer, génération, progéniture), et que nous percevons intuitivement comme étant de même origine (au grec genos correspond le latin genus, generis, « origine, naissance «). Voir Genre, Sui generis. GÉNÉREUX. adj. 1° Sens classique : noble ; qui a « naturellement « des sentiments élevés et courageux (on retrouve ici la racine génér-, « naissance « : l'adjectif generosus signifie en latin « de bonne race «). Un sang généreux. Un combattant généreux. 2° Sens courant : qui se donne avec coeur et désintéressement. Une âme ardente et généreuse. Qui traduit sa générosité d'âme par des dons, des cadeaux, des gestes larges et gratuits. Charitable, bienveillant. Une personne généreuse, qui aime rendre service. Il donne généreusement. Il parle des autres de façon généreuse, et ne cherche qu'à en dire du bien. GENÈSE. n. f (à partir du grec genos, «naissance, origine «). 1° Sens historique : la Genèse, création du monde. Nom donné au premier livre de la Bible, qui raconte la création du monde et de l'être humain (Adam et Ève) par Jehovah (Dieu). 2° Sens courant : élaboration progressive d'une oeuvre (la genèse d'un roman); ensemble du processus qui aboutit à la création d'une chose ou à l'apparition d'un événement. La genèse de l'esprit humain. La genèse du nationalisme allemand. La genèse d'une affaire (ses causes, son déclenchement). GÉNIE. n. m. (du latin genius, «divinité tutélaire — c'est-à-dire protectrice «). 1° Sens originel : esprit protecteur qui préside à la destinée d'une personne, d'une communauté ou d'un lieu. Un génie tutélaire. D'où : être surnaturel doté de pouvoirs magiques. Un bon, un mauvais génie. Dans ce sens, peut être employé au figuré (elle est son bon génie). Le « génie « étant lié à chacun, dès sa naissance, on glisse aisément au sens suivant. 2° Sens classique : caractère inné ; nature (morale) profonde qui fait l'originalité d'un être, d'un peuple, d'une réalité abstraite. Vautrin ou le génie du mal. Le génie français se manifeste particulièrement dans la diversité de nos fromages et de nos vins. Dans Le Génie du Christianisme, Chateaubriand analyse l'essence de la religion catholique. Le génie du roman, c'est avant tout de raconter, de mettre en scène. 3° Sens courant : capacité artistique ou intellectuelle hors du commun. Il a du génie. Un auteur de génie. Le génie seul est créateur: tout le reste n'est qu'imitation, reproduction, technique. Le génie mathématique, le génie musical, le génie poétique. Le génie militaire de Napoléon. Dans ce sens, on oppose traditionnellement le talent (qui suppose de bonnes aptitudes, alliées à de la maîtrise) au génie (qui dépasse par son caractère extraordinaire, neuf, inventif, le simple talent).
4° Sens technique : art de la construction. Le génie militaire, le génie civil (cf. le mot ingénieur).
GÉNITAL (STADE). En psychanalyse, le stade génital (ou phallique) est le troisième stade que traverse la sexualité infantile au cours de son évolution. Le premier est le stade oral, au cours duquel le bébé découvre les plaisirs liés à la succion (la bouche est la première zone érogène : le nourrisson éprouve le besoin de sucer son pouce pour se sentir bien). Le second stade est le stade anal (ou sadique anal) : le tout petit enfant découvre les plaisirs liés à la maîtrise de son sphincter (rétention ou relâchement); surtout, il prend conscience du pouvoir qu'il a de plaire ou déplaire aux adultes en leur offrant ou non le « cadeau « naturel issu de son transit intestinal. Le troisième stade est le stade phallique ou génital : l'enfant découvre la réalité des organes génitaux et éprouve le plaisir de les tripoter. Les pulsions sexuelles « investissent «, dit-on, la zone génitale. C'est aussi le point de départ de la prise de conscience, chez les garçons et les filles, des différences anatomiques qui vont les distinguer sexuellement. GENRE. n. m. (du latin genus, generis, «race, naissance, origine «). 1° Sens général : ensemble d'êtres, d'objets, ou de réalités abstraites qu'on regroupe en vertu de caractères communs. Espèce. L'ensemble des animaux pensants qui offrent les caractères de l'homme s'appellera le genre humain. En zoologie, en botanique, plusieurs espèces voisines pourront être regroupées en un genre : la classe des mammifères, le groupe des bipèdes peuvent être considérés comme des genres. Naturellement, selon les traits communs qui servent de critères distinctifs, la notion de genre peut être très large ou assez restreinte. Ainsi, le mot genre s'applique parfois à un type de vie (le genre bohème), à une manière de s'habiller ou de se présenter socialement (bon chic bon genre), à une espèce d'individus ayant une conduite peu honorable (« C'est le genre d'individus à faire ceci ou cela «). 2° Sens littéraire et artistique : catégorie d'oeuvres que l'on rassemble à partir de critères divers, qui peuvent être le ton (genre noble, genre mineur), le sujet ou la nature du contenu (genre didactique, lyrique, dramatique, épique), la structure formelle (récit, théâtre, poésie), l'effet recherché (comique, tragique, burlesque). Dans la classification des genres, il est souvent difficile de distinguer les caractères formels de la nature des sujets traités : les « grands genres « portaient souvent, historiquement, sur de « grands sujets «, avec un ton relevé (tragédie, épopée, poésie didactique ou lyrique). On peut se demander si des genres établis, comme la poésie, constituent absolument un genre spécifique. La poésie tient-elle à la versification, aux effets d'images et de sonorités (critère forme) ou bien dépend-elle surtout de l'inspiration, de la capacité à faire rêver, de « l'imaginaire« d'un auteur (qu'il s'exprime en vers, en prose, dans le roman ou le théâtre)? Cette problématique donne lieu à d'infinis sujets de dissertation. La question se complique d'ailleurs du fait qu'il y a des genres à l'intérieur des genres : le genre du « sonnet «, par exemple, à l'intérieur du genre poésie. Il y a aussi des genres mixtes. La chanson est-elle un genre littéraire? Oui pour la « chanson à texte«, mais encore? Retenons de ce débat qu'il y a des aspects, des critères de classification, certes ; il y a aussi quelques pôles ayant une spécificité bien reconnaissable (le genre narratif, le roman ; le théâtre). Mais il ne faut rien figer : la plupart des grandes oeuvres sont protéiformes, elles participent de plusieurs genres à la fois. GÉO-. Racine d'origine grecque qui signifie «terre«, et se retrouve à la fin de certains mots sous la forme -gée. De nombreux mots concernant la vie de notre planète (— sa surface, sa dimension, sa mesure ou ses différents aspects —) sont construits à partir de ce radical : Géode, Géodésie, Géographie, Géologie, Géométrie, Géopolitique, Géosphère, Géostationnaire, Géothermie, et aussi Apogée, Périgée. GÉRONTOCRATIE. n. (du grec gerôn, «vieillard«, et kratos, « pouvoir, gouvernement «). Gouvernement exercé par des vieillards; régime politique dans lequel le pouvoir des vieillards est dominant. L'URSS des années 1960-70 était dominée par une gérontocratie. N.B. La racine gerôn se retrouve dans Gériatrie (médecine spécialisée dans la vieillesse), Gérontologie (étude du vieillissement sous tous ses aspects, physiques, psychologiques et sociaux) ou encore dans le nom de Géronte, donné à des vieillards plus ou moins ridicules dans la comédie classique (cf. Les Fourberies de Scapin). GESTE (CHANSON DE). En littérature, poème épique du Moyen Age, retraçant les exploits d'un héros légendaire. La Geste est un cycle de chansons que les troubadours et jongleurs « récitaient « (c'est-à-dire déclamaient avec un accompagnement musical), de château en château. Dans la geste consacrée à Charlemagne, on trouve la célèbre Chanson de Roland. Voir Épopée. GHETTO. n. m. Sens propre : quartier traditionnellement réservé aux Juifs dans les villes européennes. La destruction du ghetto de Varsovie par les nazis, pendant la Seconde guerre mondiale. Par extension, lieu où une communauté, qu'elle soit ou non d'origine étrangère, vit retranchée du reste de la population. Le ghetto noir à New York (Harlem). C'est pour se protéger, et parce qu'ils sont victimes de l'ostracisme de la collectivité, que des communautés particulières forment des ghettos. Sens figuré : lieu ou milieu refermé sur lui-même. Le ghetto culturel. Situation de marginalité. Les artistes d'avant-garde devraient sortir de leur ghetto, mais la société l'accepterait-elle ? GLORIA. n. m. Hymne chrétien qui proclame ou chante la gloire de Dieu. Musique composée sur cette prière. Le Gloria de Vivaldi. Pluriel : des gloria.
GLOS(S). Racine issue du grec glôtta ou glôssa, qui veut dire
« langue«. D'où les mots Glose (notation explicative d'un mot et, par extension, commentaire plus ou moins savant d'un texte), Gloser (commenter un texte; mais aussi, péjorativement, discuter à n'en plus finir), Glossaire (lexique spécialisé dans une langue ancienne, étrangère ou technique), Glotte (orifice du larynx), Polyglotte (qui parle plusieurs langues). Dans Candide, Voltaire s'amuse à nommer l'un de ses personnages, philosophe et métaphysicien, Pangloss (littéralement : celui qui est Tout-langue, qui ne fait que parler partout et toujours, un phraseur impénitent !). GON(E). Racine d'origine grecque qui signifie « angle«, qu'on trouve dans de nombreux mots de la géométrie : diagonale, heptagone, hexagone, octogone, orthogonal, pentagone, polygone, trigonométrie. GOTHIQUE. adj. et n. 1° Le style gothique ou le gothique est une forme d'art qui s'est répandue au Moyen Age, du XII° au XV° siècle. Il se manifeste principalement dans les cathédrales, où on le reconnaît à la forme des voûtes en ogives, qui le différencie de l'art roman. 2° L'écriture gothique (qui, elle aussi, fait suite à l'écriture romane) est une forme d'écriture à caractères droits et légèrement anguleux. Le titre du journal Le Monde est imprimé en lettres gothiques. GOUAILLE. n. f Verve populaire, mi-railleuse mi-pittoresque. Façon de parler traditionnelle des faubourgs parisiens, qui peut être illustrée par le ton sur lequel l'actrice Arletty prononce sa fameuse réplique : «Atmosphère, atmosphère ? Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère ?« Parler d'un ton gouailleur, d'un ton de plaisanterie sans délicatesse mais sans méchanceté. GRÂCE. n. f (du latin gratia, «faveur «, et en latin médiéval, « aide de Dieu «). Faveur que l'on accorde à autrui ou qu'on reçoit d'autrui. Aide, bienfait, bienveillance, plaisir. Mais ce sens général donne lieu à des significations plus précises dans trois domaines. 1° Sens religieux : la grâce est la faveur de Dieu, le don surnaturel que Dieu accorde au croyant qui désire bien se conduire et faire son salut. D'où l'expression Etre en état de grâce (voir cette expression). Plus généralement, le mot grâce peut désigner tous les bienfaits particuliers (spirituels ou matériels) dont Dieu comble ses bons serviteurs. Ces « grâces « supposant de la reconnaissance, le croyant (chrétien) remercie Dieu à son tour par des offrandes ou des prières : il rend grâce, il fait des actions de grâces, et ce sont en quelque sorte des grâces rendues en échange des grâces reçues. 2° Sens juridique : pardon, remise de peine. Un condamné bénéficie dans ce cas d'une faveur de la part des autorités : c'est bien une « grâce« dont il s'agit. Plus généralement, au sens politique, la grâce est la faveur du roi, du président, de l'homme au pouvoir, — la manifestation de sa clémence. On peut tomber en disgrâce, rentrer en grâce, demander grâce. Le roi peut pardonner, faire grâce. Le coup de grâce est le coup qui donne la mort, que demande comme faveur un blessé ou un supplicié qui souffre abominablement. D'où le sens figuré de l'expression coup de grâce : ce qui achève définitivement (moralement ou physiquement) quelqu'un. 3° Sens esthétique : la grâce est le charme, la beauté particulière qui émane de quelqu'un naturellement. C'est comme une faveur de la nature et un agrément (involontaire) que cette personne accorde à ceux qui la côtoient : elle fait « grâce« de sa gracieuse manière d'être... A partir de ce sens, la «grâce« devient une catégorie esthétique s'appliquant aux choses, aux oeuvres d'art, à la musique, à la danse, à la littérature, pour désigner une sorte d'élégance indéfinissable, irréductible à l'explication, alliant beauté, délicatesse, douceur et raffinement (qui peut s'opposer au travail, au métier, à la technique artistique). N.B. Gracieux et gracieusement s'inscrivent naturellement dans le sens général du mot. À titre gracieux, en particulier, signifie «gratuitement «, de façon bénévole. GRADATION. n. f Sens général : progression d'éléments par degrés successifs, selon des valeurs croissantes ou décroissantes. Une gradation d'effets sonores. La gradation des symptômes d'une paralysie. Sens littéraire : succession de mots, dans une phrase, dont les effets (ou les significations) ont une intensité croissante (ou décroissante). La gradation est une figure de style qui unit souvent l'effet rythmique et la progression du sens. Exemples : « Va, cours, vole et nous venge ! « (Corneille, Le Cid); «Je me meurs, je suis mort, je suis enterré « (Molière, L'Avare); «Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue« (Racine, Phèdre). N.B. La gradation progresse toujours, alors que l'accumulation se contente d'un effet chaotique produit par une série de termes disparates. GRAMM(E). Racine issue du grec gramma, « lettre, écriture, tracé que l'on retrouve dans Épigramme (voir ce mot), Grammaire, Gramme (et ses composés), Monogramme, Télégramme ; et aussi Diagramme, Électrocardiogramme, etc. GRANDILOQUENCE. n. f Éloquence pompeuse, constituée de grands mots creux et de tournures emphatiques, avec si possible des tremblements de voix et des gestes factices. La grandiloquence de certains orateurs à l'Assemblée Nationale. Un style grandiloquent et affecté. Voir Emphase.
GRAPHO-. Racine issue du grec graphein, «écrire«. Nous la trouvons dans de nombreux mots, comme préfixe : Graphe (représentation graphique en mathématiques), Graphie (transcription littérale d'un mot), Graphisme (lignes, dessin propre à une écriture ou à l'art graphique), Graphique (courbe, tracé), Graphologie (étude du caractère des individus à partir de leur écriture). Mais comme suffixe, cette racine est encore plus répandue : Autographe, Bibliographique, Biographie, Calligraphie, Dactylographie,
Ethnographie, Filmographie, Géographie, Orthographe, Photographie, Radiographie, etc. Dans tous ces mots, le terme indique soit le fait d'écrire ou de représenter par des tracés, soit le fait de décrire et d'étudier (de répertorier), — toutes activités qui passent par une représentation graphique de la réalité.
GRATITUDE. n. (du latin gratum, «chose agréable«). Sentiment de reconnaissance envers quelqu'un qui nous a rendu service, offert un cadeau, apporté un réconfort, fait du bien moralement ou physiquement. Expression de cette reconnaissance. Comment pourrai-je témoigner de ma gratitude envers tous ceux qui m'ont aidé à composer ce dictionnaire ? Antonyme : ingratitude (mot, hélas, beaucoup plus fréquent). N.B. En langue classique, l'ingrat est celui qui ne répond pas à l'amour qu'on lui porte. GRATUIT. adj. 1° Qui ne coûte rien, que l'on obtient sans payer, qui est offert gracieusement. Un échantillon gratuit. La gratuité des soins à l'hôpital public. Rien de ce qu'il fait n'est vraiment gratuit : il escompte toujours quelque chose en échange. 2° Qui est sans motif, sans raison, purement arbitraire. Vous faites là une hypothèse gratuite. Par extension : qui n'a pas de sens, de motivation apparente. Un acte gratuit. Un héros d'André Gide désire commettre un crime sans raison, au hasard, pour le simple caprice de le commettre au hasard : c'est là un acte gratuit. En fait, cet acte a tout de même comme motif le fait de n'avoir pas de mobile... GRÉ. n. m. (du latin gratum, « chose agréable ii). Acceptation, convenance. Gratitude, reconnaissance. Ce terme ne s'emploie que dans des expressions comme : de bon gré, de mauvais gré (en acceptant bien ou mal); bon gré mal gré (volontairement ou non); de son plein gré (avec sa pleine acceptation); savoir gré à quelqu'un de quelque chose (lui en être reconnaissant). Noter aussi les mots composés : malgré, agréer, agréable, etc. N.B. Ne pas confondre les deux expressions de sens voisin : «Je vous saurai gré « et «je vous serai reconnaissant «. GRÉGAIRE. adj. (du latin grex, gregis, «troupeau «). Se dit des espèces animales qui ont un besoin instinctif de vivre en groupe, comme les moutons. Par extension, cet adjectif qualifie la tendance à se regrouper, à suivre la mode dominante d'un • groupe social, à imiter docilement la majorité. L'instinct grégaire, l'esprit grégaire. Pour susciter des conduites d'achat collectives, la publicité flatte l'instinct grégaire des gens. Deux exemples classiques d'instinct grégaire nous sont donnés en littérature : l'épisode (symbolique) des moutons de Panurge (dans le Pantagruel de Rabelais) et la pièce Rhinocéros d'Ionesco, dont tous les personnages (sauf un) veulent devenir « rhinocéros « par mimétisme. L'instinct grégaire se nomme encore grégarisme ou moutonisme. La même racine latine se retrouve dans Agrégat, Agrégé, Congrégation, Désagréger et Ségrégation. GREVER. v. tr. (du latin gravare, « charger«). Charger, alourdir de charges (financières en général). Un budget grevé de dépenses militaires. Sous l'Ancien régime, les paysans étaient grevés d'impôts et de servitudes. Antonyme : dégrever. Un dégrèvement d'impôts (un allégement). GRIEF. n. m. (du latin gravis, «pesant, pénible «). Sujet de plainte, reproche que l'on a à formuler contre quelqu'un. Avoir des griefs. Faire grief de quelque chose à quelqu'un. Doléance, récrimination. N.B. L'adverbe grièvement (gravement) ne s'emploie qu'avec des verbes tels que blesser, toucher, handicaper, meurtrir, etc. GRIVÈLERIE. n. f Fraude, et, plus précisément, délit qui consiste à consommer sans payer, dans un café, un restaurant, etc. Comment voulez-vous qu'un homme sans revenus survive sans commettre de grivèlerie ? GRIVOIS. adj. Se dit de propos lestes, licencieux sans être obscènes, ou encore des personnes qui les tiennent. Des plaisanteries grivoises (gentiment paillardes, gauloises). Un conteur grivois. Des causeurs mondains qui se plaisent dans la grivoiserie. GROSSO MODO. (en latin, « d'une manière grosse «). D'une façon globale, approximative. Sans entrer dans les détails. GROTESQUE. adj. et n. 1° Se dit de ce qui est risible, énorme, extravagant. Un personnage grotesque et ridicule. Une scène grotesque. Une opinion grotesque. Caricatural, burlesque, ridicule. Je te trouve grotesque. 2° En art et littérature, ce qui relève d'un genre grotesque (au premier sens) : le grotesque se caractérise par le goût du bizarre, du bouffon, de l'énorme, qui pousse le comique jusqu'au fantastique. Chez Victor Hugo, le grotesque s'oppose au sublime ; le personnage de Quasimodo allie les deux caractères. Ce film américain a des scènes d'un grotesque ahurissant : on aime ou on n'aime pas. GUINDÉ. adj. Qui affecte une certaine raideur pour paraître digne. Un maître d'hôtel à l'allure guindée. Qui est ampoulé, artificiel. Un style guindé. GUTTURAL. adj. Se dit d'une voix, d'un ton grave, produits du fond de la gorge. Il fait le fantôme en prenant une voix gutturale, qui effraye les enfants. N.B. On appelle couramment gutturales les consonnes K et G (keu et gueu).
GYNÉCO- OU -GYNE. Racines issues du grec gunê, qui signifie «femme «. Cette racine se retrouve dans les mots Gynécée (appartements réservés aux femmes dans l'Antiquité — on dit harem chez les peuples musulmans), Gynécologie (partie de la médecine spécialisée dans l'appareil génital de la femme) et aussi Androgyne (qui a les caractères sexuels de l'homme et de la femme), Misogyne (qui n'aime pas les femmes).
«
tribu) et Exogame (qui choisit un conjoint à l'extérieur de sa propre tribu); et aussi, les termes techniques Cryptogame, Gamète, Phanérogame (voir un dictionnaire spécialisé).
N.B.
« Game » veut bien dire mariage, et non pas «femme».
GAMME.
n.
(de la lettre grecque gamma, qui désignait la première note de la «gamme »).
En musique, échelle des notes ou des sons.
Par analogie, série plus ou moins homogène de toutes sortes de réalités.
Gamme des couleurs(série naturelle des tons successifs).
Gamme des prix.
Gamme d'objets ou de produits.
Voiture bas de gamme,voiture haut de gamme.
Gamme de sentiments.
Faire ses gammes : au sens propre, travailler toute la gamme des notes sur le clavier d'un piano ; au sens figuré, faire les premiers exercices, les premiers apprentissages d'une expérience humaine ou d'un métier.
GANGUE.
n.
f (sens propre) Substance qui entoure un minerai.
Il faut extraire le minerai ou les pierres précieuses de leur gangue.
(sens figuré) Enveloppe, magma confus qui entoure une réalité abstraite.
Il y a quelques pépites d'esprit dans la gangue de son bavardage.
Une gangue de préjugés, une gangue d'inepties.
Au figuré, le mot gangue représentetoujours quelque chose d'épais, de négatif, dont il faut extraire la perle, le positif.
GARANT.
nom.
Personne qui répond des actes d'une autre personne, qui est prête à en assumer la responsabilité, en particulier dans le cas d'une dette.
Être le garant de l'emprunt d'un ami : lui apporter sa caution, sa garantie.L'expression la plus généralement employée est se porter garant.
Elle s'applique à toutes sortes de réalités sociales ou morales : se porter garant de l'existence d'un fait, se porter garant de la valeur ou de la vertu d'une personne.Trouver, dans l'estime d'un ami, le garant de sa propre valeur.
GARGANTUESQUE.
adj.
Digne du héros de Rabelais, Gargantua.
C'est-à-dire à la fois énorme et pittoresque.
Un appétit gargantuesque, des exploits gargantuesques.
GÉMONIES (VOUER AUX).
Livrer quelqu'un au mépris public, le couvrir de honte devant tout le monde (et de nos jours, dans les médias).
À Rome, les gémonies étaient des escaliers où l'on exposait le corps des criminels étranglés, avant de les jeter dans le Tibre.
L'expression, par bonheur, n'a plus actuellement qu'un sens figuré.
GEN-, -GÈNE.
Racine d'origine grecque qui signifie « naître, engendrer, produire».
Elle entre dans la composition de nombreux mots dont elle éclaire le sens, par exemple : généalogie, genèse, gène, génétique, génocide, biogenèse,cancérigène, érogène, eugénisme, hallucinogène, hétérogène, homogène, indigène, lacrymogène, pathogène,thermogène, etc.
Cette racine est vivante dans la composition de mots actuels (cf.
anxiogène, qui date de 1968).On peut noter la proximité de cette racine avec la racine d'origine latine génér-, qui a le même sens (engendrer,générer, génération, progéniture), et que nous percevons intuitivement comme étant de même origine (au grecgenos correspond le latin genus, generis, « origine, naissance »).
Voir Genre, Sui generis.
GÉNÉREUX.
adj.
1° Sens classique : noble ; qui a « naturellement » des sentiments élevés et courageux (on retrouve ici la racine génér-, « naissance » : l'adjectif generosus signifie en latin « de bonne race »).
Un sanggénéreux.
Un combattant généreux.
2° Sens courant : qui se donne avec coeur et désintéressement.
Une âme ardente et généreuse.
Qui traduit sa générosité d'âme par des dons, des cadeaux, des gestes larges et gratuits.
Charitable, bienveillant.
Une personnegénéreuse, qui aime rendre service.
Il donne généreusement.
Il parle des autres de façon généreuse, et ne cherchequ'à en dire du bien.
GENÈSE.
n.
f (à partir du grec genos, «naissance, origine »).
1° Sens historique : la Genèse, création du monde.
Nom donné au premier livre de la Bible, qui raconte la création du monde et de l'être humain (Adam et Ève) par Jehovah (Dieu).
2° Sens courant : élaboration progressive d'une oeuvre (la genèse d'un roman); ensemble du processus qui aboutit à la création d'une chose ou à l'apparition d'un événement.
La genèse de l'esprit humain.
La genèse du nationalismeallemand.
La genèse d'une affaire (ses causes, son déclenchement).
GÉNIE.
n.
m.
(du latin genius, «divinité tutélaire — c'est-à-dire protectrice »).
1° Sens originel : esprit protecteur qui préside à la destinée d'une personne, d'une communauté ou d'un lieu.
Un génie tutélaire.
D'où : être surnaturel doté de pouvoirs magiques.
Un bon, un mauvais génie.
Dans ce sens, peutêtre employé au figuré (elle est son bon génie).
Le « génie » étant lié à chacun, dès sa naissance, on glisseaisément au sens suivant.
2° Sens classique : caractère inné ; nature (morale) profonde qui fait l'originalité d'un être, d'un peuple, d'une réalité abstraite.
Vautrin ou le génie du mal.
Le génie français se manifeste particulièrement dans la diversité de nosfromages et de nos vins.
Dans Le Génie du Christianisme, Chateaubriand analyse l'essence de la religion catholique.Le génie du roman, c'est avant tout de raconter, de mettre en scène..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Dictionnaire abrégé du surréalisme, d'André Breton et Paul Eluard
- DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE, ou la Raison par alphabet, 1764. Voltaire (François Marie Arouet, dit)
- DICTIONNAIRE UNIVERSEL (résumé et analyse)
- GRAND DICTIONNAIRE UNIVERSEL de Pierre Larousse.
- GRAND DICTIONNAIRE HISTORIQUE. Louis Moréri (résumé)