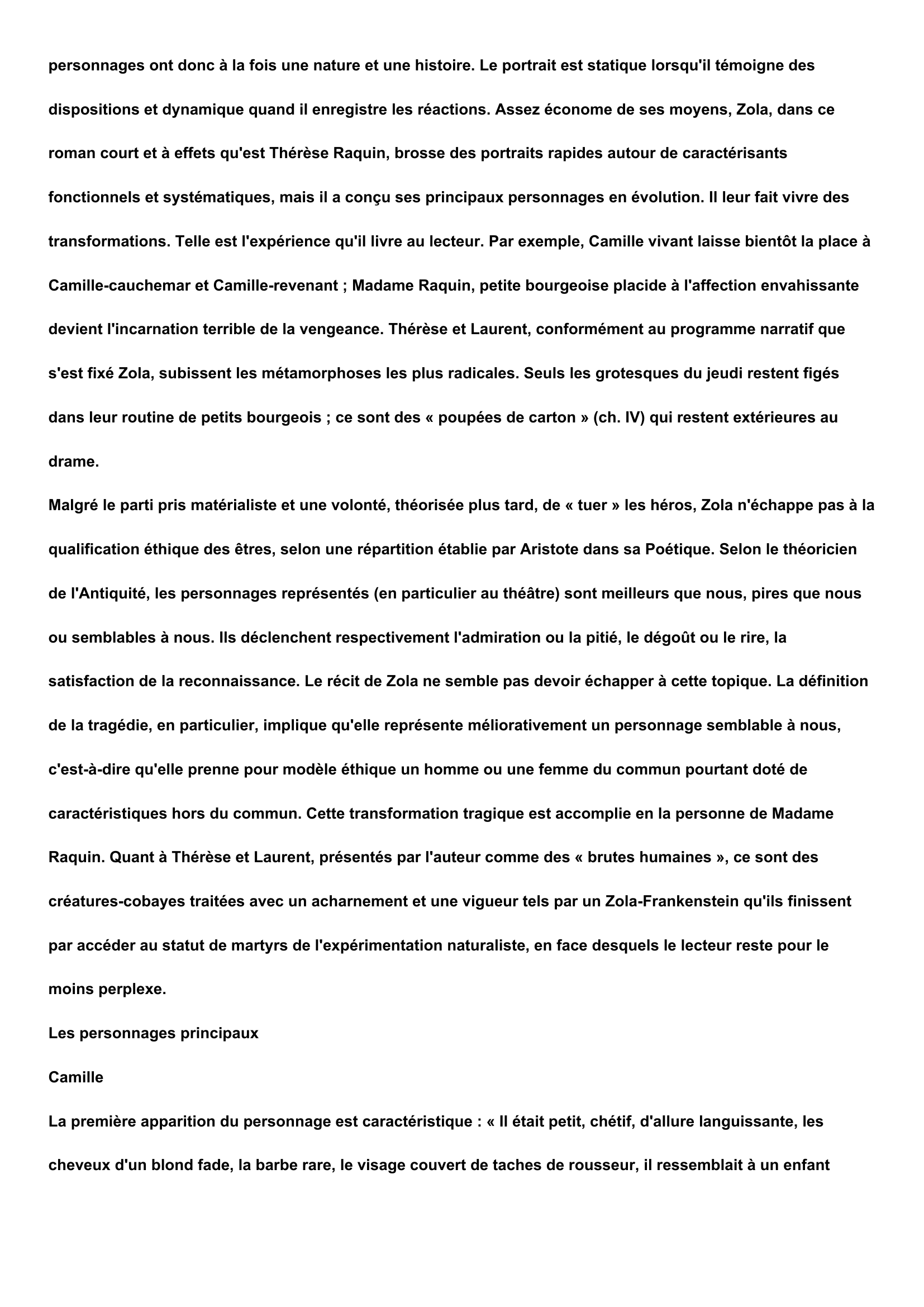RETOUR : Études d'œuvres François-Marie Mourad : Thérèse Raquin d'Émile Zola : une étude des personnages. Mis en ligne le 17 mars 2010. © : François-Marie Mourad. François-Marie Mourad, professeur agrégé des Lettres, docteur en Littérature et civilisation françaises, est professeur en classes préparatoires littéraires au lycée Montaigne de Bordeaux. Il est l'auteur de nombreux articles, d'éditions et d'ouvrages, notamment sur Zola. Thérèse Raquin d'Émile Zola : une étude des personnages Le portrait zolien est une physiognomonie[1] et la concrétion d'un tempérament dominant, conformément aux modèles en vigueur dans la médecine et les sciences humaines. Les écrivains réalistes, depuis Balzac et d'après la tradition, conçoivent leurs personnages selon des codes signifiants, comme des ensembles de signes relativement aisés à interpréter. Il y a des constantes, physiques et humorales, comme le fait d'être une femme ou un homme, d'avoir un tempérament sanguin ou lymphatique, d'être longiligne ou trapu, et des variables, selon l'environnement, le milieu, les autres, auxquels il faut s'adapter et dont on subit l'influence. Les personnages ont donc à la fois une nature et une histoire. Le portrait est statique lorsqu'il témoigne des dispositions et dynamique quand il enregistre les réactions. Assez économe de ses moyens, Zola, dans ce roman court et à effets qu'est Thérèse Raquin, brosse des portraits rapides autour de caractérisants fonctionnels et systématiques, mais il a conçu ses principaux personnages en évolution. Il leur fait vivre des transformations. Telle est l'expérience qu'il livre au lecteur. Par exemple, Camille vivant laisse bientôt la place à Camille-cauchemar et Camille-revenant ; Madame Raquin, petite bourgeoise placide à l'affection envahissante devient l'incarnation terrible de la vengeance. Thérèse et Laurent, conformément au programme narratif que s'est fixé Zola, subissent les métamorphoses les plus radicales. Seuls les grotesques du jeudi restent figés dans leur routine de petits bourgeois ; ce sont des « poupées de carton « (ch. IV) qui restent extérieures au drame. Malgré le parti pris matérialiste et une volonté, théorisée plus tard, de « tuer « les héros, Zola n'échappe pas à la qualification éthique des êtres, selon une répartition établie par Aristote dans sa Poétique. Selon le théoricien de l'Antiquité, les personnages représentés (en particulier au théâtre) sont meilleurs que nous, pires que nous ou semblables à nous. Ils déclenchent respectivement l'admiration ou la pitié, le dégoût ou le rire, la satisfaction de la reconnaissance. Le récit de Zola ne semble pas devoir échapper à cette topique. La définition de la tragédie, en particulier, implique qu'elle représente méliorativement un personnage semblable à nous, c'est-à-dire qu'elle prenne pour modèle éthique un homme ou une femme du commun pourtant doté de caractéristiques hors du commun. Cette transformation tragique est accomplie en la personne de Madame Raquin. Quant à Thérèse et Laurent, présentés par l'auteur comme des « brutes humaines «, ce sont des créatures-cobayes traitées avec un acharnement et une vigueur tels par un Zola-Frankenstein qu'ils finissent par accéder au statut de martyrs de l'expérimentation naturaliste, en face desquels le lecteur reste pour le moins perplexe. Les personnages principaux Camille La première apparition du personnage est caractéristique : « Il était petit, chétif, d'allure languissante, les cheveux d'un blond fade, la barbe rare, le visage couvert de taches de rousseur, il ressemblait à un enfant malade et gâté « (ch. I). Chacun de ces traits est à prendre comme une lacune dans l'ordre de la masculinité idéale. L'allure maladive implique l'effacement du corps et l'altération de la fonction sexuelle, les cheveux blonds, les taches de rousseur et l'absence de pilosité maintiennent l'individu dans une éternelle adolescence, ainsi que l'indiquent les notations concordantes des chapitres suivants. « Arrêté dans sa croissance «, « pauvre petite figure pâlie «, porteur d'un prénom éventuellement féminin, Camille[2] annonce les créatures indistinctes, au sang appauvri — bâtards, ataxiques, hommes-femmes, petits crevés pré-décadents — qui apparaîtront sporadiquement dans Les Rougon-Macquart. Le romancier oriente sensiblement l'attitude du lecteur vis-à-vis de Camille en employant des (dé)qualifiants péjoratifs. Il est d'« un égoïsme féroce «, « abruti et vaniteux « (ch. XI) ; dans les conversations du jeudi soir il se donne « une importance bête « (ch. X). L'évocation de son emploi du temps et de ses occupations essentielles oriente le portrait vers la « physiologie «, un genre littéraire d'inspiration réaliste-critique mis en œuvre sous la Restauration, illustré par Balzac (Physiologie du mariage, 1829-1830) et exploité par Flaubert. Zola prend manifestement plaisir à brosser la caricature de l'employé type de la grande administration. Les récits de Maupassant et de Joris-Karl Huysmans, qui ont eux-mêmes été employés, fourmilleront de ces personnages falots et ridicules dont l'énergie est absorbée par des tâches répétitives et sans attrait. Le chapitre III de Thérèse Raquin contient quelques pages ironiques sur la vie de Camille, pages qui formeraient à elles seules la matière d'une nouvelle divertissante. Le personnage contemple les échafaudages qui recouvrent Notre-Dame de Paris et compte les fiacres qui viennent de la gare. Et « le soir, abruti, la tête pleine de quelque sotte histoire contée à son bureau, il traversait le Jardin des Plantes, et allait voir les ours, s'il n'était pas trop pressé. […] les allures de ces grosses bêtes lui plaisaient ; il les examinait, les lèvres ouvertes, les yeux arrondis, goûtant une joie d'imbécile à les voir se remuer « (ch. III). Camille le faible éprouve une admiration pour les monuments imposants et les animaux puissants, symboles de la durée et de la vie. Camille l'ignorant lit chaque soir quelques pages de Buffon, de Thiers et Lamartine. Camille l'éternel enfant avait déclaré « nettement à sa mère qu'il entendait quitter Vernon et aller à Paris «. En dépit de ses faiblesses et de ses ridicules, le personnage de Camille doit être réévalué à la lumière de ces réactions et de ces initiatives qui font de lui, paradoxalement, un être plus positif et plus « présent « dans la narration. Camille n'est pas dépourvu de volonté : par exemple, il tient tête à sa mère. Enfant, il cherche déjà à « échapper aux câlineries […] qui lui donnaient des nausées « (ch. II). Il fait quelques études et réussit à devenir employé, son grand rêve. C'est bien lui qui a provoqué le départ de la famille à Paris, geste présenté par le narrateur comme un « caprice « mais qui ressemble davantage à une revendication légitime à mener une existence personnelle. Devant les siens, Camille parle alors en maître : « Je ne t'ai jamais contrariée dans tes projets, dit-il à sa mère, j'ai épousé ma cousine, j'ai pris toutes les drogues que tu m'as données. C'est bien le moins, aujourd'hui, que j'aie une volonté et que tu sois de mon avis… Nous partirons à la fin du mois « (ch. III). C'est encore Camille qui introduit Laurent dans le foyer conjugal. C'est lui qui a l'initiative des sorties du dimanche (il force sa femme à l'accompagner), et plus particulièrement de celle qui conduit au meurtre à Saint-Ouen. Le personnage bénéficie en outre du statut de mari et de l'autorité implicite qui s'y attache, même si c'est d'abord sur le mode mineur et ensuite de façon effrayante. Il est, avant sa mort, un mari par défaut ; présenté comme l'éternel cousin de Thérèse, il pâtit du manque de virilité qui conduira sa femme à se jeter dans les bras de Laurent. Mais un certain nombre d'indices témoignent d'un pouvoir tacite et de prérogatives attachées au statut conjugal, nettement plus contraignant au XIXe siècle que de nos jours (le Code civil de 1804 assimile l'épouse à une éternelle mineure). D'abord, Camille et Thérèse ont, encore enfants, vocation à former un couple, comme dans une tribu aux mœurs primitives ou quelque caste ancienne : « Les enfants savaient depuis longtemps qu'ils devaient s'épouser un jour. Ils avaient grandi dans cette pensée qui leur était devenue ainsi familière et naturelle. On parlait de cette union, dans la famille, comme d'une chose nécessaire, fatale « (ch. II). Naturelle, nécessaire, fatale…, la conjonction de ces deux êtres jeunes est évoquée comme une donnée de l'hérédité sociale, « un dénouement prévu, arrêté « (ch. II), renforcé par une sorte d'inceste tacite (après tout les deux personnages sont cousins au premier degré), accepté par tous et dépourvu de connotation sexuelle. Enfants et adolescents, Thérèse et Camille dorment dans le même lit (« Thérèse grandit, couchée dans le même lit que Camille «), boivent dans le même verre, s'embrassent (« il l'embrassait comme il embrassait sa mère «) et « se vautrent « ensemble le long de la rivière. Le mariage institutionnel ne fait qu'entériner un état de faits : « Le jour fixé pour le mariage arriva. […] Le soir, Thérèse, au lieu d'entrer dans sa chambre, qui était à gauche de l'escalier, entra dans celle de son cousin, qui était à droite. Ce fut tout le changement qu'il y eut dans sa vie, ce jour-là « (clôture du ch. II). La modification d'attitude est plutôt d'ordre social et moral. L'autorité du mari ne tarde pas à être plus sensible dans les moments où le renom de Raquin est en jeu, lors des réceptions du jeudi, par exemple. Camille exige alors de son épouse qu'elle participe au jeu de dominos, qu'elle prenne part aux conversations. Il est « irrité « par son indifférence (ch. IV) et « se fâche « de son absence lorsqu'elle se soustrait à l'obligation de convivialité qu'il a instituée. Thérèse se soumet généralement à cette autorité. Elle la reconnaît et a conscience de transgresser un interdit lorsqu'elle accueille son amant sous son toit. Elle sait qu'elle fait le mal (ch. VIII) et connaît sa situation de femme adultère. Le chat François est un témoin à charge : « Regarde donc François, dit Thérèse à Laurent, on dirait qu'il comprend et qu'il va ce soir tout conter à Camille « (ch. VII). Cette notion de faute implique logiquement un châtiment, que la victime se chargera elle-même d'administrer, sous la forme effrayante du revenant, de l'autre spectral. Par une inversion fantastique, Camille devient alors plus présent et plus puissant que jamais. Camille est dès l'abord présenté comme un mort en sursis, non seulement parce qu'il est un rescapé de « toutes les fièvres, de toutes les maladies imaginables « (ch. II) d'autant plus redoutables qu'elles ne sont pas précisées, mais encore parce qu'il ressemble déjà enfant à un « moribond « (ch. II) ; ses membres grêles ont des « mouvements lents et fatigués «. Cette vie au ralenti, cet enlisement dans les habitudes sont bien figurés par le portrait que fait de lui Laurent, et qui montre Camille « tel qu'en lui-même l'éternité le change « : « le dessin grimaçant convulsionnait les traits, rendant ainsi la sinistre ressemblance plus frappante « (ch. VI). Ce portrait est prémonitoire mais son caractère inquiétant n'est pas évident pour Camille qui, en plus de s'y reconnaître, se réjouit ostensiblement de se voir peint à son avantage : « Mais Camille était enchanté ; il disait que sur la toile il avait un air distingué « (ch. VI) ! C'est ainsi que l'on comprend que la vision que le lecteur a de Camille est systématiquement étrangère au personnage lui-même, extérieure, superficielle et partiale… Camille est méconnu, on ne voit de lui que ce que l'on veut voir : un enfant malade, un simple cousin, un employé ordinaire… Le paroxysme de la volonté ou de la pente du narrateur à faire triompher une dernière fois cette méconnaissance est atteint lors de la scène du crime. C'est à travers le regard de Laurent et Thérèse que Camille apparaît, « vautré «, « faisant une grimace bête «, « exaspérant et ignoble « (ch. XI). Zola a poussé le réalisme psychologique jusqu'à faire éprouver au lecteur, sous l'empire de la focalisation interne, un sentiment peu charitable que les Allemands appellent Schadenfreude, mot sans équivalent en français et qui désigne une sorte de complaisance morbide à voir souffrir autrui ou à souhaiter son malheur[3]. Mais un retournement s'opère dans la perception du personnage, aussi violent que l'agression qu'il subit, au moment précis où il est jeté à l'eau par Laurent : il devient alors un « malheureux «, qui « râle «, une victime « folle de rage et d'épouvante « dont le lecteur sent presque physiquement la détresse absolue. Au code affectif qui oriente la compassion vers ceux qui subissent un méfait arbitraire se surajoutent les réactions d'hostilité aux criminels et à leurs complices conformément au code moral et idéologique en vigueur. De laid et d'à peine gênant qu'il était dans la vie, Camille va paradoxalement devenir omniprésent comme cadavre et revenant. Le passage dans les eaux de la Seine peut être interprété comme le baptême de la vie spectrale. Comme l'indique Gaston Bachelard dans L'Eau et les rêves, « L'eau fournit le symbole d'une vie spéciale attirée par une mort spéciale. « La rêverie horrifiée de Mme Raquin après l'annonce de la disparition de son fils associe explicitement l'action sous-marine et la gestation : « Et la pauvre mère voyait son fils roulé dans les eaux troubles de la Seine, le corps roidi et horriblement gonflé ; en même temps, elle le voyait tout petit dans son berceau, lorsqu'elle chassait la mort penchée sur lui « (ch. XII). Le reflet qui surplombe une eau lourde et mystérieuse se retrouve à la Morgue dans « le vitrage qui sépare les spectateurs des cadavres « (ch. XIII). La nouvelle existence de Camille obéit au principe de l'inversion : la Morgue est une maternité, où s'étalent désormais toutes les variétés inédites de la décomposition des corps, génératrice d'attitudes qui annoncent la hantise des vivants. Un premier noyé grimace sous le jet d'eau qui le chatouille, « il éclate de rire « ; quant à Camille, il est désormais authentiquement « ignoble «, : ses traits, au lieu de se décomposer, se sont « conservés «, affermis, « la peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse «. Le portrait du chapitre XIII se concentre sur le visage, pour coïncider avec le tableau de Laurent : « Cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine était restée plus effrayante de douleur et d'épouvante. « La laideur ainsi comprise etjustifiée devient un attribut du pouvoir sur les autres, le portrait de Laurent n'est plus une œuvre isolée mais envahit toutes les productions du peintre (ch. XXV), qui témoignent de la connexion étroite entre le génie et la perception d'une vérité occulte, douloureuse et tragique. Après sa mort, Camille n'est donc pas moins présent. Il hante les nuits de Laurent et Thérèse d'abord sous la forme d'un « rêve implacable « (ch. XVII), puis par des hallucinations de plus en plus rapprochées, des « visites «, mais parce qu'il est chez lui. Le groupe des petits bourgeois du jeudi, même amputé d'un de ses membres, est fondé sur les principes de similarité et d'interchangeabilité, ce qui assure la survie d'un modèle de comportement collectif. Les Michaud et Grivet maintiennent donc, par leurs automatismes, l'existence de Camille dans ce qui en constituait l'esprit. Pour eux, il est toujours là, et la partie de dominos n'a pas à se transformer en table tournante pour faire surgir le fantôme de Camille. Le spectre de Camille continue donc la vie du personnage, sur les modes de l'inversion, de la révélation et de l'accentuation. Assez inexpressif de son vivant, il grimace désormais ; impuissant sexuellement, il semble serrer son épouse « dans un embrassement glacial « (ch. XVIII) et réitéré. Peu gênant au départ, il s'interpose systématiquement entre les époux illégitimes après s'être approprié leur nuit de noces (ch. XXI). Il obsède Laurent, il a marqué sa chair et l'a introduit dans le monde de la peur : « Sans cesse heurté contre l'homme qu'il avait tué, le meurtrier finit par éprouver une sensation bizarre qui faillit le rendre fou « (ch. XXIX). Camille retrouve un surcroît d'autorité auprès de Thérèse, qui rend finalement justice à « cet excellent cœur « (ch. XXIX) et mêle « le souvenir du noyé à chacun des actes de la vie journalière «. Zola va jusqu'à suggérer qu'il féconde son épouse : « Il lui semblait sentir dans ses entrailles le froid d'un cadavre dissous et amolli « (ch. XXX). Elle décide donc de s'exposer aux violences de Laurent et provoque une fausse couche. Le fils rejoindra le père dans le royaume des ombres. Finalement, le personnage de Camille, qui illustre partiellement le thème du double, met en question l'unité apparente du réel que le romancier naturaliste cherche à restituer. En révélant l'autre qui se cache sous le moi anodin, Zola ne se contente pas d'exploiter les ressources du récit d'angoisse et un motif fantastique, il incorpore l'illusion au réel et met en scène la complexité de la personne. Comme l'indique Clément Rosset dans Le Réel et son double : « Peut-être le fondement de l'angoisse, apparemment lié à la simple découverte que l'autre visible n'était pas l'autre réel, est-il à chercher dans une terreur plus profonde : de n'être pas moi-même celui que je croyais être. Et, plus profondément encore, de soupçonner en cette occasion que je suis peut-être non pas quelque chose, mais rien. « Laurent Laurent est présenté dès l'abord comme un personnage tout à fait à l'opposé de Camille. C'est « un grand gaillard «, « d'une beauté sanguine «, « un vrai fils de paysan, d'allure un peu lourde, le dos bombé, les mouvements lents et précis, l'air tranquille et entêté «. Son portrait physique est développé au début du chapitre V. Tout son être dégage une puissance qui renvoie au mythe panthéiste de la terre et de l'animalité. Selon cette sorte de classification qui rattache les êtres aux éléments et aux espèces naturelles, Laurent est à la fois un bœuf et un taureau (dont il a le cou), à la fois bête de somme et symbole de virilité, passif et sporadiquement violent. Entre ses crises de violence ou de rut, il s'affaisse dans le contentement de ses appétits. Il est vu en masse à travers le regard émerveillé de Thérèse, comme « tout un corps d'une chair épaisse et ferme «. Laurent a beau avoir refusé le destin successoral paternel, il n'en est pas moins « fils de paysan «, paysan lui-même. C'est un immigré de la province, un « rural «, avec son morphotype et ses caractéristiques conventionnelles. Zola reprend un certain nombre de clichés qu'on trouvera développés en 1887 dans La Terre, son quinzième roman desRougon-Macquart : la matérialité, l'épaisseur sanguine, l'âpreté au gain qui suscite la ruse, l'intelligence cauteleuse… Laurent annonce ainsi partiellement le personnage de Buteau, qui tue son père, le vieux Fouan. Cette pulsion de meurtre habite également le fils indigne deThérèse Raquin. Elle est réalisée par l'assassinat de Camille et en germe dans l'impatience à voir le père « laisser la place « : « Le père mourra bien un de ces jours ; j'attends ça pour vivre sans rien faire « (ch. V). L'évocation du père Laurent, « le paysan de Jeufosse « (un lieu que connaissait bien Zola) est souvent confondue avec un réquisitoire contre les paysans. Mais il faut réinterpréter les informations dont dispose le lecteur en signalant qu'elles sont inscrites dans un discours négatif du fils. Ce dernier se plaint des « ambitions utiles « de son père, un riche propriétaire fermier qui aurait souhaité faire de son fils son avocat dans les nombreux procès qui l'opposent à ses voisins. Dans cette optique, Laurent a pu bénéficier d'une éducation assez soignée dont le couronnement aurait été un titre obtenu à la faculté de droit de Paris. Pendant deux ans, le père a versé très régulièrement une « pension de douze cents francs « à son fils, qui la détourne pour mener la « vie d'artiste «, aux antipodes du modèle de réussite bourgeoise dont rêve le vieux Laurent pour sa descendance. Le calcul du paysan échoue devant le naturel paresseux et jouisseur de son fils, qui reconnaît néanmoins que le projet était valable : « Oh ! le père Laurent n'a que des ambitions utiles ; il veut tirer parti même de ses folies « (ch. V). La première de ces folies a été de fonder des espoirs sur un fils indigne, et la seconde de l'avoir exposé à l'influence pernicieuse de la capitale, où le vieux ne met à peu près jamais les pieds. Si la passion de la terre attache ainsi le propriétaire à ses « beaux champs «, il n'en a pas moins été capable de sacrifices et d'ambition pour assurer un destin honorable à son fils. Quand il aura compris l'inanité de ses espoirs, il prendra des mesures concrètes, afin que l'héritage, échappant à son fils, aille « dans les poches d'un de ses cousins « (ch. XVIII). Finalement, « le paysan de Jeufosse, dur mais juste, exigeant avec les autres, parce qu'il est impitoyable avec lui-même, se dresse comme une grande figure, celle du seul homme véritable de Thérèse Raquin[4] «. Laurent est donc présenté d'emblée comme un personnage amoral et comme un organisme parasite. Lorsqu'il se rappelle aux Raquin, il ne fait pas mystère de son histoire, il ne cherche pas à se faire hypocritement valoir selon les règles tacites (de pudeur ou de mensonge aménagé) du theatrum mundi, de la société bourgeoise, qui valorise en particulier l'honnêteté des sentiments, l'amour du travail, la rectitude morale : lui avoue carrément ses penchants à la sensualité, sa paresse et son matérialisme. Il ne semble pas avoir conscience de son cynisme. Zola insiste précisément sur cette amoralité du personnage et sur le matérialisme vulgaire qui caractérise effectivement la « brute « humaine qu'il a voulu mettre en scène dans son roman : « Laurent parlait d'une voix tranquille. Il venait, en quelques mots, de conter une histoire caractéristique qui le peignait en entier. Au fond, c'était un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances faciles et durables. Ce grand corps puissant ne demandait qu'à ne rien faire, qu'à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures. Il aurait voulu bien manger, bien dormir, contenter largement ses passions, sans remuer de place, sans courir la mauvaise chance d'une fatigue quelconque « (ch. V). Ce commentaire, qui substitue à l'analyse psychologique attendue une physiologie, suffit effectivement à la caractérisation du personnage et rend compte de son comportement. La définition du tempérament sanguin incluait, selon les théories médicales en vigueur, les deux dimensions, alimentaire et sexuelle, de l'appétit. Après avoir repoussé les métiers qui demandaient trop d'efforts (l'idée même de la profession d'avocat, celle de « piocher la terre « et finalement aussi la peinture, lorsqu'il est acquis qu'il faut travailler pour y réussir un tant soit peu), Laurent se trouve assez « à l'aise « dans la condition médiocre d'employé : « Il vivait très bien en brute, il aimait cette besogne au jour le jour, qui ne le fatiguait pas et qui endormait son esprit. Deux choses l'irritaient seulement : il manquait de femmes, et la nourriture des restaurants à dix-huit sous n'apaisait pas les appétits gloutons de son estomac. « L'arrivée de Laurent dans la famille Raquin va lui permettre de combler ces manques et, comme pour un organisme animal même élémentaire, de trouver son biotope : rapportée à la satisfaction de ses besoins élémentaires, « la boutique du passage du Pont-Neuf devint pour lui une retraite charmante, chaude, tranquille, pleine de paroles et d'attentions amicales « (ch. VI). La prédominance des fonctions de nutrition sur celles de relation chez le sanguin Laurent se traduit par une disponibilité toujours en éveil et par l'immédiateté. Il accepte « carrément « toutes les invitations, s'introduit sans délai dans la petite société du jeudi, vit « dans une douce quiétude «. Le seul frein à ses impulsions est une prudence cauteleuse qui, loin de nuire à ses penchants, lui permet de leur donner une extension maximale. C'est « l'économie « qui lui conseille de prendre Thérèse pour maîtresse, une femme qu'il trouve d'abord « laide « avec « le nez long «, « la bouche grande «. La liaison sexuelle et tempéramentielle entre les deux personnages principaux introduit un nouvel équilibre sur fond d'échange : Thérèse, dont Laurent aimante l'énergie, comble les besoins sexuels de son partenaire. Seulement, la femme, par le zèle inconscient et libérateur qu'elle apporte à cette relation, l'initie à un au-delà de la satisfaction animale, à la peur, à l'angoisse et au dédoublement du réel : « Jamais Laurent n'avait connu une pareille femme. Il resta surpris, mal à l'aise. […] Il avait des heures d'effroi, des moments de prudence et, en somme, cette liaison le secouait désagréablement « (ch. VII). Le crime sera la conséquence directe de cet envoûtement du personnage, qui se serait contenté de la position stable etsans histoire obtenue facilement et décrite au ch. VIII : « Laurent avait deviné juste : il était devenu l'amant de la femme, l'ami du mari, l'enfant gâté de la mère. Jamais il n'avait vécu dans un pareil assouvissement de ses appétits. Il s'endormait au fond des jouissances infinies que lui donnait la famille Raquin. « Si l'on y prend garde, le personnage de Laurent est bien l'un de ces individus banals et inintéressants que l'esthétique naturaliste se mettra au défi de faire entrer dans le roman pour représenter la normalité, la vie ordinaire. Les invités du jeudi soir ont rapidement reconnu l'un des leurs, employé, placide et sans imagination, animal mimétique : « Laurent se comporta en bon enfant. Il comprit la situation, il voulut plaire, se faire accepter d'un coup. Il raconta des histoires, égaya la soirée par son gros rire, et gagna l'amitié de Grivet lui-même « (ch. V), dont le narrateur avait pris soin quelques lignes plus haut d'indiquer qu'il « détestait Laurent «. Ce dernier pourra néanmoins toujours compter sur la complicité des êtres à qui il ressemble et qui lui ressemblent. Thérèse joue une comédie habile pour se faire accepter par cette société mais, parce qu'elle ne lui appartient pas, qu'elle est autre, son jeu est plus sournois que celui de Laurent. Lui se contente, si l'on peut dire, d'être lui-même, de retrouver la spontanéité de sa nature. Lorsque la vie des époux se dédouble, Laurent montre parfois de prodigieuses capacités de négligence et d'oubli : « L'estomac plein, le visage rafraîchi, il retrouvait sa tranquillité épaisse, il arrivait à son bureau et y passait la journée entière à bâiller, à attendre l'heure de la sortie. Il n'était plus qu'un employé comme les autres, abruti et ennuyé, ayant la tête vide « (ch. XXIV). Comme Laurent est tout de même un personnage principal, d'après le code narratif du genre et conformément au projet scientifique de l'auteur, il faut bien qu'il acquière une singularité et une originalité susceptibles de maintenir l'attention du lecteur. Le personnage de Thérèse, plus complexe, plus riche en suggestions diverses du fait qu'elle est une femme, qui plus est une femme nerveuse, se suffit à lui-même. Mais Laurent, sanguin, paysan, criminel sans état d'âme, aux antipodes d'une conception dostoïevskienne de la personne, n'a pas la même « rentabilité « narrative que sa partenaire. Non seulement c'est la jeune femme qui donne son titre au roman, mais, on l'a déjà remarqué, le jeune homme ne porte qu'un prénom très simple, tout comme le chat. En fait, tout en maintenant la simplicité et la rudesse du personnage, en restant assez fidèle au programme narratif qu'il s'est fixé, Zola va réussir à relancer l'intérêt du lecteur par plusieurs moyens. Il fait d'abord subir à Laurent l'influence de Thérèse, les nerfs l'emportent sur le sang, et une sensibilité nouvelle apparaît chez le personnage : « [Thérèse] avait fait pousser dans ce grand corps, gras et mou, un système nerveux d'une sensibilité étonnante. Laurent qui, auparavant, jouissait de la vie plus par le sang que par les nerfs, eut des sens moins grossiers. Une existence nerveuse, poignante et nouvelle pour lui, lui fut brusquement révélée, aux premiers baisers de sa maîtresse « (ch. XXII). Il eût été ennuyeux, d'un point de vue strictement narratif, que Laurent passât d'un équilibre inconscient et ancien à un nouvel équilibre psychologique. Zola introduit donc la catastrophe et se sert du nervosisme pour altérer définitivement la nature du personnage : « Alors eut lieu en lui un étrange travail ; les nerfs se développèrent, l'emportèrent sur l'élément sanguin, et ce fait seul modifia sa nature. Il perdit son calme, sa lourdeur, il ne vécut plus une vie endormie. Un moment arriva où les nerfs et le sang se tinrent en équilibre ; ce fut là un moment de jouissance profonde, d'existence parfaite. Puis les nerfs dominèrent, et il tomba dans les angoisses qui secouent les corps et les esprits détraqués « (ibid.). Le baiser, comme dans La Belle au bois dormant, réveille la chair endormie, mais l'histoire commence quand l'autre finit, et c'est un récit rien moins qu'anodin ; la vie du personnage change complètement de cours. Zola raconte les déséquilibres du sang et des nerfs. Après la phase érotique et plus que le meurtre, accompli avec une brutalité expresse et ponctuelle, viennent les hallucinations, selon un rythme et des gradations continus. Le contraste entre l'impassibilité native du personnage et son effroi est à l'origine de scènes saisissantes, comme au ch. XVII, qui décrit le retour obsessionnel d'un cauchemar atroce : « Il tenta encore le sommeil. Alors ce fut une succession d'assoupissements voluptueux et de réveils brusques et déchirants. Dans son entêtement furieux, toujours il se heurtait contre le corps de Camille. À plus de dix reprises, il refit le chemin, il partit la chair brûlante, suivit le même itinéraire, eut les mêmes sensations, accomplit les mêmes actes avec une exactitude minutieuse, et, à plus de dix reprises, il vit le noyé s'offrir à son embrassement lorsqu'il étendait les bras pour saisir et étreindre sa maîtresse. « Avec le motif de la morsure et le thème du revenant, Zola réussit à enrichir le destin de Laurent de teintes ténébreuse et crépusculaires. Cette métamorphose, riche en effets expressionnistes, se décline en outre à travers la figure complémentaire de l'artiste névrosé, que Zola développera plus tard dans L'Œuvre. La figure de Laurent se trouve singulièrement enrichie par cette théorie assez courante à l'époque où Zola écrit, celle de l'art comme variante de la folie. Il pouvait la trouver dans les ouvrages de Taine et du docteur Moreau de Tours. Peintre raté, dont les productions étaient largement au-dessous du médiocre, Laurent est devenu sans le savoir une sorte de grand artiste inconscient. Zola commente ainsi cette transformation : « Il est difficile à l'analyse de pénétrer à de telles profondeurs. Laurent était peut-être devenu artiste comme il était devenu peureux, à la suite du grand détraquement qui avait bouleversé sa chair et son esprit. Auparavant, il étouffait sous le poids lourd de son sang, il restait aveuglé par l'épaisse vapeur de santé qui l'entourait ; maintenant, maigri, frissonnant, il avait la verve inquiète, les sensations vives et poignantes des tempéraments nerveux. Dans la vie de terreur qu'il menait, sa pensée délirait et montait jusqu'à l'extase du génie ; la maladie en quelque sorte morale, la névrose dont tout son être était secoué, développait en lui un sens artistique d'une lucidité étrange ; depuis qu'il avait tué, sa chair s'était comme allégée, son cerveau éperdu lui semblait immense, et, dans ce brusque agrandissement de sa pensée, il voyait passer des créations exquises, des rêveries de poète. Et c'est ainsi que ses gestes avaient pris une distinction subite, c'est ainsi que ses œuvres étaient belles, rendues tout d'un coup personnelles et vivantes. « On voit comment l'écrivain se saisit de la théorie parascientifique pour produire une « analyse « suggestive et exaltée du mystère de la création. Les limites du réel éclatent, les images de profondeur, d'élargissement, triomphent, corrélées à une sorte de libération de la violence des instincts. Ce que les psychanalystes désigneront comme le phénomène de la sublimation artistique est ici préparé par une riche intuition qui cherche à expliquer l'alliance d'euphorie, de sentiment de puissance, d'originalité, de délicatesse, d'intelligence et d'effroi qui caractérise l'œuvre d'art authentique. C'est peut-être avec ce personnage de Laurent que Zola a le mieux réussi son pari d'écrivain expérimentateur, puisque, sans le dénaturer, il a réussi à lui faire connaître une évolution qui, tout en étant surprenante, reste parfaitement compréhensible et maîtrisée. Laurent, simultanément, reste le même et devient un autre, se dédouble et s'en étonne, il est un premier horla. Zola parvient ainsi à lui conférer une profondeur et une originalité qui le rattachent à la tradition des possédés, des fous de Géricault et des désespérés du romantisme[5]. Thérèse Thérèse est une héroïne-type du « nouveau roman « réaliste au XIXe siècle. Elle prend place auprès d'Emma Bovary de Flaubert et surtout de Germinie Lacerteux des frères Goncourt. Elle partage leur « névrose «, leurs « dérèglements « et leur destin fatal. Elle annonce Marthe de Huysmans, Jeanne Lamare d'Une vie de Maupassant et toute une série de créatures — courtisanes, femmes adultères, « hystériques «… — qui forment le personnel féminin du roman naturaliste, Rougon-Macquart en tête. L'œuvre romanesque du jeune Zola, si l'on y inclut Madeleine Férat, qui paraîtra en 1868, est déjà un premier cycle de la femme. On y retrouve la triangulation romanesque (le mari, la femme, l'amant), la propension à l'étude physiologique, la surimposition de la morale et, plus généralement, un intérêt exorbitant pour l'Autre, une interrogation devant le mystère de la féminité et de la sexualité. Dans ses confidences sur sa méthode de travail, Zola avouait penser en priorité à un personnage principal plutôt qu'à une intrigue avant de se lancer dans la rédaction d'un roman. Nul doute que pour Thérèse Raquin, il se soit intéressé avant tout à son héroïne, présentée dans la préface de 1868 comme une « femme inassouvie « et l'illustration du tempérament nerveux, mais dont la complexité l'éloigne du schéma simpliste appliqué plus strictement au personnage de Laurent. Un premier effet de profondeur de champ est obtenu par la mention des origines héréditaires du personnage, qui annonce un procédé systématiquement appliqué dans Les Rougon-Macquart. Thérèse connaît et revendique son roman familial : « On m'a dit que ma mère était fille d'un chef de tribu, en Afrique ; j'ai souvent songé à elle, j'ai compris que je lui appartenais par le sang et les instincts, j'aurais voulu ne la quitter jamais et traverser les sables, pendue à son dos… « (ch. VII). Cette scène « exotique « est révélatrice de la représentation fantasmée, primitiviste et grossièrement « ethnographique «, du désert d'Afrique du Nord par le personnage (… et l'auteur). En outre, comme l'a indiqué Auguste Dezalay[6], Thérèse, née sous le signe du feu, « est l'Étrangère, et son inquiétante étrangeté, symbolisée par l'Afrique lointaine d'où elle est issue, lui permet d'emporter les autres personnages du roman vers un Ailleurs et un Inconnu presque démoniaques «. L'hérédité, conçue au XIXe siècle comme un fondement du racialisme[7] est expressément présentée comme un facteur explicatif du comportement transgressif de Thérèse, seul personnage qui ne s'accommode pas du milieu dans lequel elle vit puisqu'il est aux antipodes de celui auquel elle était destinée. L'atmosphère confinée des vieux quartiers de la capitale lui est insupportable, l'oppression de l'impasse du Pont-Neuf et de la boutique lui est plus sensible qu'à quiconque : « Quand Thérèse entra dans la boutique où elle allait vivre désormais, il lui sembla qu'elle descendait dans la terre grasse d'une fosse. Une sorte d'écœurement la prit à la gorge, elle eut des frissons de peur « (ch. III). Pour bien faire saisir au lecteur l'insatisfaction profonde dans laquelle vit le personnage et le système d'oppositions (thématiques, symboliques) qui en résulte, Zola évoque brièvement mais avec une certaine intensité stylistique le séjour de la jeune femme à la campagne : « Quand elle était seule, dans l'herbe, au bord de l'eau, elle se couchait à plat ventre comme une bête, les yeux noirs agrandis, le corps tordu, près de bondir. Et elle restait là, pendant des heures, ne pensant à rien, heureuse d'enfoncer ses doigts dans la terre « (ch. II). C'est à la fois le mythe d'Antée et celui de la terre féconde. L'expérience qui consiste ensuite à placer volontairement ce personnage de jeune femme sensuelle au tempérament « méditerranéen « au cœur d'une famille aux mœurs étriquées, dans un « corridor étroit et sombre «, laisse présager un développement animé, voire heurté. L'hypocrisie à laquelle Thérèse est condamnée et dans laquelle elle est devenue experte introduit une lecture du roman à deux niveaux. La « rentabilité « narrative du personnage est grande, et ce dès le début de l'intrigue, puisque Thérèse est présentée comme un être en sommeil, insatisfait, occulté : « on ne voyait pas le corps, qui se perdait dans l'ombre « (ch. I). De nombreuses indications convergent pour faire saisir avec de plus en plus d'insistance lasingularité de Thérèse au sein d'un univers uniforme, immobile, plat et cyclique, tel qu'il est symbolisé au ch. IV par les soirées et la compagnie du jeudi : « Les soirées du jeudi étaient un supplice pour elle. […] Toutes ces têtes-là l'exaspéraient. Elle allait de l'une à l'autre avec des dégoûts profonds. « L'irruption de Laurent est donc perçue comme une détente et un réveil en forme d'explosion attendue. Lorsque Thérèse reçoit son amant dans sa chambre pour la première fois, elle se transforme en créature radieuse, en « déesse de l'amour « : « Laurent, étonné, trouva sa maîtresse belle. Il n'avait jamais vu cette femme. Thérèse, souple et forte, le serrait, renversant la tête en arrière, et, sur son visage, couraient des lumières ardentes, des sourires passionnés. Cette face d'amante s'était comme transfigurée, elle avait un air fou et caressant ; les lèvres humides, les yeux luisants, elle rayonnait. La jeune femme, tordue et ondoyante était belle d'une beauté étrange, toute d'emportement. On eût dit que sa figure venait de s'éclairer en dedans, que des flammes s'échappaient de sa chair. Et, autour d'elle, son sang qui brûlait, ses nerfs qui se tendaient, jetaient ainsi des effluves chauds, un air pénétrant et âcre « (ch. VII). C'est une représentation de la sexualité féminine comme illumination et transgression, qui associe la lumière et la chaleur, dans une sorte d'orgasme sensible et visible de l'extérieur. Seulement la suite du texte est significative de la surimposition d'une interprétation traditionnelle, judéo-chrétienne, qui condamne le péché de chair : « Au premier baiser, elle se révéla courtisane. « La sensualité est d'abord présentée comme une aspiration à la vie, elle se traduit comme une ascension graduelle vers la lumière, une communion avec les forces telluriques de la nature, mais l'ambivalence est nette. Les forces de vie se déchaînent sans contrôle et éros rencontrera thanatos, la perversité et le crime. Alors que Laurent subit une transformation progressive, sous l'influence du tempérament nerveux de sa compagne, Thérèse, elle, semble plutôt persévérer dans son être : « […] ses instincts de femme nerveuse éclat(ent) avec une violence inouïe « (ch. VII) et le narrateur précisera ultérieurement que « […] chez elle, la nature première n'avait fait que s'exalter outre mesure « (ch. XXII). Alors que du sang le flux peut se réduire, les nerfs sont une composante réactive de l'organisme, ils résistent et persistent malgré la « dépression « que leur inflige le milieu ambiant : « Ils ont fait de moi une hypocrite et une menteuse… Ils m'ont étouffée dans leur douceur bourgeoise, et je ne m'explique pas comment il y a encore du sang dans mes veines « (ch. VII). Il faut voir là une première interprétation, qui sera dépassée lorsque le personnage aura pris conscience, après le meurtre, de la nécessité de « brider « en quelque sorte le tempérament nerveux. C'est la première signification, matérialiste, psycho-physiologique, de ses « remords «. Si l'éducation qu'a reçue Thérèse, « la façon dont elle grandissait dans l'air tiède et nauséabond de la chambre où râlait le petit Camille «, contrarie par trop l'expression de sa nature, il n'est pas certain que la crise qui surviendra lui fasse retrouver un équilibre. Au ch. XXII, Zola refait l'historique du « cas « Thérèse : après son adolescence, il s'est amassé en elle « des orages, des fluides puissants qui devaient éclater plus tard en véritables tempêtes. Laurent avait été pour elle ce qu'elle avait été pour Laurent, une sorte de choc brutal «. Dans cette météorologie de la vie intérieure, le climat associé à la femme nerveuse est de type méditerranéen ou subtropical, caractérisé par l'instabilité dans l'excès : « Dès la première étreinte d'amour, son tempérament sec et voluptueux s'était développé avec une énergie sauvage ; elle n'avait plus vécu que pour la passion. S'abandonnant de plus en plus aux fièvres qui la brûlaient, elle en était arrivée à une sorte de stupeur maladive « (ibid.). On a évidemment remarqué que, dans cette symptomatologie du comportement de Thérèse, avec ses phases climatériques, ses diathèses, ses pics d'hystérie, Zola avait un peu tendance, comme nombre de ses contemporains qui spéculent sur une nature qui leur échappe, à généraliser et à superposer un schéma moralisateur sur l'« analyse « pseudo-médicale. On en veut pour preuve la suite du texte sur la même page du ch. XXII : « Les faits l'écrasaient, tout la poussait à la folie. Dans ses effrois, elle se montrait plus femme[8] que son nouveau mari ; elle avait de vagues remords, des regrets inavoués ; il lui prenait des envies de se jeter à genoux et d'implorer le spectre de Camille, de lui demander grâce en lui jurant de l'apaiser par son repentir. « La théorie de l'imprégnation (du premier amant) s'associe étroitement au puritanisme pour enserrer la femme dans le carcan de la culpabilité, avec ses connotations religieuses. Dans son dérèglement, l'épouse infidèle ne demande qu'à effacer son deuxième mariage et elle réclame le pardon de Camille, doté de l'autorité initiale que la loi et l'église lui reconnaissent conjointement. Thérèse est alors l'incarnation de la pécheresse, une nouvelle Ève, elle partage le sort de toutes ses mères et sœurs adultères, de Marie-Madeleine à Madame Bovary. La « conscience « du mal et le sens de la faute que Zola confère à son héroïne sont en quelque sorte des caractères à peine secondaires de sa féminité. À ce titre ils ne seront pas perçus comme des adjonctions thématiques, descriptives et narratives arbitraires, mais comme un destin inscrit dans l'hérédité générale, générique et génétique, de la femme : « Thérèse Raquin, ou le péché originel[9] «. Ce modèle anthropologique et moral régit la représentation de la femme dans l'ensemble de la littérature du XIXe siècle, à une époque où cette dernière commence à s'émanciper progressivement de la tutelle masculine, par le travail notamment, ou par l'activité intellectuelle. Dans Thérèse Raquin, Zola prend bien soin de montrer les périls de la lecture des romans sur la sensibilité féminine. Tout en dénigrant un certain type de littérature de grande consommation, assimilable effectivement à un opium, il insiste sur la vulnérabilité particulière des femmes et sur leur propension à rêver, à se laisser bercer par des « contes bleus « : « Elle s'abonna à un cabinet littéraire et se passionna pour tous les héros des contes qui lui passèrent sous les yeux. Ce subit amour de la lecture eut une grande influence sur son tempérament. Elle acquit une sensibilité nerveuse qui la faisait rire ou pleurer sans motif « (ch. XVI). Zola, comme Flaubert dans Madame Bovary (1857) confère à la lecture des romans sentimentaux un pouvoir capable de briser l'équilibre psychologique des individus faibles, des enfants, des vieillards, mais surtout des femmes, dont les nerfs, encore une fois, n'ont pas besoin d'être excités. Le crime du ch. XI avait contribué à restituer en Thérèse une sorte de paix intérieure, la lecture met fin à cette stase : « L'équilibre, qui tendait à s'établir en elle, fut rompu. Elle tomba dans une sorte de rêverie vague « (ch. XVI). Dans la pièce de théâtre issue du roman, Zola maintiendra cette critique implicite de la lecture en la reportant sur le personnage de Suzanne, amoureuse d'un inconnu qu'elle nomme « le prince bleu «. Après avoir épuisé les ressources de la lecture et de la comédie du remords, après avoir mimé la tendresse et la contrition à l'égard de sa tante, Thérèse cherche une distraction à ses maux dans l'adultère. Une autre parade exprime le schéma de la domination masculine : Thérèse en vient à réclamer la violence de son époux et entre dans une relation trouble de complaisance, de masochisme, qui peut s'assimiler partiellement à la recherche d'un châtiment : « Thérèse mollissait sous les coups ; elle goûtait une volupté âpre à être frappée ; elle s'abandonnait, elle s'offrait, elle provoquait son mari pour qu'il l'assommât davantage. C'était encore un remède contre les souffrances de la vie ; elle dormait mieux la nuit, quand elle avait été bien battue le soir « (ch. XXIX). La provocation porte à son comble l'ambivalence qui caractérise la femme. Zola a réussi à faire de Thérèse un personnage complexe, une figure digne de donner son nom à un roman. L'expérimentateur naturaliste, qui devait se contenter d'étudier les effets du choc des tempéraments, s'est laissé emporter avec complaisance à martyriser cette créature de femme, pour en faire une grande pécheresse, une nouvelle femme fatale, à la fois conforme à la tradition de la littérature masculine et dotée d'un certain nombre de traits qui annoncent la venue des grandes amoureuses des Rougon-Macquart. Madame Raquin Dans la préface de 1868 à Thérèse Raquin, Zola limite la présentation des « personnages « au couple fatal du devant de la scène, Laurent et Thérèse, « souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair «, donc entièrement prévisibles parce que soumis à leur destin biologique. Mme Raquin, qui est une création originale par rapport au trio initial du Mariage d'amour, a un statut plus singulier, d'autant que son « destin « personnel, tout aussi tragique que celui des autres acteurs du drame, lui assure un certain nombre de métamorphoses qui peuvent surprendre le lecteur. Dans les premiers chapitres, elle apparaît dans son « rôle de composition « initial, celui de la vieille dame sans mystère et sans complications, dont le portrait est esquissé en quelques traits, après celui, plus évocateur, de sa belle-fille : « D'ordinaire, il y avait deux femmes assises derrière le comptoir ; la jeune femme au profil grave et une vieille dame qui souriait en sommeillant. Cette dernière avait environ soixante ans ; son visage gras et placide blanchissait sous les clartés de la lampe « (ch. I). D'après la distribution tempéramentielle, Mme Raquin est indéniablement une lymphatique, avec sa douceur naturelle et une propension à l'effacement qui ne compromettent pas la prise d'âge. L'évocation rapide du passé du personnage, réduit à quelques éléments insignifiants, fait d'elle une éternelle « bonne dame «, sans histoire(s) : « Madame Raquin était une ancienne mercière de Vernon. Pendant près de vingt-cinq ans, elle avait vécu dans une petite boutique de cette ville « (ch. II). Le premier caractère du personnage, souligné assez régulièrement, est cette propension au calme durable, à mettre en relation à la fois avec le tempérament, avec le conformisme petit-bourgeois et l'attrait des habitudes domestiques. Lorsque Camille décide de venir à Paris, sa mère se récrie : « Elle avait arrangé son existence, elle ne voulait point y changer un seul événement. « Cette attitude est caractéristique et l'aventure parisienne se résout en une reproduction du même, la « vie nouvelle « (ch. III) n'est que la réplique de la vie ancienne, selon un patron déjà établi. Si Mme Raquin a accepté toutefois de remettre un tant soit peu sa vie en mouvement, c'est parce qu'elle est avant tout une mère, superlativement pourrait-on dire, puisqu'elle est veuve et que son fils Camille est l'objet d'une affection envahissante et presque délirante. Si le sens de la famille amène cette mère à adopter sans réticence la petite Thérèse et à penser toujours à « ses chers enfants «, il n'en est pas moins orienté vers le fils unique. Cette monomanie du personnage n'est pas sans conséquence sur l'intrigue. Thérèse est confrontée à une dépendance et à un isolement affectif qui provoqueront l'adultère : « […] elle avait toujours montré une telle obéissance passive que sa tante et son mari ne prenaient plus la peine de lui demander son opinion. Elle allait où ils allaient, elle faisait ce qu'ils faisaient, sans une plainte, sans un reproche, sans même paraître savoir qu'elle changeait de place « (ch. III). La jeune femme est cantonnée dans le rôle ingrat de l'orpheline recueillie. Comme par ailleurs toutes les initiatives et toutes les décisions de Camille sont pour sa mère « parole d'évangile «, Laurent, en tant qu'ami, sera aisément accepté dans la boutique du Pont-Neuf et il pourra passer pour un deuxième fils, frère de Camille avant de devenir bientôt son remplaçant. Dans son aveuglement de mère, Mme Raquin pèche par inconscience et par excès de confiance. L'apathie et l'instinct maternel qui caractérisent le personnage seront perçus différemment au fur et à mesure que l'intrigue progresse. L'ironie tragique, qui vient de ce qu'elle va vivre en permanence en présence du couple criminel, rendra de plus en plus pathétique son affection. Le narrateur oriente énergiquement le portrait du personnage vers la pitié. Il se complaît dans les évocations où priment la sensibilité et l'humanité, désormais opposées de façon assez manichéenne au cynisme et au mensonge de Laurent et de Thérèse. La mort de son fils a déjà provoqué chez Mme Raquin un choc qui en fait désormais un être de douleur : « Et la pauvre mère voyait son fils roulé dans les eaux troubles de la Seine […] ; en même temps, elle le voyait tout petit dans son berceau, lorsqu'elle chassait la mort penchée sur lui. Elle l'avait mis au monde plus de dix fois, elle l'aimait pour tout l'amour qu'elle lui témoignait depuis trente ans. […] À ces pensées, madame Raquin sentait sa gorge se serrer ; elle espérait qu'elle allait mourir, étranglée par le désespoir « (ch. XII). Une relecture du passé s'impose, le personnage rejoint le groupe éternel des mères souffrantes, symbolisé par la figure mythologique de Niobé, qui se change en pierre de la douleur d'avoir perdu ses enfants. De la même façon Mme Raquin devient paralytique et accède à une autre vie, quasi mythique. Elle qui était vouée à un destin sans histoire va devenir un acteur essentiel du drame, un personnage fascinant, une piéta et une incarnation de la vengeance. Ses métamorphoses successives coïncident paradoxalement avec sa paralysie. Elle est par exemple présentée comme une sainte : « Ses yeux prenaient chaque jour une douceur, une clarté plus pénétrantes. Elle en était arrivée à se servir de ses yeux comme d'une main, comme d'une bouche pour demander et remercier. Elle suppléait ainsi, d'une façon étrange et charmante, aux organes qui lui faisaient défaut. Ses regards étaient beaux d'une beauté céleste, au milieu de sa face dont les chairs pendaient molles et grimaçantes. Depuis que ses lèvres tordues et inertes ne pouvaient plus sourire, elle souriait du regard, avec des tendresses adorables ; des lueurs humides passaient et des rayons d'aurore sortaient des orbites « (ch. XXVI). L'évocation est curieuse, très « littéraire « et difficile à rapporter au projet de roman « scientifique «. Le narrateur intervient pour renchérir sur l'aspect merveilleux de cette transformation du personnage, il insiste sur sa beauté intérieure, forcément invisible pour tous les autres personnages, figés dans leur nature. Le lecteur est invité à partager ce point de vue omniscient et admiratif. Une nouvelle métamorphose fait passer Mme Raquin de la lumière céleste et de la pure bonté à la noirceur vengeresse, lorsque l'atroce vérité se fait jour : « Dans le brusque changement de son cœur, elle se cherchait avec égarement et ne se reconnaissait plus ; elle restait écrasée sous l'envahissement brutal des pensées de vengeance qui chassaient toute bonté de sa vie. Quand elle eut été transformée, il fit noir en elle ; elle sentit naître dans sa chair mourante un nouvel être, impitoyable et cruel, qui aurait voulu mordre les assassins de son fils. […] Mais aucun ressort ne la poussa, et le Ciel réserva son tonnerre « (ch. XXVI). Après la scène très mélodramatique du ch. XXVII où Mme Raquin tente désespérément de « galvaniser en quelque sorte sa main droite «, « une main vengeresse qui allait parler « pour dénoncer publiquement les coupables, l'intensité se reporte sur son regard. Déjà, après la crise du ch. XXVI, « ses yeux, si doux d'ordinaire, étaient devenus noirs et durs, pareils à des morceaux de métal «. C'est par les yeux qu'une véritécuisante est entrée : « La sinistre vérité, comme un éclair, brûla les yeux de la paralytique et entra en elle avec le heurt suprême d'un coup de foudre. « La connaissance soudaine de la vérité est présentée à la fois comme une révélation (étymologiquement l'action de laisser voir) et comme une sorte de châtiment. Mme Raquin accède à la connaissance de la façon la plus douloureuse qui soit, parce qu'elle comprend que ce qu'elle avait vu jusqu'à présent n'était qu'illusion : « Le voile qui se déchirait lui montrait, au-delà des amours et des amitiés qu'elle avait cru voir un spectacle effroyable de sang et de honte. Elle eût injurié Dieu, si elle avait pu crier au blasphème. Dieu l'avait trompée pendant plus de soixante ans, en la traitant en petite fille douce et bonne, en amusant ses yeux par des tableaux mensongers de joie tranquille. Et elle était demeurée enfant, croyant sottement à mille choses niaises, ne voyant pas la vie réelle se traîner dans la boue sanglante des passions. « On remarquera dans ce passage les mots qui renvoient justement à la vision et la distinction entre les apparences trompeuses d'une part, entretenues par l'idéalisme religieux, et « la vie réelle « d'autre part, résumée en des termes qui évoquent l'âpreté et la démystification du « regard « naturaliste. À la différence donc de Thérèse, de Laurent et plus encore des invités du jeudi qui prennent « le parti de traiter madame Raquin comme si rien ne lui était arrivé « (ibid.), le personnage de la mère connaît une évolution considérable, qui contraste absolument avec la « nature « et le tempérament initialement posés. Mme Raquin ne se reconnaît effectivement plus, le milieu et les circonstances ne sont plus des facteurs explicatifs suffisants et l'on entre dans une dimension tragique et « sacrée « a priori exclue du projet exhibé dans la préface. Inspirée peut-être par le Noirtier du Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas, Mme Raquin préfigure en outre une série de personnages singuliers qui apparaîtront périodiquement dans l'œuvre de Zola, des impotents ou des vieillards figés dans l'immobilité : la tante Dide, l'aïeule des Rougon-Macquart internée aux Tulettes, Chanteau, atteint par la goutte dans La Joie de vivre, le vieux Bonnemort dans Germinal, Tante Phasie dans La Bête humaine… Tous ces personnages apportent aux récits dans lesquels ils figurent un contrepoint dramatique et moral. Ils sont porteurs d'une leçon. « Moteurs immobiles «, comme les nomme Auguste Dezalay[10], ils relativisent l'agitation et le mouvement qui les entourent, ils servent de révélateurs : « Ces êtres immobilisés par le destin sont souvent des pôles d'attraction, ou des centres de convergence, de véritables points fixes dans le tournoiement autour d'eux des intérêts et des passions. « Mme Raquin prend d'ailleurs progressivement conscience de son « rôle « lorsqu'elle décide de ne pas se suicider : « Elle se dit qu'elle était lâche de mourir, qu'elle n'avait pas le droit de s'en aller avant d'avoir assisté au dénouement de la sinistre aventure. Alors seulement elle pourrait descendre dans la nuit, pour dire à Camille : “Tu es vengé” « (ch. XXX). Nouvelle statue du Commandeur, elle devient porteuse d'un dénouement dont la logique profonde est celle de la morale la plus traditionnelle, comme dans ces contes et ces récits élémentaires où l'équilibre entre le bien et le mal est finalement restauré : « Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui fallait s'assoupir dans la joie cuisante de la vengeance, il lui fallait emporter un rêve de haine satisfaite, un rêve qu'elle ferait pendant l'éternité « (ibid.). Comme si la mort avait décidé de l'épargner définitivement, Mme Raquin survit en fait aux époux criminels et, figée comme un marbre funéraire dans une scène extrêmement frappante, elle incarne désormais la mémoire du drame : « Et, pendant près de douze heures, jusqu'au lendemain vers midi, Mme Raquin, roide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds. « Les personnages secondaires Sans être très nombreux dans ce mince roman zolien très différent des massifs desRougon-Macquart qui, à l'instar de Balzac, font « concurrence à l'état civil « et recomposent la réalité sociale dans son ensemble, ils n'en sont pas moins omniprésents. Ils confèrent à Thérèse Raquin une dimension satirique qui trouvera son plein épanouissement dans Pot-Bouille, le roman des horreurs bourgeoises, où triomphent les mesquineries et les préjugés que Zola s'est toujours efforcé de dénoncer en faisant éclater le vernis des apparences et l'hypocrisie des bons sentiments. Cette visée du moraliste, qui relève d'une vieille tradition, illustrée par les Caractères de La Bruyère, est sensible dansThérèse Raquin. Les personnages secondaires sont introduits très rapidement à travers le rituel des jeudis soirs, qui symbolise la régularité, la monotonie et la circularité du mode de vie de la petite-bourgeoisie des grandes villes, artisans, commerçants, employés, dont Zola propose un échantillon représentatif, après avoir évoqué brièvement au ch. I « des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfant, des cartonniers «, et un peu plus précisément la « marchande de bijoux faux «, qui symbolise peut-être le commerce en général. Ces petits boutiquiers du passage du Pont-Neuf semblent tout droit sortis d'un roman de Balzac, mais il leur manque la profondeur et l'énergie qui caractérisent tous les personnages que modèle la main puissante de l'auteur de La Comédie humaine. C'est un monde en déclin que peint Zola, celui sur lequel il reviendra dans Au Bonheur des dames en opposant la noire mercerie du vieux Baudu au grand magasin d'Octave Mouret. On a pu en outre interpréter ces « réceptions du jeudi « comme une projection de la hantise de la mécanisation de la vie dont Zola dénonce, dans La Fortune des Rougon une autre forme : « Cette vie provinciale qui prenait les enfants tout jeunes dans l'engrenage de son manège, l'habitude du cercle, le journal épelé jusqu'aux annonces, la partie de dominos sans cesse recommencée, la même promenade à la même heure sur la même avenue, l'abrutissement final sous cette meule qui aplatit les cervelles. « Il est curieux en tout cas que Zola ait pensé au jeudi pour fixer le rendez-vous hebdomadaire de ses médiocres, car c'est le jour qu'il avait lui-même choisi pour recevoir ses amis. Dans ce monde de cloportes des vieux quartiers évoqué au tout début de Thérèse Raquin, le narrateur laisse entendre qu'il aurait pu tout aussi bien s'intéresser à n'importe quelle maison. Une fois qu'a été choisie la boutique des Raquin, l'objectif resserre la vision sur la vie plate des habitants. Tous les jeudis soirs, se rassemblent donc autour de la famille Raquin, pour « une orgie bourgeoise d'une gaieté folle « (ch. IV), les Michaud et Grivet. Même si lors des parties de dominos le point de vue hostile et dégoûté de Thérèse l'emporte, puisque Zola a choisi de faire d'elle un personnage différent, inassimilable par le groupe, le narrateur renchérit sur la médiocrité en usant d'ironie. La distance critique et l'exploitation narrative du groupe-actant vont de pair. Il faut remarquer par exemple le caractère symbolique du métier attribué aux Michaud père et fils. L'un est commissaire de police à la retraite ; il devrait avoir l'expérience « du terrain «, le coup d'œil des policiers de La Comédie humaine, souvent présenté comme « fin « et « foudroyant « (en particulier dans La Cousine Bette). Olivier Michaud, quant à lui, est « commis principal dans le bureau de la police d'ordre et de sûreté «, ce que l'on nommerait aujourd'hui la préfecture de police de Paris. Sa connaissance des dossiers et sa situation privilégiée dans un observatoire central de la criminalité devraient lui conférer l'attention aux détails et la sagacité, qualités dont il est pourtant complètement dépourvu. À eux deux, ces personnages font une piètre équipe, ils sont l'antithèse de ce qu'ils auraient pu incarner. L'ironie consiste même à faire d'eux des protecteurs actifs de l'adultère et du crime. Au chapitre XII, la présence d'Olivier Michaud sur les lieux du crime hâte le procès-verbal de l'agent de police : « Tout fut terminé en dix minutes. « Le comble de l'aveuglement est atteint au chapitre XXVII, lors de la scène où la paralytique tente désespérément d'écrire le nom des deux coupables sur la toile cirée de la table de jeu : « Michaud et Olivier se penchaient, ne pouvant lire, forçant l'impotente à toujours reprendre les premières lettres. « Le narrateur prend un malin plaisir à illustrer l'expression convenue pour stigmatiser l'accumulation des incapacités : « l'aveugle et le paralytique « ! À chaque étape du drame, Zola utilise donc l'un de ces relais. Après le crime, une immense connivence du vraisemblable permet à Laurent de vivre en toute impunité. Le « réel « a un scénario pour chaque situation. Les journaux s'emparent du fait-divers et font du criminel un héros : « Le lendemain, les journaux racontèrent l'accident avec un grand luxe de détails ; la malheureuse mère, la veuve inconsolable, l'ami noble et courageux, rien ne manquait à ce fait-divers, qui fit le tour de la presse parisienne et qui alla ensuite s'enterrer dans les feuilles des départements « (ch. XI). L'intérêt de ce genre de notation est de montrer que les personnages secondaires que nous voyons de plus près sont représentatifs de l'environnement dans lequel vivent les héros, et qu'au drame vrai que les lecteurs connaissent sont généralement préférées les rumeurs et les fictions entretenues par la doxa, par l'opinion commune, telle qu'elle se reflète dans les journaux. Quand Laurent rejoint son emploi au lendemain du crime, il conte « l'accident d'une voix émue « : « Lorsque ses collègues eurent lu le fait divers qui courait dans la presse, il devint un véritable héros. Pendant une semaine, les employés du chemin de fer d'Orléans n'eurent pas d'autre sujet de conversation ; ils étaient tout fiers qu'un des leurs se fût noyé. Grivet ne tarissait pas sur l'imprudence qu'il y a à s'aventurer en pleine Seine, quand il est si facile de regarder couler l'eau en traversant les ponts « (ch. XIII). En fait, les personnages secondaires vivent dans la peur et chacune de leur « réflexion « vise à maintenir un équilibre précaire. Ce n'est qu'à travers le regard de Thérèse que nous voyons des « créatures grotesques et sinistres «, des « cadavres mécaniques remuant la tête « (ch. IV). Grivet et Olivier sont en fait des peureux, des « bonnes gens « qu'effraie la moindre histoire de croquemitaine. Lorsque le commissaire raconte « les étranges et sinistres aventures auxquelles il avait dû être mêlé «, Grivet et Camille écoutent ces propos « avec la face effrayée et béante des petits enfants qui entendent Barbe-Bleue ou Le Petit Poucet « (ch. X). Si l'on y réfléchit, ces personnages sont restés des enfants, ils en ont les peurs et la naïveté. À travers les Michaud et Grivet, ce sont les modes de pensée et les préjugés généraux, ambiants, qui sont systématiquement dénoncés par l'écrivain. Zola prend bien soin de construire à l'intérieur de son court roman une petite encyclopédie de la vie des petits-bourgeois et il recense leurs attitudes autour des activités et des événements qui remplissent leur existence : le bureau, les promenades, les « parties « de dominos et de campagne, les « douces et calmes soirées « (ch. VIII), les conversations courantes, faites « des mille riens de la journée, des souvenirs de la veille et des espoirs du lendemain « (ibid.), le mariage, l'accident, le fait-divers, la lecture des journaux… Une même attitude permet de répondre à chaque circonstance de la vie, un même régime de banalisation systématique et de maintien de l'inertie sert de fondement à la société et au réel, pour qu'il soit sans histoire et sans angoisse. François Le chat François apparaît toujours dans une sorte de pose picturale. Au ch. I, il complète le tableau que le romancier fait des deux femmes, Mme Raquin et sa belle-fille. Il est présenté comme « un gros chat tigré, accroupi sur un angle du comptoir «. Il est très vite associé à Thérèse, comme attribut décoratif et signifiant. Zola s'est manifestement inspiré pour ce « personnage « du tableau de Manet, Olympia, parfois appelé la Vénus au chat ou Le Chat noir et souvent critiqué pour la présence incongrue de l'animal, perçue comme une provocation gratuite. Dans le roman, le chat François est lui-même appréhendé comme un ennemi dangereux par Laurent qui, faut-il le rappeler, est un personnage associé à la peinture. Son malaise en face de l'animal est peut-être une transposition de l'incompréhension du public en face de ce mystère qu'a représenté le chat noir au pied de la courtisane. Manet, qui s'était inspiré de la Venus d'Urbino du Titien, avait subverti le tableau mythologique, notamment en transformant le chien couché paisiblement en rond en chat noir et maigre (donc non castré et habituellement « coureur «) dressé sur ses pattes avec la queue raide, détail que les commentateurs de l'époque n'avaient pas manqué d'interpréter comme un symbole de sexualité agressive. Ce lien entre le chat et la sexualité féminine, sur un mode troublant, est tout aussi patent au sein du roman. François est une extériorisation symbolique de la sexualité féminine, invisible sous l'allure paisible, mais animale, donc imprévisible. Mais si la femme peut être un félin (ce sera à nouveau le cas dans La Curéeavec le personnage de Renée), le chat, lui, garde son indépendance mystérieuse et sa fixité marmoréenne, comme au ch. VII : « Thérèse plaisantait comme un enfant, elle mimait le chat, elle allongeait les mains en façon de griffes, elle donnait à ses épaules des ondulations félines. François gardant une immobilité de pierre, la contemplait toujours ; ses yeux seuls paraissaient vivants ; et il y avait, dans les coins de sa gueule, deux plis profonds qui faisaient éclater de rire cette tête d'animal empaillé. « Le chat est bien, comme dans les poèmes de Baudelaire, un symbole ambivalent et fascinant, oscillant entre le doux et le sournois, avec son allure de sphinx et la violence possible de ses réactions. Autant Thérèse s'accommode de cet animal familier, qu'elle caresse et assoit sur ses genoux, dans une attitude complice, autant Laurent voit en lui un danger et une incarnation diabolique : « Laurent se sentait froid aux os. Il trouva ridicule la plaisanterie de Thérèse. Il se leva et mit le chat à la porte. En réalité, il avait peur. « Le nom que porte l'animal fait de lui un membre à part entière de la famille Raquin, et, progressivement, la réincarnation ou la projection des opposants de Laurent. Thérèse commence par le mimer, mais il est ensuite perçu de façon fantastique. Lorsque les amants versent dans la pensée magique et la superstition sous le coup de leurs déséquilibres nerveux, ils ont tendance à « halluciner « la présence de l'animal. Au ch. XXI, Laurent croit que Camille est « entré « dans le chat : « François eut peur de Laurent ; d'un bond, il sauta sur une chaise ; le poil hérissé, les pattes roidies, il regardait son nouveau maître en face, d'un air dur et cruel. Le jeune homme n'aimait pas les chats, François l'effrayait presque. Dans cette heure de fièvre et de crainte, il crut que le chat allait lui sauter au visage pour venger Camille. Cette bête devait tout savoir : il y avait des pensées dans ses yeux ronds étrangement dilatés. Laurent baissa les paupières, devant la fixité de ces regards de brute. « Ce dernier vocable, loin de dévaluer l'animal, fait de lui un actant à part entière, désigné par l'étiquette que Zola applique aux personnages principaux dans sa préface de 1868. François, comme Camille, accède ensuite à la dignité paradoxale d'assassiné, au ch. XXX. La scène est traitée avec un sens du détail qui l'aligne sur celle du ch. XI, dont elle est un remake : « [Laurent] ouvrit toute grande la fenêtre de la salle à manger, et vint prendre le chat par la peau du cou. Madame Raquin comprit ; deux grosses larmes coulèrent sur ses joues. Le chat se mit à jurer, à se roidir, en tâchant de se retourner pour mordre la main de Laurent. « Jeté dans l'air comme l'autre a été jeté dans l'eau, le chat, saisi de la même façon que Camille, se débat avec la même énergie désespérée que son maître et cherche à infliger à son tour une morsure fatale à son agresseur. Les deux femmes réagissent de façon tout aussi significative : « Thérèse eut une atroce crise de nerfs « et Madame Raquin « pleura François autant qu'elle avait pleuré Camille «. Mais le chat revivra une dernière réincarnation vengeresse après la mort des amants, à travers sa vieille maîtresse, figée comme il l'était, et concentrant dans son regard la désapprobation portée à son comble au fil des événements : « Et, pendant près de onze heures, jusqu'au lendemain vers midi, madame Raquin, roide et muette, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds « (ch. XXXII). François-Marie Mourad [1] Technique aujourd'hui à peu près tombée en désuétude, selon laquelle il serait possible de connaître le caractère d'une personne par l'examen de sa morphologie et des traits de son visage. [2] Proche, par un jeu de mots que la critique a déjà signalé, de « camomille «, puisque le personnage vit dans les remèdes et les tisanes. [3] Mais un proverbe allemand s'applique assez bien à la suite prévisible de l'histoire : « Schadenfroh geht's morgen so « : celui qui éprouve le plaisir de voir souffrir autrui souffrira de même. [4] Rodolphe Walter, « Zola à Bennecourt en 1867, Thérèse Raquin vingt ans avant La Terre «, Les Cahiers naturalistes, n° 33, 1967, p. 25-26. [5] Voir le tableau de Courbet (un autoportrait de l'artiste), Le Désespéré (1843). [6] Dans son édition de Thérèse Raquin, au Livre de poche. [7] À ne pas confondre dans un premier temps avec le racisme, qui prône la discrimination et le rejet. Le racialisme est une théorie à caractère scientifique née au milieu du XIXe siècle (chez Gobineau notamment, qui publie en 1853 un Essai sur l'inégalité des races humaines) qui cherche à reconnaître les différences (notamment héréditaires) entre les races humaines. L'orientation idéologique de cette théorie conduit cependant à terme au racisme pur et simple, ainsi abusivement fondé sur une démarche « scientifique «. [8] C'est nous qui soulignons. [9] C'est le titre d'un article de Chantal Jennings, Littérature, n° 23, octobre 1976, p. 94-101. [10] Auguste Dezalay, « Le Moteur immobile. Zola et ses paralytiques «, Travaux de linguistique et de littérature, Université de Strasbourg, VIII, n° 2, 1969, p. 63-74. RETOUR : Études d'œuvres