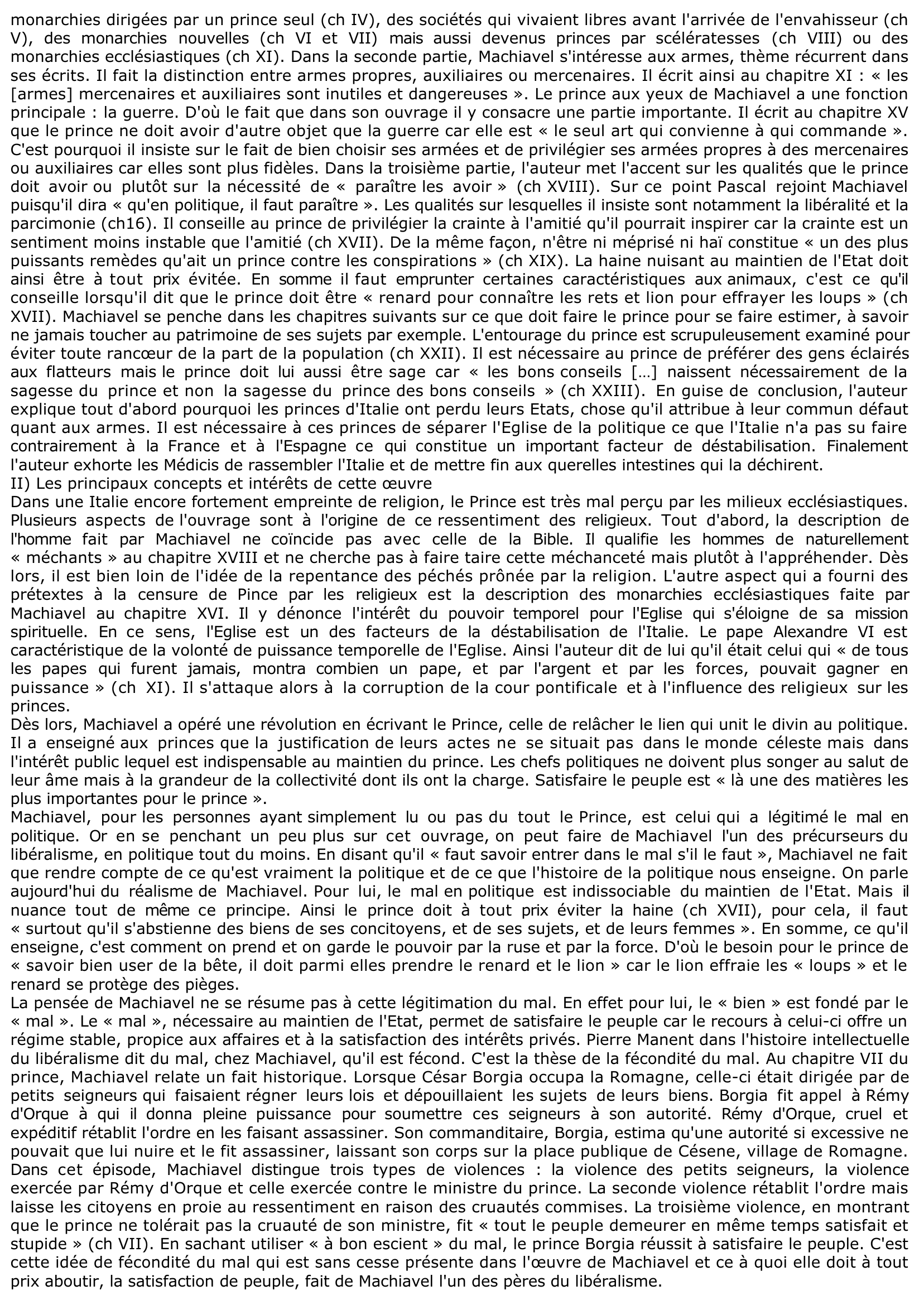Fiche de lecture : le Prince de Nicolas Machiavel
Publié le 31/07/2010

Extrait du document
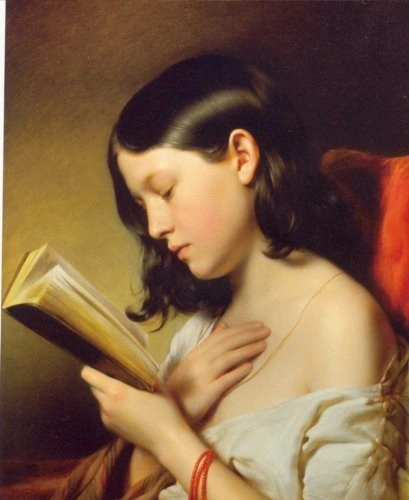
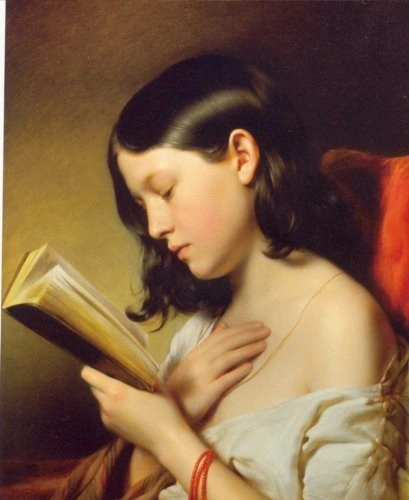
«
monarchies dirigées par un prince seul (ch IV), des sociétés qui vivaient libres avant l'arrivée de l'envahisseur (chV), des monarchies nouvelles (ch VI et VII) mais aussi devenus princes par scélératesses (ch VIII) ou desmonarchies ecclésiastiques (ch XI).
Dans la seconde partie, Machiavel s'intéresse aux armes, thème récurrent dansses écrits.
Il fait la distinction entre armes propres, auxiliaires ou mercenaires.
Il écrit ainsi au chapitre XI : « les[armes] mercenaires et auxiliaires sont inutiles et dangereuses ».
Le prince aux yeux de Machiavel a une fonctionprincipale : la guerre.
D'où le fait que dans son ouvrage il y consacre une partie importante.
Il écrit au chapitre XVque le prince ne doit avoir d'autre objet que la guerre car elle est « le seul art qui convienne à qui commande ».C'est pourquoi il insiste sur le fait de bien choisir ses armées et de privilégier ses armées propres à des mercenairesou auxiliaires car elles sont plus fidèles.
Dans la troisième partie, l'auteur met l'accent sur les qualités que le princedoit avoir ou plutôt sur la nécessité de « paraître les avoir » (ch XVIII).
Sur ce point Pascal rejoint Machiavelpuisqu'il dira « qu'en politique, il faut paraître ».
Les qualités sur lesquelles il insiste sont notamment la libéralité et laparcimonie (ch16).
Il conseille au prince de privilégier la crainte à l'amitié qu'il pourrait inspirer car la crainte est unsentiment moins instable que l'amitié (ch XVII).
De la même façon, n'être ni méprisé ni haï constitue « un des pluspuissants remèdes qu'ait un prince contre les conspirations » (ch XIX).
La haine nuisant au maintien de l'Etat doitainsi être à tout prix évitée.
En somme il faut emprunter certaines caractéristiques aux animaux, c'est ce qu'ilconseille lorsqu'il dit que le prince doit être « renard pour connaître les rets et lion pour effrayer les loups » (chXVII).
Machiavel se penche dans les chapitres suivants sur ce que doit faire le prince pour se faire estimer, à savoirne jamais toucher au patrimoine de ses sujets par exemple.
L'entourage du prince est scrupuleusement examiné pouréviter toute rancœur de la part de la population (ch XXII).
Il est nécessaire au prince de préférer des gens éclairésaux flatteurs mais le prince doit lui aussi être sage car « les bons conseils […] naissent nécessairement de lasagesse du prince et non la sagesse du prince des bons conseils » (ch XXIII).
En guise de conclusion, l'auteurexplique tout d'abord pourquoi les princes d'Italie ont perdu leurs Etats, chose qu'il attribue à leur commun défautquant aux armes.
Il est nécessaire à ces princes de séparer l'Eglise de la politique ce que l'Italie n'a pas su fairecontrairement à la France et à l'Espagne ce qui constitue un important facteur de déstabilisation.
Finalementl'auteur exhorte les Médicis de rassembler l'Italie et de mettre fin aux querelles intestines qui la déchirent.II) Les principaux concepts et intérêts de cette œuvreDans une Italie encore fortement empreinte de religion, le Prince est très mal perçu par les milieux ecclésiastiques.Plusieurs aspects de l'ouvrage sont à l'origine de ce ressentiment des religieux.
Tout d'abord, la description del'homme fait par Machiavel ne coïncide pas avec celle de la Bible.
Il qualifie les hommes de naturellement« méchants » au chapitre XVIII et ne cherche pas à faire taire cette méchanceté mais plutôt à l'appréhender.
Dèslors, il est bien loin de l'idée de la repentance des péchés prônée par la religion.
L'autre aspect qui a fourni desprétextes à la censure de Pince par les religieux est la description des monarchies ecclésiastiques faite parMachiavel au chapitre XVI.
Il y dénonce l'intérêt du pouvoir temporel pour l'Eglise qui s'éloigne de sa missionspirituelle.
En ce sens, l'Eglise est un des facteurs de la déstabilisation de l'Italie.
Le pape Alexandre VI estcaractéristique de la volonté de puissance temporelle de l'Eglise.
Ainsi l'auteur dit de lui qu'il était celui qui « de tousles papes qui furent jamais, montra combien un pape, et par l'argent et par les forces, pouvait gagner enpuissance » (ch XI).
Il s'attaque alors à la corruption de la cour pontificale et à l'influence des religieux sur lesprinces.Dès lors, Machiavel a opéré une révolution en écrivant le Prince, celle de relâcher le lien qui unit le divin au politique.Il a enseigné aux princes que la justification de leurs actes ne se situait pas dans le monde céleste mais dansl'intérêt public lequel est indispensable au maintien du prince.
Les chefs politiques ne doivent plus songer au salut deleur âme mais à la grandeur de la collectivité dont ils ont la charge.
Satisfaire le peuple est « là une des matières lesplus importantes pour le prince ».Machiavel, pour les personnes ayant simplement lu ou pas du tout le Prince, est celui qui a légitimé le mal enpolitique.
Or en se penchant un peu plus sur cet ouvrage, on peut faire de Machiavel l'un des précurseurs dulibéralisme, en politique tout du moins.
En disant qu'il « faut savoir entrer dans le mal s'il le faut », Machiavel ne faitque rendre compte de ce qu'est vraiment la politique et de ce que l'histoire de la politique nous enseigne.
On parleaujourd'hui du réalisme de Machiavel.
Pour lui, le mal en politique est indissociable du maintien de l'Etat.
Mais ilnuance tout de même ce principe.
Ainsi le prince doit à tout prix éviter la haine (ch XVII), pour cela, il faut« surtout qu'il s'abstienne des biens de ses concitoyens, et de ses sujets, et de leurs femmes ».
En somme, ce qu'ilenseigne, c'est comment on prend et on garde le pouvoir par la ruse et par la force.
D'où le besoin pour le prince de« savoir bien user de la bête, il doit parmi elles prendre le renard et le lion » car le lion effraie les « loups » et lerenard se protège des pièges.La pensée de Machiavel ne se résume pas à cette légitimation du mal.
En effet pour lui, le « bien » est fondé par le« mal ».
Le « mal », nécessaire au maintien de l'Etat, permet de satisfaire le peuple car le recours à celui-ci offre unrégime stable, propice aux affaires et à la satisfaction des intérêts privés.
Pierre Manent dans l'histoire intellectuelledu libéralisme dit du mal, chez Machiavel, qu'il est fécond.
C'est la thèse de la fécondité du mal.
Au chapitre VII duprince, Machiavel relate un fait historique.
Lorsque César Borgia occupa la Romagne, celle-ci était dirigée par depetits seigneurs qui faisaient régner leurs lois et dépouillaient les sujets de leurs biens.
Borgia fit appel à Rémyd'Orque à qui il donna pleine puissance pour soumettre ces seigneurs à son autorité.
Rémy d'Orque, cruel etexpéditif rétablit l'ordre en les faisant assassiner.
Son commanditaire, Borgia, estima qu'une autorité si excessive nepouvait que lui nuire et le fit assassiner, laissant son corps sur la place publique de Césene, village de Romagne.Dans cet épisode, Machiavel distingue trois types de violences : la violence des petits seigneurs, la violenceexercée par Rémy d'Orque et celle exercée contre le ministre du prince.
La seconde violence rétablit l'ordre maislaisse les citoyens en proie au ressentiment en raison des cruautés commises.
La troisième violence, en montrantque le prince ne tolérait pas la cruauté de son ministre, fit « tout le peuple demeurer en même temps satisfait etstupide » (ch VII).
En sachant utiliser « à bon escient » du mal, le prince Borgia réussit à satisfaire le peuple.
C'estcette idée de fécondité du mal qui est sans cesse présente dans l'œuvre de Machiavel et ce à quoi elle doit à toutprix aboutir, la satisfaction de peuple, fait de Machiavel l'un des pères du libéralisme..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Prince, le [Machiavel] - fiche de lecture.
- Fiche de lecture: Le Prince de Machiavel
- Période 1 NOM Numéro du livre Anissa Sirine Aurelie Nicolas Antoine Bertille Loïc Angélique Rémy Maëlle Christopher Cédric Marion Yohan Louise Jean Baptiste Marion Jean-Charles Laurianne Elsa Lidia Thomas Féderico Coller les 2 feuilles ensemble Date emprunt fiche de Numéro lecture
- Fiche de lecture : PETIT PRINCE (Le) de Saint-Exupéry
- Art POÉTIQUE de Nicolas Boileau (fiche de lecture)