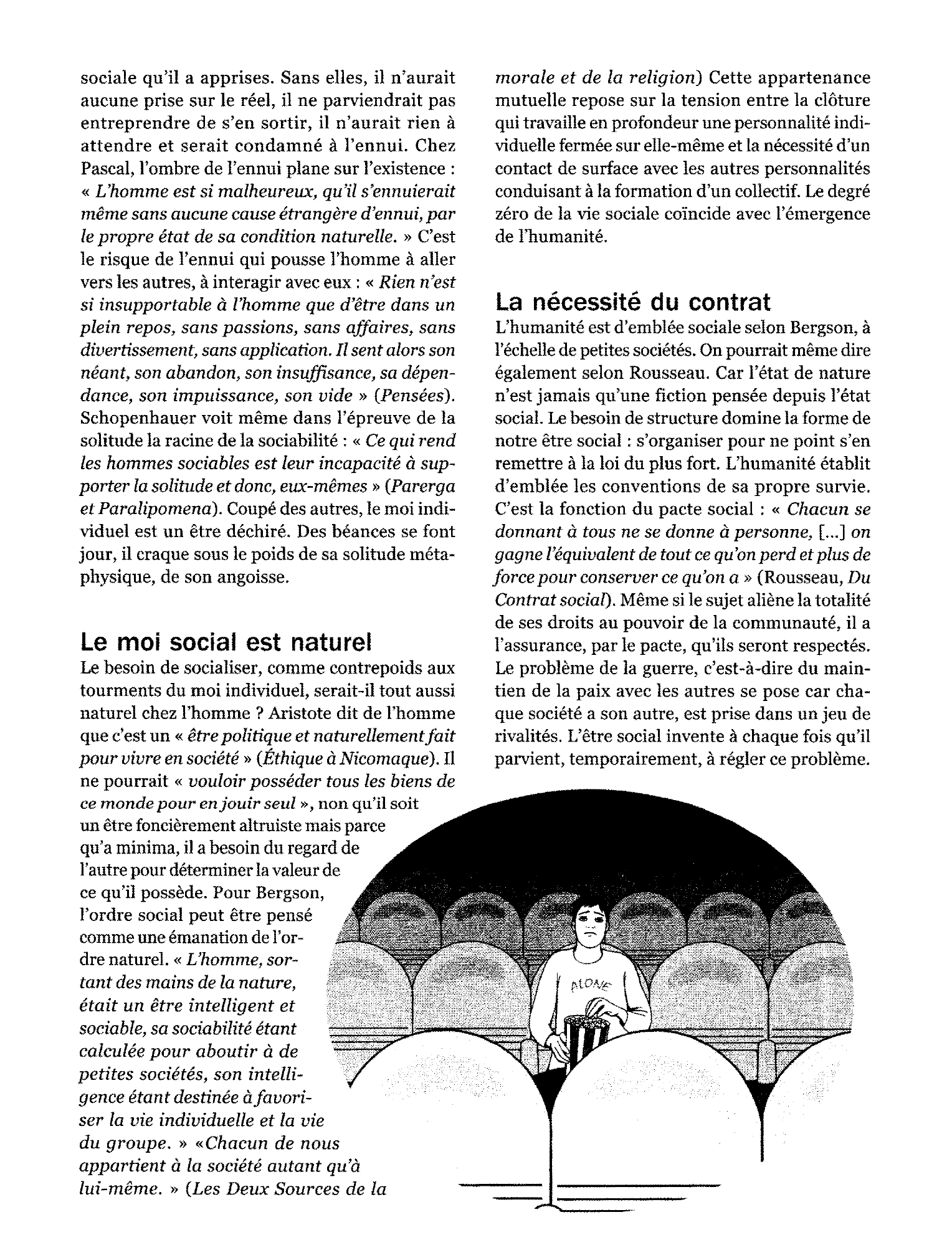Luanda
Extrait du document
«
LES DOSSIERS PHILO
sociale qu'il a apprises.
Sans elles, il n'aurait
aucune prise sur le réel, il ne parviendrait pas
entreprendre de s'en sortir, il n'aurait rien à
attendre et serait condamné à l'ennui.
Chez
Pascal, l'ombre
de l'ennui plane sur l'existence :
«L'homme est si malheureux, qu'il s'ennuierait
même sans aucune cause étrangère d'ennui,
par
le propre état de sa condition naturelle.
» C'est
le risque de l'ennui qui pousse l'homme
à aller
vers les autres, à interagir avec
eux: «Rien n'est
si insupportable à l'homme que d'être dans un
plein repos, sans passions, sans affaires, sans
divertissement, sans application.
Il sent alors son
néant, son abandon, son insuffisance, sa
dépen
dance, son impuissance, son vide» (Pensées).
Schopenhauer voit même dans l'épreuve de la
solitude la racine de la sociabilité : « Ce qui rend
les hommes sociables est leur incapacité à
sup
porter la solitude et donc, eux-mêmes » (Parerga
et Paralipomena).
Coupé des autres, le moi indi
viduel
est un être déchiré.
Des béances se font
jour, il craque sous le poids de
sa solitude méta
physique, de son angoisse.
le moi social est naturel
Le besoin de socialiser, comme contrepoids aux
tourments du moi individuel, serait-il
tout aussi
naturel chez l'homme
? Aristote dit de l'homme
que c'est
un « être politique et naturellement fait
pour vivre en société » (Éthique à Nicomaque).
Il
ne pourrait « vouloir posséder tous les biens de
ce monde pour en jouir seul>>, non qu'il soit
un être foncièrement altruiste mais parce
qu'a minima,
il a besoin du regard de
l'autre pour déterminer la valeur de
ce qu'il possède.
Pour Bergson,
l'ordre social
peut être pensé
comme une émanation de l'or
dre naturel.
« L'homme, sor
tant des mains de la nature,
était un être intelligent et
sociable, sa sociabilité étant
calculée
pour aboutir à de
petites sociétés, son intelli
gence étant destinée à favori
ser
la vie individuelle et la vie
du groupe.
» «Chacun de nous
appartient à
la société autant qu'à
lui-même.
» (Les Deux Sources de la
22
morale et de la religion) Cette appartenance
mutuelle repose sur la tension entre la clôture
qui travaille en profondeur une personnalité
indi
viduelle fermée sur elle-même et la nécessité d'un
contact de surface avec les autres personnalités
conduisant
à la formation d'un collectif.
Le degré
zéro de la vie sociale coïncide avec l'émergence
de l'humanité.
la nécessité du contrat
L'humanité est d'emblée sociale selon Bergson, à
l'échelle de petites sociétés.
On pourrait même dire
également selon Rousseau.
Car l'état de
nature
n'est jamais qu'une fiction pensée depuis l'état
social.
Le besoin de structure domine la forme de
notre être social : s'organiser
pour ne point s'en
remettre à la loi
du plus fort.
L'humanité établit
d'emblée les conventions de sa propre survie.
C'est la fonction
du pacte social : « Chacun se
donnant à tous ne se donne à personne, [
...
] on
gagne l'équivalent
de tout ce qu'on perd et plus de
force pour conserver ce qu'on a» (Rousseau, Du
Contrat social).
Même si le sujet aliène la totalité
de ses droits
au pouvoir de la communauté, il a
l'assurance,
par le pacte, qu'ils seront respectés.
Le problème de la guerre, c'est-à-dire du main
tien de la paix avec les autres se pose car cha
que société a
son autre, est prise dans un jeu de
rivalités.
L'être social invente à chaque fois qu'il
parvient, temporairement, à régler ce problème..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓