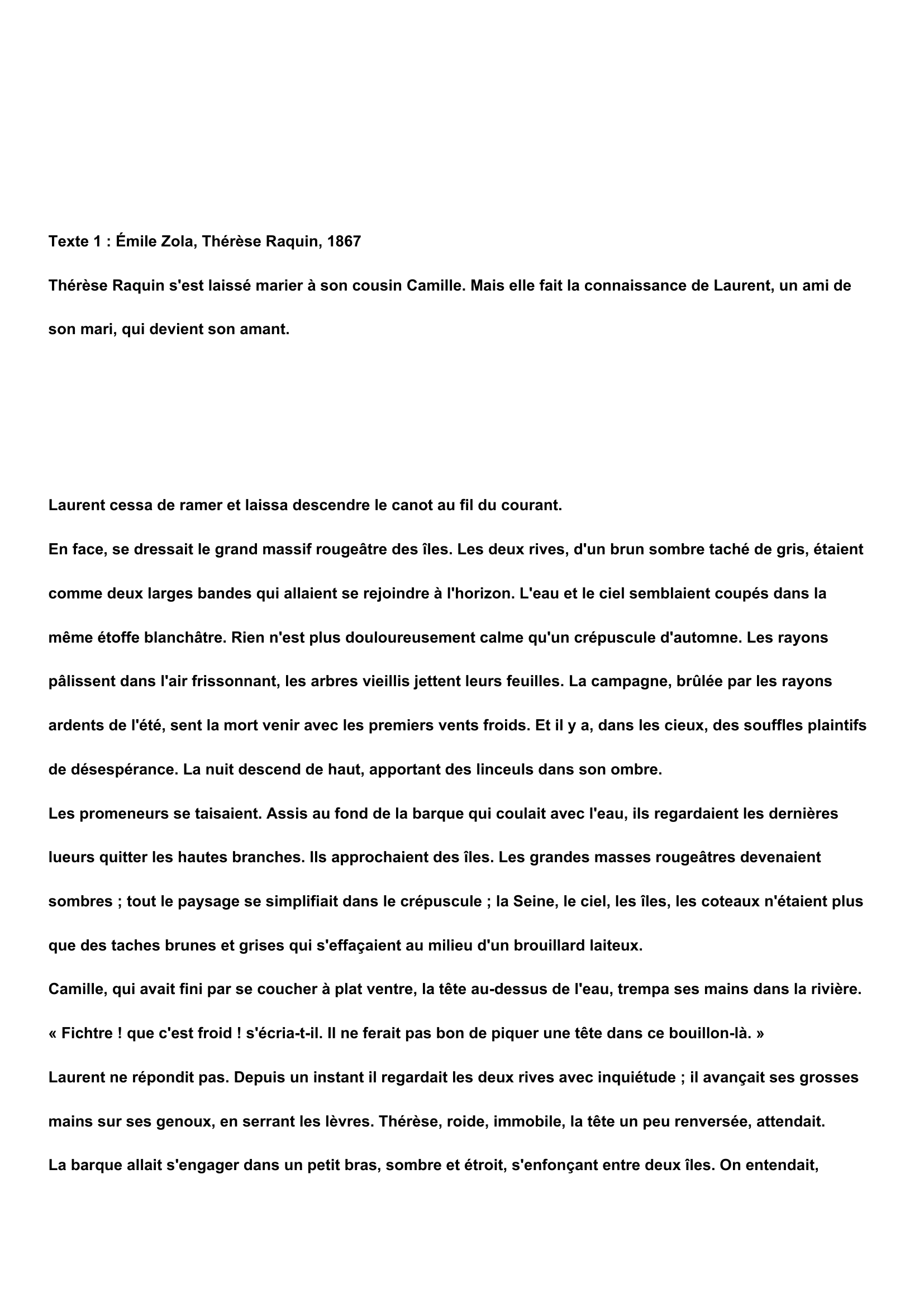Objet d’étude 1 : le roman Corpus Texte 1 : Émile Zola, Thérèse Raquin, 1867. Texte 2 : André Malraux, La Condition humaine, 1933. Texte 3 : Albert Camus, L’Étranger, 1942. Texte 1 : Émile Zola, Thérèse Raquin, 1867 Thérèse Raquin s’est laissé marier à son cousin Camille. Mais elle fait la connaissance de Laurent, un ami de son mari, qui devient son amant. Laurent cessa de ramer et laissa descendre le canot au fil du courant. En face, se dressait le grand massif rougeâtre des îles. Les deux rives, d’un brun sombre taché de gris, étaient comme deux larges bandes qui allaient se rejoindre à l’horizon. L’eau et le ciel semblaient coupés dans la même étoffe blanchâtre. Rien n’est plus douloureusement calme qu’un crépuscule d’automne. Les rayons pâlissent dans l’air frissonnant, les arbres vieillis jettent leurs feuilles. La campagne, brûlée par les rayons ardents de l’été, sent la mort venir avec les premiers vents froids. Et il y a, dans les cieux, des souffles plaintifs de désespérance. La nuit descend de haut, apportant des linceuls dans son ombre. Les promeneurs se taisaient. Assis au fond de la barque qui coulait avec l’eau, ils regardaient les dernières lueurs quitter les hautes branches. Ils approchaient des îles. Les grandes masses rougeâtres devenaient sombres ; tout le paysage se simplifiait dans le crépuscule ; la Seine, le ciel, les îles, les coteaux n’étaient plus que des taches brunes et grises qui s’effaçaient au milieu d’un brouillard laiteux. Camille, qui avait fini par se coucher à plat ventre, la tête au-dessus de l’eau, trempa ses mains dans la rivière. « Fichtre ! que c’est froid ! s’écria-t-il. Il ne ferait pas bon de piquer une tête dans ce bouillon-là. « Laurent ne répondit pas. Depuis un instant il regardait les deux rives avec inquiétude ; il avançait ses grosses mains sur ses genoux, en serrant les lèvres. Thérèse, roide, immobile, la tête un peu renversée, attendait. La barque allait s’engager dans un petit bras, sombre et étroit, s’enfonçant entre deux îles. On entendait, derrière l’une des îles, les chants adoucis d’une équipe de canotiers qui devaient remonter la Seine. Au loin, en amont, la rivière était libre. Alors Laurent se leva et prit Camille à bras-le-corps. Le commis éclata de rire. « Ah ! non, tu me chatouilles, dit-il, pas de ces plaisanteries-là… Voyons, finis : tu vas me faire tomber. Laurent serra plus fort, donna une secousse. Camille se tourna et vit la figure effrayante de son ami, toute convulsionnée. Il ne comprit pas ; une épouvante vague le saisit. Il voulut crier, et sentit une main rude qui le serrait à la gorge. Avec l’instinct d’une bête qui se défend, il se dressa sur les genoux, se cramponnant au bord de la barque. Il lutta ainsi pendant quelques secondes. « Thérèse ! Thérèse ! « appela-t-il d’une voix étouffée et sifflante. La jeune femme regardait, se tenant des deux mains à un banc du canot qui craquait et dansait sur la rivière. Elle ne pouvait fermer les yeux ; une effrayante contraction les tenait grands ouverts, fixés sur le spectacle horrible de la lutte. Elle était rigide, muette. « Thérèse ! Thérèse ! « appela de nouveau le malheureux qui râlait. À ce dernier appel, Thérèse éclata en sanglots. Ses nerfs se détendaient. La crise qu’elle redoutait la jeta toute frémissante au fond de la barque. Elle y resta pliée, pâmée, morte. Texte 2 : André Malraux, La Condition humaine, 1933 Tchen, un jeune Chinois engagé dans l’action terroriste, doit assassiner un trafiquant. Tchen tenterait-il de lever la moustiquaire ? Frapperait-il au travers ? L'angoisse lui tordait l'estomac ; il connaissait sa propre fermeté, mais n'était capable en cet instant que d'y songer avec hébétude, fasciné par ce tas de mousseline blanche qui tombait du plafond sur un corps moins visible qu'une ombre, et d'où sortait seulement ce pied à demi incliné par le sommeil, vivant quand même - de la chair d'homme. La seule lumière venait du building voisin : un grand rectangle d'électricité pâle, coupé par les barreaux de la fenêtre dont l'un rayait le lit juste au-dessous du pied comme pour en accentuer le volume et la vie. Quatre ou cinq klaxons grincèrent à la fois. Découvert ? Combattre, combattre des ennemis qui se défendent, des ennemis éveillés ! La vague de vacarme retomba : quelque embarras de voitures (il y avait encore des embarras de voitures, là-bas, dans le monde des hommes...). Il se retrouva en face de la tache molle de la mousseline et du rectangle de lumière, immobiles dans cette nuit où le temps n'existait plus. Il se répétait que cet homme devait mourir. Bêtement : car il savait qu’il le tuerait. Pris ou non, exécuté ou non, peu importait. Rien n’existait que ce pied, cet homme qu’il devait frapper sans qu’il se défendit – car, s’il se défendait, il appellerait. Les paupières battantes, Tchen découvrait en lui, jusqu’à la nausée, non le combattant qu’il attendait, mais un sacrificateur. Et pas seulement aux dieux qu’il avait choisis : sous son sacrifice à la révolution grouillait un monde de profondeur auprès de quoi cette nuit écrasée d’angoisse n’était que clarté. « Assassiner n’est pas seulement tuer… « Dans ses poches, ses mains hésitantes tenaient, la droite un rasoir fermé, la gauche un court poignard. Il les enfonçait le plus possible, comme si la nuit n’eût pas suffi à cacher ses gestes. Le rasoir était plus sûr, mais Tchen sentait qu’il ne pourrait jamais s’en servir ; le poignard lui répugnait moins. Il lâcha le rasoir dont le dos pénétrait dans ses doigts crispés ; le poignard était nu dans sa poche, sans gaine. Il le fit passer dans sa main droite, la gauche retombant sur la laine de son chandail et y restant collée. Il éleva légèrement le bras droit, stupéfait du silence qui continuait à l’entourer, comme si son geste eût dû déclencher quelque chute. Mais non, il ne se passait rien : c’était toujours à lui d’agir. Texte 3 : Albert Camus, L’Étranger, 1942 Meursault, le narrateur, est employé de bureau à Alger. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé un peu et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instants, entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux, dans l'air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étale qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà deux heures que la journée n'avançait plus, deux heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. A l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regarder l'Arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini. Mais toute une plage vibrante de soleil se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'Arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin. Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l'air de rire. J'ai attendu. La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et, comme alors, le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Et cette fois, sans se soulever, L'Arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors, j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme quatre coups brefs que je frappais à la porte du malheur. I. Question d’observation Quel rôle le cadre joue-t-il dans ces trois scènes de crime ? II. Traitez un des trois sujets suivants : Commentaire Faites le commentaire du texte d’Albert Camus (Texte 3). Dissertation Pour apprécier un roman, un lecteur a-t-il besoin de s’identifier au personnage principal et de partager ses sentiments ? Écriture d’invention Lors de son procès, Thérèse doit raconter au juge la scène que vous venez de lire (Texte 1) mais elle veut le convaincre, lui et les jurés, de l’entière responsabilité de Laurent dans le crime commis. Rédigez son discours.