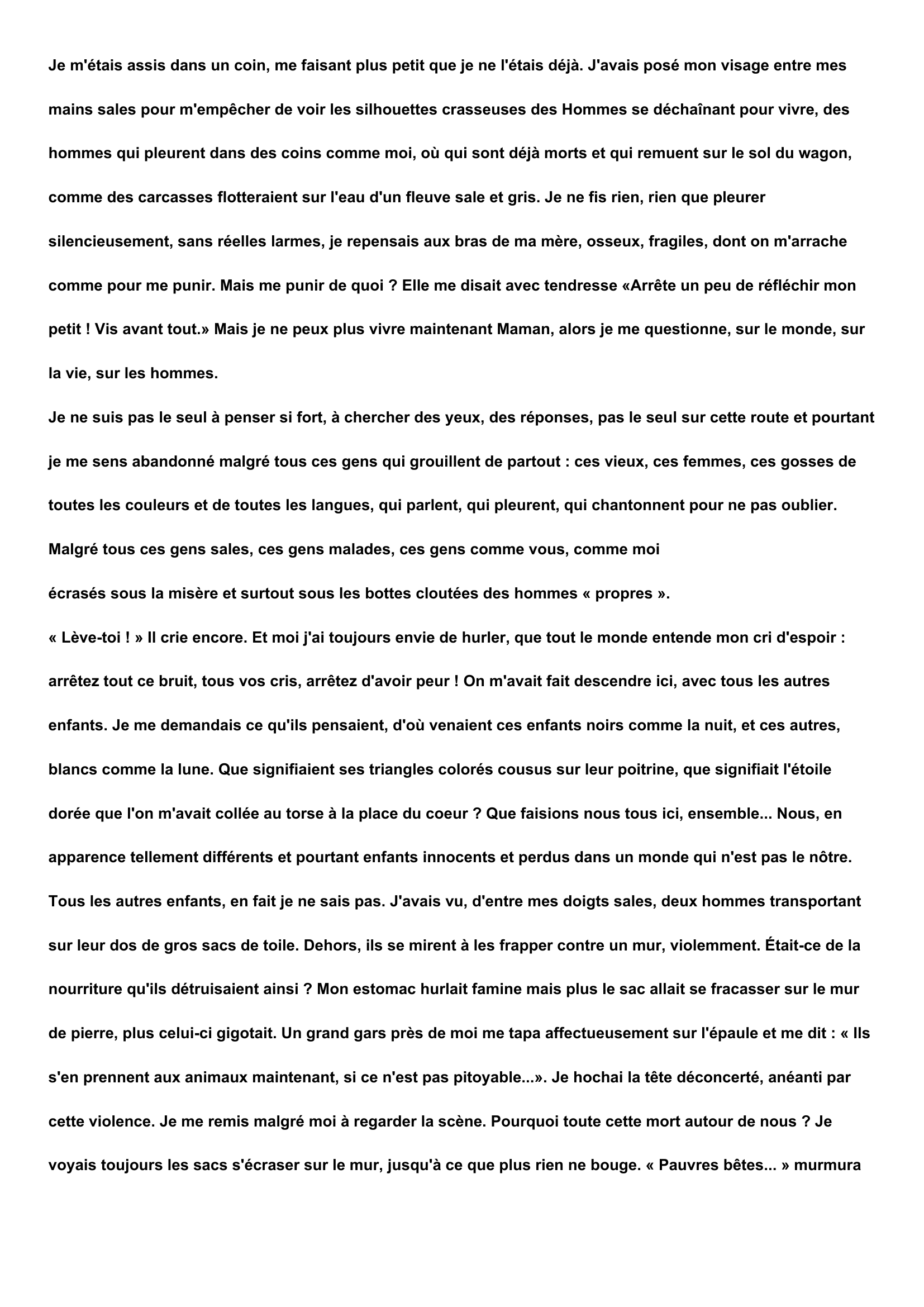Texte
Publié le 10/02/2013

Extrait du document
«
Je m'étais assis dans un coin, me faisant plus petit que je ne l'étais déjà.
J'avais posé mon visage entre mes
mains sales pour m'empêcher de voir les silhouettes crasseuses des Hommes se déchaînant pour vivre, des
hommes qui pleurent dans des coins comme moi, où qui sont déjà morts et qui remuent sur le sol du wagon,
comme des carcasses flotteraient sur l'eau d'un fleuve sale et gris.
Je ne fis rien, rien que pleurer
silencieusement, sans réelles larmes, je repensais aux bras de ma mère, osseux, fragiles, dont on m'arrache
comme pour me punir.
Mais me punir de quoi ? Elle me disait avec tendresse «Arrête un peu de réfléchir mon
petit ! Vis avant tout.» Mais je ne peux plus vivre maintenant Maman, alors je me questionne, sur le monde, sur
la vie, sur les hommes.
Je ne suis pas le seul à penser si fort, à chercher des yeux, des réponses, pas le seul sur cette route et pourtant
je me sens abandonné malgré tous ces gens qui grouillent de partout : ces vieux, ces femmes, ces gosses de
toutes les couleurs et de toutes les langues, qui parlent, qui pleurent, qui chantonnent pour ne pas oublier.
Malgré tous ces gens sales, ces gens malades, ces gens comme vous, comme moi
écrasés sous la misère et surtout sous les bottes cloutées des hommes « propres ».
« Lève-toi ! » Il crie encore.
Et moi j'ai toujours envie de hurler, que tout le monde entende mon cri d'espoir :
arrêtez tout ce bruit, tous vos cris, arrêtez d'avoir peur ! On m'avait fait descendre ici, avec tous les autres
enfants.
Je me demandais ce qu'ils pensaient, d'où venaient ces enfants noirs comme la nuit, et ces autres,
blancs comme la lune.
Que signifiaient ses triangles colorés cousus sur leur poitrine, que signifiait l'étoile
dorée que l'on m'avait collée au torse à la place du coeur ? Que faisions nous tous ici, ensemble...
Nous, en
apparence tellement différents et pourtant enfants innocents et perdus dans un monde qui n'est pas le nôtre.
Tous les autres enfants, en fait je ne sais pas.
J'avais vu, d'entre mes doigts sales, deux hommes transportant
sur leur dos de gros sacs de toile.
Dehors, ils se mirent à les frapper contre un mur, violemment.
Était-ce de la
nourriture qu'ils détruisaient ainsi ? Mon estomac hurlait famine mais plus le sac allait se fracasser sur le mur
de pierre, plus celui-ci gigotait.
Un grand gars près de moi me tapa affectueusement sur l'épaule et me dit : « Ils
s'en prennent aux animaux maintenant, si ce n'est pas pitoyable...».
Je hochai la tête déconcerté, anéanti par
cette violence.
Je me remis malgré moi à regarder la scène.
Pourquoi toute cette mort autour de nous ? Je
voyais toujours les sacs s'écraser sur le mur, jusqu'à ce que plus rien ne bouge.
« Pauvres bêtes...
» murmura.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TEXTE D’ETUDE : Jean-Jacques Rousseau, Emile ou De l’Education, 1762, chapitre III
- texte francais lettre persane 30
- COMMENTAIRE DE TEXTE (concours administratifs)
- Texte 1: Gargantua, 1534 (extrait 2 ) chapitre XXIII
- Texte d’étude : Charles Baudelaire, « L’Ennemi », Les Fleurs du Mal (1857): Le temps mange-t-il la vie ? (HLP Philo)