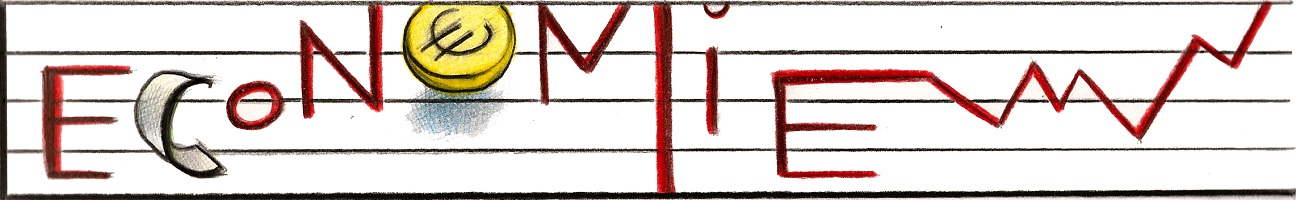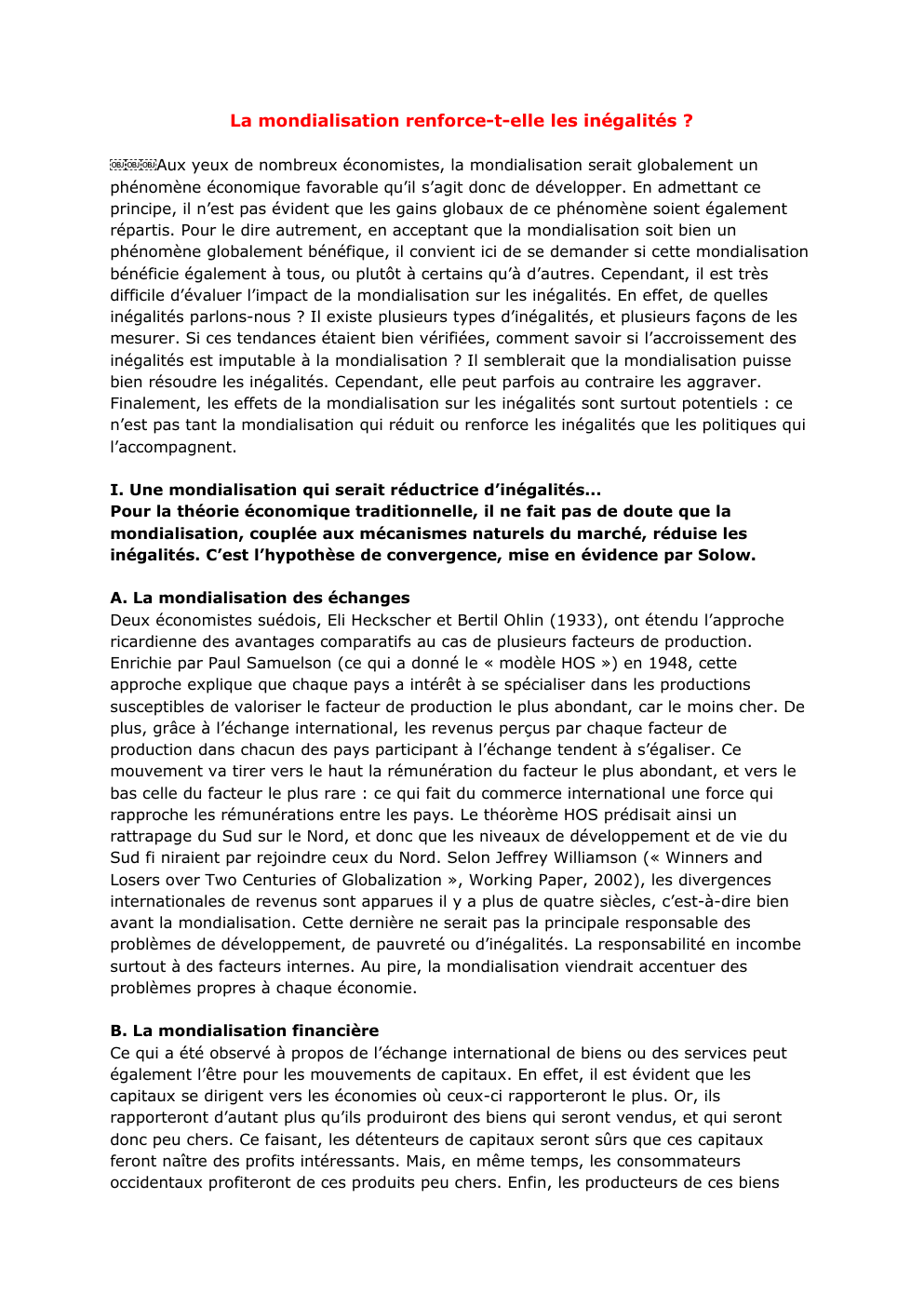la mondialisation dissertation
Publié le 20/09/2025
Extrait du document
«
La mondialisation renforce-t-elle les inégalités ?
Aux yeux de nombreux économistes, la mondialisation serait globalement un
phénomène économique favorable qu’il s’agit donc de développer.
En admettant ce
principe, il n’est pas évident que les gains globaux de ce phénomène soient également
répartis.
Pour le dire autrement, en acceptant que la mondialisation soit bien un
phénomène globalement bénéfique, il convient ici de se demander si cette mondialisation
bénéficie également à tous, ou plutôt à certains qu’à d’autres.
Cependant, il est très
difficile d’évaluer l’impact de la mondialisation sur les inégalités.
En effet, de quelles
inégalités parlons-nous ? Il existe plusieurs types d’inégalités, et plusieurs façons de les
mesurer.
Si ces tendances étaient bien vérifiées, comment savoir si l’accroissement des
inégalités est imputable à la mondialisation ? Il semblerait que la mondialisation puisse
bien résoudre les inégalités.
Cependant, elle peut parfois au contraire les aggraver.
Finalement, les effets de la mondialisation sur les inégalités sont surtout potentiels : ce
n’est pas tant la mondialisation qui réduit ou renforce les inégalités que les politiques qui
l’accompagnent.
I.
Une mondialisation qui serait réductrice d’inégalités...
Pour la théorie économique traditionnelle, il ne fait pas de doute que la
mondialisation, couplée aux mécanismes naturels du marché, réduise les
inégalités.
C’est l’hypothèse de convergence, mise en évidence par Solow.
A.
La mondialisation des échanges
Deux économistes suédois, Eli Heckscher et Bertil Ohlin (1933), ont étendu l’approche
ricardienne des avantages comparatifs au cas de plusieurs facteurs de production.
Enrichie par Paul Samuelson (ce qui a donné le « modèle HOS ») en 1948, cette
approche explique que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions
susceptibles de valoriser le facteur de production le plus abondant, car le moins cher.
De
plus, grâce à l’échange international, les revenus perçus par chaque facteur de
production dans chacun des pays participant à l’échange tendent à s’égaliser.
Ce
mouvement va tirer vers le haut la rémunération du facteur le plus abondant, et vers le
bas celle du facteur le plus rare : ce qui fait du commerce international une force qui
rapproche les rémunérations entre les pays.
Le théorème HOS prédisait ainsi un
rattrapage du Sud sur le Nord, et donc que les niveaux de développement et de vie du
Sud fi niraient par rejoindre ceux du Nord.
Selon Jeffrey Williamson (« Winners and
Losers over Two Centuries of Globalization », Working Paper, 2002), les divergences
internationales de revenus sont apparues il y a plus de quatre siècles, c’est-à-dire bien
avant la mondialisation.
Cette dernière ne serait pas la principale responsable des
problèmes de développement, de pauvreté ou d’inégalités.
La responsabilité en incombe
surtout à des facteurs internes.
Au pire, la mondialisation viendrait accentuer des
problèmes propres à chaque économie.
B.
La mondialisation financière
Ce qui a été observé à propos de l’échange international de biens ou des services peut
également l’être pour les mouvements de capitaux.
En effet, il est évident que les
capitaux se dirigent vers les économies où ceux-ci rapporteront le plus.
Or, ils
rapporteront d’autant plus qu’ils produiront des biens qui seront vendus, et qui seront
donc peu chers.
Ce faisant, les détenteurs de capitaux seront sûrs que ces capitaux
feront naître des profits intéressants.
Mais, en même temps, les consommateurs
occidentaux profiteront de ces produits peu chers.
Enfin, les producteurs de ces biens
trouveront un emploi duquel ils tireront un revenu.
En fait, la mondialisation financière
doit assurer l’allocation optimale des ressources : les capitaux vont s’investir là où les
opportunités sont les plus intéressantes.
Mais dans la mesure où ces opportunités sont
situées dans les pays du Sud, cette mondialisation peut contribuer à réduire les inégalités
entre le Nord et le Sud.
C.
Le « technoglobalisme »
Cette mondialisation financière peut s’avérer d’autant plus bénéfique au Sud qu’elle
engendre des transferts de technologie.
Il s’agit de la diffusion d’innovations et de
technologies émanant de très nombreux territoires.
L’innovation est comparable à un
bien public, et est donc source d’externalités positives qui pourront ensuite profiter à
tous.
Ainsi, les « retardataires » pourraient profiter des découvertes faites par les
pionniers.
C’est le cas par exemple avec les investissements directs à l’étranger (IDE).
Ces derniers se matérialisent par le fait que des entreprises développent des activités
productives à l’étranger.
Lorsque les pays du Sud reçoivent ces IDE, ils profitent
également de transferts de technologie intéressants.
Une entreprise qui s’établit en Chine
y réutilise des techniques de production éprouvées et modernes.
Par ailleurs, elle forme
les travailleurs locaux.
Autrement dit, le capital humain des pays d’accueil augmente
grâce à la formation offerte par les pays occidentaux.
De ce fait, la productivité des pays
du Sud augmente, ce qui bénéficie à ces pays.
Par conséquent, les inégalités entre le
Nord et le Sud peuvent se réduire.
D’ailleurs, il est à noter que de nombreux pays du Sud
cherchent aujourd’hui à attirer ces IDE pour se développer, en incitant les entreprises
occidentales à s’installer chez eux (exemple des zones franches de Chine).
C’est un
moyen efficace et rapide pour eux d’améliorer leur croissance.
Cela dit, on constate
empiriquement que les inégalités ne se sont pas toujours réduites, et ce malgré la
mondialisation.
De nombreuses théories ont été élaborées pour expliquer ce phénomène
ou avaient prédit celui-ci.
II.
...
ou source d’inégalités croissantes ?
Des économistes spécialisés en théorie du développement ont avancé dès les
années 1950 l’idée que le libre-échange pouvait avoir des effets négatifs sur les
pays du Sud.
Ces économistes, souvent issus de pays peu ou pas développés,
sont des tenants du « tiers-mondisme ».
Certains sont proches du marxisme,
auquel ils reprennent la base théorique pour l’appliquer aux échanges
mondiaux.
Ils ont montré d’une part que la spécialisation des pays du Sud
pouvait se révéler handicapante et d’autre part que la mondialisation pouvait
les entraîner dans une dépendance et une domination extérieure.
A.
Une spécialisation handicapante
Certains économistes tiers-mondistes ont montré que les pays du Sud se sont spécialisés
dans des secteurs qui, selon la théorie ricardienne, aboutissaient à une allocation
optimale des ressources.
Or, cette spécialisation était en fait très particulière puisque ces
pays s’étaient spécialisés dans la production de matières premières, alors que les pays
développés se spécialisaient dans la production de produits manufacturés à haute valeur
ajoutée.
Les théoriciens du développement montrent donc que cette spécialisation n’est
pas neutre : toutes les spécialisations ne se valent pas.
En effet, la production de
matières premières est une production à faible valeur ajoutée et n’est pas une source
d’enrichissement et de développement équivalente à la production de produits
manufacturés ou de services.
Un des outils forgés pour qualifi er ce phénomène est « les
termes de l’échange ».
Raul Prebisch et Hans Singer (« The Distribution of Gains
Between Investing and Borrowing Countries », American Economic Review, 1950) ont
montré que du fait de la structure économique différente entre les PED et les PDEM, les
prix n’évoluaient pas de manière parallèle.
Dans les PDEM, la structure oligopolistique du
marché ainsi que la présence de syndicats empêchent les coûts et donc les prix de
baisser, contrairement aux PED.
Singer ajoute par ailleurs que la demande de produits
primaires qui est adressée aux PED augmente moins vite que la demande en produits
manufacturés adressée aux pays développés.
Ces phénomènes accentuent donc les
écarts dans l’évolution des prix des produits.
Ils en déduisent une dégradation des
termes de l’échange, que l’on mesure par le rapport entre l’indice des prix à l’exportation
et l’indice des prix à l’importation.
En effet, les pays du Sud peuvent s’offrir de moins en
moins de produits manufacturés en provenance du Nord puisque les prix des leurs
diminuent.
En exportant exactement la même quantité de produits primaires, les PED
importent de moins en moins de produits du Nord.
Un économiste d’origine grecque,
Arghiri Emmanuel (L’Échange inégal, Maspero, 1969), modifie la thèse de la détérioration
des termes de l’échange.
Ce n’est pas la nature des biens exportés par les pays du tiersmonde qui est en cause.
En effet, des pays développés comme l’Australie, la NouvelleZélande ou le Canada exportent majoritairement des matières premières sans
s’appauvrir pour autant.
La différence est que ces derniers font payer « normalement » le
travail fourni, alors que, dans le secteur moderne des pays du tiers-monde, qui fournit
l’essentiel de leurs exportations, le niveau des salaires, tiré vers le bas par le chômage
de masse et les faibles revenus du secteur traditionnel, est bien inférieur à ce que justifi
erait la productivité du travail.
D’où un appauvrissement par le biais du commerce
international, car les exportations sont vendues en dessous de leur valeur.
B.
Dépendance et domination extérieure
Les premiers à souligner l’impérialisme des relations économiques sont Rosa Luxembourg
(L’Accumulation du capital, 1913), Lénine (L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme,
1916) et Boukharine (L’Accumulation du Capital et l’Impérialisme, 1925).
Le monde est
selon eux divisé en un centre dominant et une périphérie dominée.
C’est à partir de cette
division que va s’organiser la spécialisation des pays, le tout sous l’aiguillon des
mouvements de capitaux.
Le centre exploiterait la périphérie, en l’obligeant....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- dissertation acteurs et processus de la mondialisation
- Dissertation de droit : La hiérarchie des normes
- philo: Méthode de la dissertation.
- Dissertation: Peut-on considérer que la métropolisation engendre à la fois un processus de concentration et d’accentuation des inégalités ?
- Dissertation: conseils