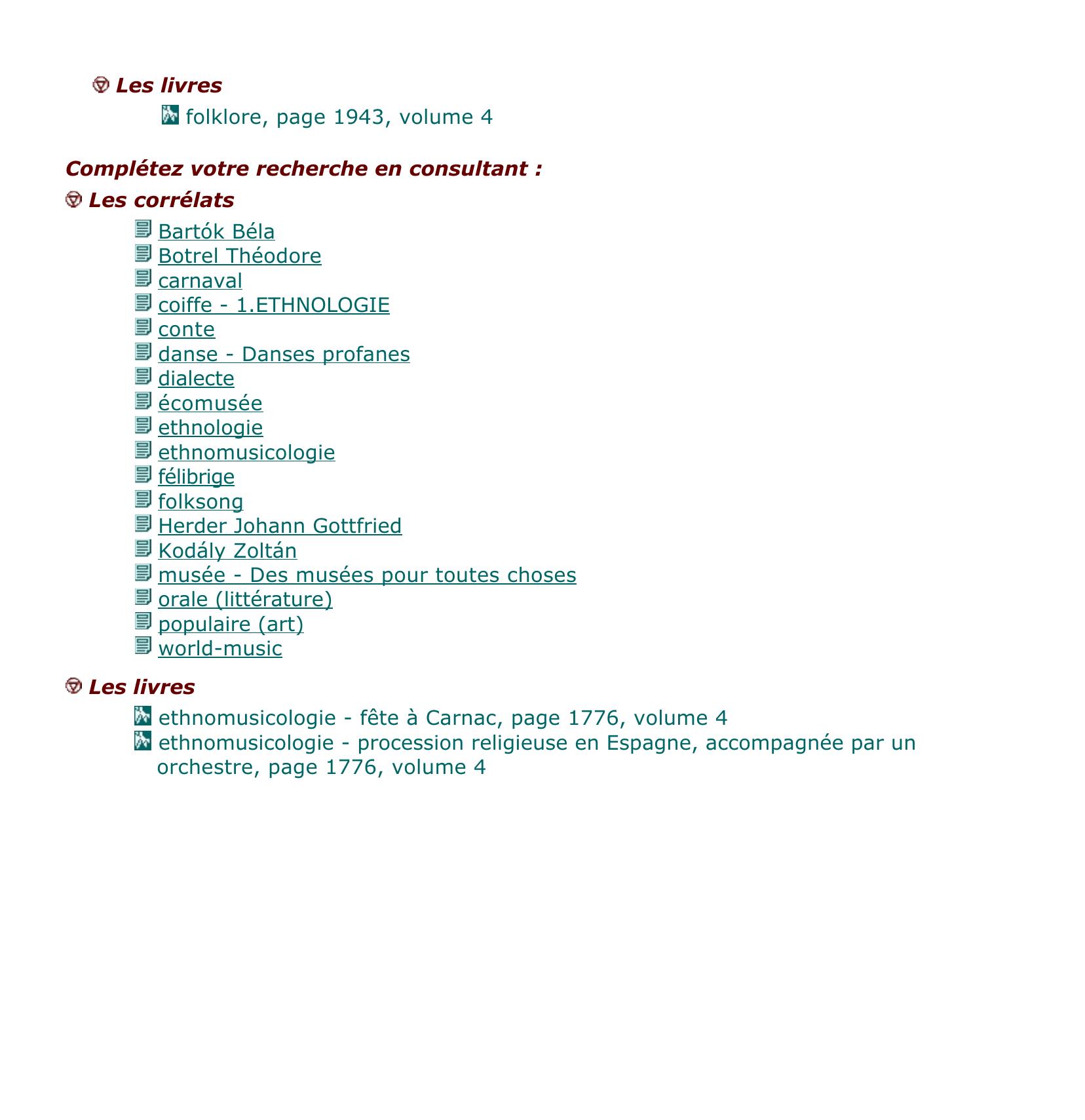folklore. n.m., ensemble des traditions populaires (techniques, littéraires, artistiques, etc.) d'un pays ou d'une région. L'invention du folklore. Le folklore, que l'on reçoit communément comme une expression touchante de la vie traditionnelle d'un peuple ou d'une région, est d'abord le résultat d'une construction : celle qu'opérèrent, à partir de la fin du XVIIIe siècle, les folkloristes. L'idée que l'on puisse s'intéresser aux coutumes d'une culture complètement étrangère était présente depuis fort longtemps dans la civilisation occidentale (notamment depuis la découverte des Amériques). Mais la notion même de folklore comme expression significative de la vie d'un peuple, et devant par conséquent être observée dans sa totalité et conservée, est beaucoup plus récente. À l'instar des folkloristes allemands, c'est à la fin du XIXe siècle qu'en France des savants, plus ou moins reconnus comme tels, se sont mis à parcourir les régions, en quête de techniques, de dialectes, d'arts considérés comme relevant d'une même inspiration et renvoyant à une même identité culturelle, dans une aire géographique donnée. En ce sens, le souci de préserver un folklore est lié aux craintes nées des perturbations de la vie rurale, causées par l'industrialisation et par la scolarisation. Les grands folkloristes français ont le plus souvent été étroitement liés aux mouvements régionalistes (comme le félibrige ou le mouvement breton). D'une manière plus générale, les folkloristes ont jeté les bases de l'ethnologie moderne, qui a systématisé les méthodes et surtout déplacé le regard vers des aspects moins spectaculaires et moins exclusivement artistiques de la vie quotidienne des peuples, comme dans le Manuel de folklore français contemporain d'Arnold Van Gennep (paru en 1943). Le folklore entre l'authentique et l'artificiel. Le souci des folkloristes de préserver, par l'inventaire, la vie authentique d'un peuple s'est quelque peu défait aujourd'hui. La plupart des manifestations folkloriques sont des présentations figées d'un patrimoine assez peu relié à la vie quotidienne des populations qui acceptent, le temps d'une saison touristique, de rejouer les scènes de leur passé. Le maintien des particularités folkloriques d'un peuple (danses, musiques, contes, techniques et savoir-faire) suppose alors que se développent des lieux d'apprentissage (cercles, écoles, etc.), en général investis par de jeunes générations qui veulent ainsi garder un contact au moins sommaire avec les générations précédentes. Le folklore d'une région est désormais inséparable des loisirs de masse, comme le montrent les Fêtes de Cornouaille en Bretagne. De telles festivités sont sans doute à l'origine du sens dérivé du mot folklore, connotant le côté le plus artificiel de la vie d'un groupe. Mais cette récupération du folklore est aussi un aspect non négligeable du développement économique d'une région. Voir aussi le dossier ethnomusicologie. Complétez votre recherche en consultant : Les livres folklore, page 1943, volume 4 Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats Bartók Béla Botrel Théodore carnaval coiffe - 1.ETHNOLOGIE conte danse - Danses profanes dialecte écomusée ethnologie ethnomusicologie félibrige folksong Herder Johann Gottfried Kodály Zoltán musée - Des musées pour toutes choses orale (littérature) populaire (art) world-music Les livres ethnomusicologie - fête à Carnac, page 1776, volume 4 ethnomusicologie - procession religieuse en Espagne, accompagnée par un orchestre, page 1776, volume 4