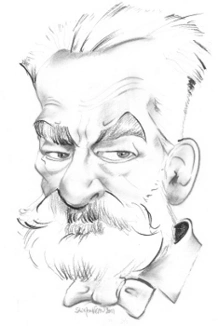(Besançon 1802 - Paris 1885). Figure achevée du génie du xixe s., chef du romantisme, personnage officiel de la monarchie de Juillet et de la IIe République, exilé sous le second Empire, inspirateur déçu de la IIIe République, fils, père, frère, époux, adultère trop exemplaire, il suscita dans ses triomphes et ses échecs des haines et des enthousiasmes suspects. Depuis ses funérailles grandioses, la nation ne cesse de célébrer sa stature mythique, tandis que son œuvre lui vaut la faveur des connaisseurs comme du public populaire.
Né de l'alliance des contraires, il est ballotté avec son frère Eugène, au hasard des garnisons et de la mésentente de ses parents. Deux souvenirs éblouissants, l'Espagne des exploits paternels (1811) et à Paris les Feuillantines de la mère (1809-10 et 1812-13), avant la claustration de la pension Cordier. Leur aîné, Abel, les pilote dans les cercles littéraires du milieu ultra, où Victor se détache rapidement. Encouragé par l'Académie en 1817, couronné aux jeux Floraux de Toulouse en 1819, engagé d'amour auprès d'une amie d'enfance, Adèle Fou-cher, il fonde le Conservateur littéraire, où il déploie une intense activité de critique politique et littéraire. Ses Odes (1822) le placent au premier rang des thuriféraires de la vieille monarchie, sous l'égide de Chateaubriand, mais Bug-Jargal (écrit en 1819, publié en 1826), bref récit militaire et colonial de la révolte des Noirs à Saint-Domingue en 1791, trahit les ambiguïtés de la fraternité, le sens des rivalités de classe, l'intelligence du phénomène révolutionnaire avec une rare maîtrise d'écriture et de composition. La rédaction d'un roman norvégien, Han d'Islande (1823), frénétique, ironique, sentimental — et alimentaire —, double les « Lettres à la fiancée » et illustre jusqu'à les retourner les thèses de J. de Maistre sur le pouvoir et le bourreau.L'année 1823 marque la prise de majorité du romantisme par la publication des Tablettes, où Hugo fait bonne figure, et le lancement de la Muse française, tôt en butte aux attaques et contrainte au sabordage par un groupe de monarchistes ralliés au conformisme néoclassique (1824). À l'inverse, le passage de Chateaubriand à l'opposition contribue à tourner Hugo vers les réalités obscures de l'histoire. Le sacre de Charles X lui vaut la Légion d'honneur (1825), mais aussitôt l'ode des Deux îles — la Corse et Sainte-Hélène — modifie spectaculairement la figure de Bonaparte et s'installe dans le genre symbolique. Un voyage dans les Alpes, la floraison des Ballades, la sympathie antigallicane pour Lamennais participent de cet universalisme.
La préparation de Cromwell en 1826, au moment de la publication des Odes et Ballades, est probablement connexe au travail historique et prophétique de Chateaubriand. Le retrait de la figure du Protecteur, comme la disparition de Bonaparte, sert de lumière noire pour faire saillir l'émergence du futur dans le présent. Le drame, énorme, disloque et compose, autour de la question cruciale du pouvoir et du génie, les partis et les clans, la folie et la voyance, l'argent et le destin, la bouffonnerie et la mort. Système éclaté du double, la dramaturgie de Cromwell laisse poindre comme impossible mais inévitable la souveraineté du peuple, des « ouvriers », par-delà les Restaurations provisoires et les incertitudes de la puissance bourgeoise. Toute une philosophie de l'histoire commande ainsi la fameuse Préface, qui expose la nécessité et la pertinence du drame comme genre de la modernité. À cette colossale œuvre de synthèse succède la publication définitive des Odes et Ballades ( 1828). Jouant habilement du plan de 1822, conquérant la métaphysique et le pittoresque, variant les rythmes, le recueil élargit en cycles et décalages une sorte d'autoportrait. C'est l'âge d'homme, celui du ralliement décisif au libéralisme par l'Ode à la colonne (1827), celui de la mort du père. Les Orientales (1829) exploitent sans doute l'actualité du conflit gréco-turc, mais enracinent dans l'Espagne des enfances l'ambiguïté historique, symbolique et morale de l'opposition entre islam et chrétienté. C'est du destin de l'Occident qu'il s'agit dans ce volume quasi sadien, ouvert par une vaste méditation sur
Sodome et Babel, achevé par la figure d'un Napoléon oriental. Le pouvoir hégémonique du dire entraîne ainsi fautes, crimes et despotismes à leur propre ruine critique. De même, le Dernier Jour d'un condamné, écrit en décembre 1828, se saisit de diverses monstruosités (la cellule, le ferrement des forçats, le rêve, l'argot) pour fixer les deux pôles du vertige social : l'irréductibilité autobiographique du moi, le tumulte obscur de la multitude. Entre les deux, dans la critique des formes institutionnelles et la satire du jeu politique, le roman invente au dernier moment la clé de sa nécessité, pierre de touche insupportable de la conscience moderne : l'identique légitimité sacrificielle du Condamné et du Roi. De là Hugo datera son « socialisme ». De là date aussi la plénitude d'un génie solitaire, populaire, scandaleux, qui ne cesse d'exploiter pendant une douzaine d'années cette vision polymorphe.
Marion Delorme, drame écrit en 1829, oppose à Richelieu, cardinal-bourreau, la déraison du bouffon, l'amour de la courtisane, l'honneur de la féodalité caduque. L'interdiction de la pièce mène à Her-nani et à sa « bataille » (févr. 1830). L'inspiration cornélienne (la clémence de don Carlos devenu Charles Quint en une descente au tombeau de Charlemagne) exprime à la fois le rêve d'Empire pacificateur et son irrémédiable échec : l'« honneur castillan » y joue le rôle du Commandeur dans Dom Juan. La revendication provocante de liberté littéraire, la guerre aux conventions usées, l'affirmation flamboyante des vertus juvéniles débordent l'espace mondain du Théâtre-Français : l'irréductibilité fatale du hors-la-loi fait de lui et de sa puissance d'amour et de mort l'interrogation insoutenable sur le sens des mutations historiques. Après la révolution de Juillet, la préface de Marion Delorme (1831) tire la conclusion de cette urgence : que le public se fasse peuple, que le drame, national, populaire, universel, sorte le peuple de son emmurement, que surgisse un génie « qui soit à Shakespeare ce que Napoléon avait été à Charlemagne ».
Cette volonté héroïque d'action sur les masses n'enlève rien au pessimisme tragique et critique de ces années 30. L'amitié de Sainte-Beuve est devenue, littérairement et sentimentalement, douteuse. Au moment de la révolution, Adèle, déjà quatre fois mère (Léopold, né et mort en 1823; Léopoldine, 1824 ; Charles, 1826 ; François-Victor, 1828), accouche d'un dernier enfant, l'autre Adèle, et délaisse son mari. Les cabales, de droite et de gauche, s'acharnent ; les éditeurs menacent. Sous la contrainte, Hugo rédige Notre-Dame de Paris (1831), roman de la fin de Louis XI (1482) où se fait le basculement du Moyen Âge dans la Renaissance. D'abord conçu selon W. Scott, le roman est interrompu et bouleversé par la révolution. La cathédrale nationale de Paris s'y oppose à toute une intrigue enracinée à Reims, lieu des sacres royaux. La Bastille y prophétise le 14 juillet 89. La méditation sur la mort de l'architecture et l'essor de l'imprimé devient centrale. La digression s'installe comme principe du roman moderne, architecture du vide où le sonneur monstrueux et sourd fait figure de peuple à venir, face à la ruine de la cléricature (Cl. Frollo) et aux triomphes provisoires de la raison d'État militaire (Phœbus), littéraire (Gringoire) ou sociale (la cour des Miracles). La verve pittoresque et l'intrigue de mélodrame ont longtemps caché le symbolisme visionnaire et narquois de ce triomphe, sans pourtant occulter l'essentiel : un parti pris constant de matérialité jusque dans les accents les plus spiritualistes.
Les Feuilles d'automne (fin 1831) reviennent au lyrisme de l'inspiration intime et familière, à la diffusion de l'effusion. Mais, s'ouvrant sur un célèbre autoportrait (« Ce siècle avait deux ans » et l'« écho sonore »), s'achevant par la « corde d'airain » de l'indignation, cette intériorité contemplative organise une socialité religieuse dont la « Pente de la rêverie » et « Pan » disent l'ambition philosophique, naturaliste. Trois autres recueils lyriques (les Chants du crépuscule, 1835; les Voix intérieures, 1837 ; les Rayons et les Ombres, 1840) élargissent ce dialogue du doute
et de la fonction du poète et jalonnent l'évolution vers la grande poésie métaphysique de l'exil.
La veine dramatique s'exploite de façon analogue. Coup sur coup, en juin et juillet 1832, Hugo écrit Le roi s'amuse en vers et Lucrèce Borgia en prose, « bilogie » du Père et de la Mère, pour les publics bien différents de la Comédie-Française et de la Porte-Saint-Martin. Le succès populaire de Lucrèce n'efface ni la chute ni l'interdiction du Roi, ni l'échec du procès qui s'ensuivit. Toute l'opinion qui a droit de parole et d'écriture se dresse contre l'audace matérielle, historique, politique, morale de ces drames où l'inceste, le grotesque, la fascination spectaculaire devant les pouvoirs et les orgies de toute Renaissance prennent dans la tenaille de la dialectique du double les certitudes et les appétits de la bourgeoisie triomphante comme les vertus de l'aristocratie caduque ou des libéraux en réserve. Ce recours tragique à l'esprit d'un Rabelais romantique peut bien en 1833 s'exacerber avec Marie Tudor (sans doute par ruse violente contre la tradition des Marie Stuart), s'atténuer avec Angelo, tyran de Padoue (1835), ou se donner libre carrière au nouveau Théâtre de la Renaissance avec Ruy B las (1838), la présence insistante des marginaux dans ces intrigues, l'originalité souveraine et désinvolte de la synthèse historique et dramaturgique, le déclin général du théâtre d'idées et d'art au profit du drame bourgeois emportent cette création dans une réprobation quasi unanime, même si l'extrême vigilance de Hugo comme metteur en scène et homme d'affaires lui rapporte de substantielles compensations.
La succession de ces titres révèle une sorte de stratégie géopolitique qui s'avoue au terme de cette période (1843) avec le classement que donne la « Société pour l'exploitation » populaire des œuvres de Hugo. Parti des siècles classiques, du pouvoir d'État, avec Han, Bug, Cromwell, Marion, qui se confrontent avec la totalité de l'œuvre poétique, assignée au xixe s., Hugo a effectué un vaste détour aux origines des temps modernes par Notre-Dame de Paris, en liaison avec l'actualité sociale des questions pénales (le Dernier Jour d'un condamné) et, en 1834, Claude Gueux. Puis il a puisé dans le siècle de la Renaissance, d'Espagne en France et d'Italie en Angleterre (Hemani, Le roi s'amuse, Lucrèce, Marie et Angelo), toute l'archéologie criminelle des empires modernes. Ruy Blas opère un retour cruel sur le xviie s., quand l'hégémonie des Habsbourg s'est effondrée devant la puissance louisquator-zienne, visée depuis le début comme le contresens historique qu'il appartenait à la Révolution française et au xixe s. de redresser.
En 1839, le drame des Jumeaux atteint enfin, au plus profond de la mazarinade tragique, cette cible du faux « grand siècle », référence obligée de la culture et du pouvoir bourgeois. Le projet date de 1830, recoupe un aspect important de Cromwell : la boucle serait bouclée, mais une limite est atteinte, au creux de l'histoire personnelle du poète. À tant prêter ses propres obsessions aux grandes crises de l'histoire et à ses héros criminels, Hugo rencontre là, deux ans après la mort sinistre de son frère Eugène chez les fous, la dialectique impossible de la gémellité et du caï-nisme. Le drame, qui portait à l'extrême la liberté d'éclatement du grotesque, n'est pas achevé. En une sorte de révulsion suprême, de mouvement régressif-progressif qui joint xme et xixe s., le recours se fait germanique dans l'espace des voyages [le Rhin, 1842), dans le virage du théâtre à l'épopée {les Burgraves, 1843), pendant que s'accumulent matériaux et questions pour un nouveau roman, les Misères, qui deviendra les Misérables (1862).
Il s'agit, dans sa vie comme dans son œuvre, de retourner l'infamie en principe de conquête, les revers en magistrature de l'esprit. Depuis 1833, Hugo vit une liaison clandestine et notoire avec Juliette Drouet, pécheresse et actrice repentie qu'il enferme dans la réclusion d'un amour assez vite idéal, compensée par une intimité profonde avec son œuvre et un voyage annuel. Ceux de
1838 à 1840 fournissent la matière du puzzle subtil que la mode des récits de voyage et l'actualité politique des années 40 cristallisent dans le Rhin, non sans recours, comme dans l'œuvre romanesque ou théâtrale, à un énorme travail de marquetterie documentaire. De manière analogue, en 1834, Hugo avait fait le bilan de son évolution dans Littérature et Philosophie mêlées, avec ce sens aigu de la composition des choses faites, dites, pensées ou vues qu'encadrait la notion de personnage, depuis le manifeste autobiographique et esthétique centré sur la question du style, jusqu'à l'étude sur Mirabeau, miroir de « l'homme-événement ». Le Rhin s'étale entre deux morceaux de même ordre. La conclusion prône, contre les Empires anglais et russe, l'alliance franco-allemande : « donner au nord sa part de midi et au peuple sa part de pouvoir ». Depuis 1837, Hugo était l'intime de l'héritier du trône et s'était rallié au régime, en une entente complice avec l'orientation très originale d'Émile de Girardin, qui durera quinze ans. En 1841, il force les portes de l'Académie française, qui lui donne accès, en 1845, à la Chambre des pairs. L'échec de la trilogie des Burgraves (1843) scelle la fin d'une période ; la noyade tragique de Léopoldine, la même année, sanctionne la faillite de la carrière familiale et amoureuse ; une nouvelle liaison, avec Mme Biard, qui double l'ancienne, conduit au scandale public du constat d'adultère (1845). Hugo s'enferme, travaille aux Misérables, s'applique à sa tâche de parlementaire et ne publie rien. Mais c'est l'époque des « choses de la Bible » et la prolifération des « choses vues ».
Sous la IIe République, député du parti de l'ordre, mais horrifié par la répression des journées de juin 1848, il fait soutenir par son journal l'Événement la candidature de Lamartine, puis de Louis Napoléon Bonaparte et, à partir de 1849, sur la question de la misère, rompt avec la droite. Il se détache progressivement du prince-président, organise en vain la résistance au coup d'État du 2 décembre 1851 et s'enfuit à Bruxelles. C'est le premier exil, qui produit Napoléon le Petit dès 1852, chef-d'œuvre du pamphlet, après qu'il eut abandonné l'Histoire d'un crime. Nouvel exil à Jersey en août ; il occupe une position singulière dans le groupe des proscrits socialistes et laisse éclater la « Muse Indignation » en une cataracte de poèmes vengeurs, qui s'organisent en sept livres au fur et à mesure des retards de la publication de ces Châtiments (1853). Toute la poésie de l'exil découle de cette systématique calculatrice, qui synthétise la puissance dramatique et la virtuosité poétique et dénonce autant que le nouveau César la droite catholique qui recrucifie le Christ. Véritable « appel au peuple », alors bien peu entendu, le pamphlet se fait visionnaire, et la violence prophétique. La fonction du poète, pour être politique, prend enfin toute sa profondeur religieuse.
Le clan Hugo rencontre alors la mode des « tables parlantes ». Leurs révélations sont l'occasion d'un intense travail de poésie philosophique : la Fin de Satan et Dieu, inachevés, l'Âne, bien des pièces de la Légende des siècles (1877) définitive sortiront de ces cinq années de méditation. Mais d'abord, c'est le chef-d'œuvre des Contemplations (1856), immense recueil poétique organisé en six livres selon l'opposition autrefois/au-jourd'hui, centrée et conclue sur la mort et l'intercession de la fille morte. Le succès de cette somme magistrale est sans précédent, au moment où l'action du poète parmi les proscrits lui vaut un nouvel exil de Jersey à Guernesey. Les revenus de la publication lui permettent enfin d'acheter une vaste maison, qu'il mettra des années à travailler comme un poème, symbole de sa propre figure, de ses débordements baroques, de son strict dénuement ( Hauteville-House ). Au travers de souffrances physiques et morales (sa famille s'ennuie, sa fille deviendra folle), la présence de Juliette, l'exaltation heureuse de cette Normandie maritime, son rôle de chef spirituel de la résistance à l'Empire (il refuse l'amnistie de 1859) lui permettent d'exploiter tous les registres, à partir du double tremplin de Châtiments et des Contemplations. En
1859, c'est la première série (« Petites Épopées ») de la Légende des siècles : renouvelant le système historico-géogra-phique qui depuis les Odes et les Orientales s'était épanoui dans le théâtre et cristallisé dans les Contemplations, le livre, tout entier commandé par « la Conscience », jalonne par pièces séparées et diverses, mais quasi toutes en alexandrins, les étapes successives de l'humanité depuis son engendrement par Ève jusqu'à son basculement apocalyptique « hors des temps ». L'ensemble pivote autour du mythe naturaliste du « Satyre », affecté à l'époque centrale de la Renaissance, référence essentielle, esprit même de cette épopée du Progrès. Depuis Châtiments, toute cette activité poétique déborde ses objets propres et contribue à achever autant qu'à différer les Misérables. En 1860, Hugo se remet à l'œuvre interrompue, avant la révolution de Février, sur la difficulté même du rapport entre le forçat racheté et sa fille adoptive. Il n'a pas publié de roman depuis trente ans. Tout un essai sur Dieu et l'âme, dit « Préface philosophique », oriente la portée spirituelle de ce « drame et roman » annoncé comme « épopée sociale de la misère ». Une année de travail mène à bien les ajustements de détail, voire d'opportunité, les développements fragmentaires, tout un gonflement intérieur de végétation romanesque, historique, philosophique et sociale, qui ne perd de vue ni la fidélité au projet premier ni la conformité de l'œuvre à son moment d'achèvement, à sa fonction potentiellement testamentaire : « Je peux mourir. » Cette somme transcende ainsi les œuvres de Sue et de Sand, les sommets balzaciens, le Jocelyn de Lamartine. Le roman devient enfin poème. De considérables parenthèses réalisent une véritable reprise en sous-œuvre, jusqu'au voyage de 1861 près de Waterloo, qui inaugure les retours annuels sur le continent et donne lieu à la mise en place radicale du roman : la catastrophe de Napoléon était nécessaire pour que le xixe s. trouvât place. Au terme du calvaire de régénération de Jean Valjean, l'échec de l'insurrection de 1832, repensé et écrit par la médiation des souvenirs de juin 1848, vise moins le malheur des espérances et des tentatives révolutionnaires que la nécessité de l'évanouissement de la bourgeoisie pour que la France et l'humanité se conquièrent. De même, au travers de la cure métaphysique qui aboutit à ce bouleversement moderne du genre romanesque, l'auteur ne mobilise tant sa propre biographie que pour disparaître lui-même. C'est un « Hugo-fantôme », présence absente, quasi suicidaire, qui anime en chaque point cette mise en cause critique, quasi physique, profondément lucrétienne, de l'histoire et de la société. Le succès fut foudroyant, universel : roman mythique autant que réaliste, populaire et savant, national et humanitaire, c'est la bible des temps modernes.
Hugo, héros du Progrès, a définitivement pris sa stature et s'est laissé pousser la barbe. Il fixe sous le titre de William Shakespeare (1864) l'ensemble de sa théorie littéraire, de sa philosophie militante : égalité de tous les génies, dont chacun marque un moment et un espace dans le relais des civilisations ; la vocation des esprits aux masses fait leur rapport à « l'histoire réelle ». La force et la profondeur de ce livre génial, rigoureuse méditation sur le moi et l'histoire, le style et les œuvres, le surnaturalisme comme vérité hyperbolique de la matérialité échappaient ou insultaient à l'avachissement de l'époque. Dans sa famille aussi, Hugo se sentait « de trop ». Les îles Anglo-Normandes lui fournissent un bain salutaire de nature et de jouvence, nullement étranger à l'urgence politique de contribuer à l'alliance des bourgeois républicains et des ouvriers socialistes. Ajoutant de nouveaux poèmes à la floraison de 1859, il publie les Chansons des rues et des bois (1865), équivalent sur le mode mineur et populaire des Contemplations et de la Légende. Les Travailleurs de la mer (1866), méditation sur « l'abîme » de l'Océan et du cœur humain, exploite et transfigure la mode du roman maritime en une réplique moderne de Notre-Dame de Paris : la fameuse pieuvre succède aux fatalités de la cathédrale,
la machine à vapeur aux tours de Notre-Dame, l'impérialisme britannique et protestant à la monarchie dévote de Louis XI. Autre source de rajeunissement fantaisiste et caustique, le Théâtre en liberté (1886), qu'on découvrira bien plus tard, produit plusieurs œuvres dont la verve comique est fidèle aux milliers de fragments dramatiques dont le penseur n'avait cessé d'émailler ses manuscrits.
Pour arriver au grand roman sur la Révolution, que préparaient déjà bien des filons de l'œuvre entière, et notamment un ensemble de poèmes vers 1857-58, c'est à l'Angleterre de la reine Anne que Hugo demande sa première manœuvre. L'Homme qui rit (1869), comme les Travailleurs ou les Misérables, transpose une quantité d'éléments biographiques et documentaires sur le thème majeur de la mutilation infligée par les pouvoirs aux vivants. Roman de la tempête, du gibet, du théâtre, de la science, du désir, prolifération baroque et rusée d'une vraie philosophie cynique et pourtant religieuse, particulièrement pertinente à l'étude de l'aristocratie anglaise, cette œuvre somptueuse devait être suivie d'un roman sur la monarchie française avant 1789. Le plébiscite, la guerre de 1870, la proclamation de la République, qui ramène Hugo à Paris, conduisent à l'abandon de ce projet où se serait investi le goût très sensuel du poète pour le xviiie s. et le rococo.
Héros républicain de Châtiments (nouvelle édition dès octobre), mêlé au peuple de Paris pendant le siège, député, Hugo abandonne vite l'Assemblée réactionnaire. La mort de son fils aîné le conduit au moment de la Commune en Belgique, qu'il doit quitter pour le Luxembourg, où il travaille aux poèmes de l'Année terrible (1872). La veine de Châtiments y éclate au profit des opprimés en un décisif « Je suis avec vous », et prophétise le déluge (1872). En une année de retraite à Guemesey, c'est enfin le dernier roman, Quatrevingt-Treize, publié au début de 1874, consacré à la Vendée, à la Convention, à la Terreur, mais aussi à l'Océan, à la nature, aux livres, à l'enfance, au dialogue des intellectuels et du peuple, des vertus aristocratiques et militaires, de la sorcellerie et de la maternité. Au terme d'un long rapprochement, c'est le grand livre michelétiste de Hugo, l'année même de la mort de l'historien.
La publication Actes et Paroles (1875-76), l'élection au Sénat renforcent la puissance de l'engagement politique, centré sur la lutte pour l'amnistie, la « pitié suprême », la révolution non sanglante, contre les tentatives de coup d'État monarchiste. Tout s'organise désormais en ce sens (deuxième série de la Légende, l'Art d'être grand-père, 1'Histoire d'un crime, le Pape : 1877-78). En 1878, à la veille de la congestion cérébrale qui met fin à son activité créatrice, Hugo célèbre pour le centenaire de Voltaire ce passage de l'homme-événement à l'homme-siècle qui résume si bien sa propre vie.
Jusqu'à sa mort, pour laquelle le Panthéon est rendu au culte des grands hommes, l'activité politique et mondaine ne cesse pas, et des publications successives d'œuvres anciennes — la Pitié suprême (1879), Religions et Religion, l'Ane (1880), les Quatre Vents de l'esprit (1881), Torquemada (1882), la série complémentaire de la Légende (1883) — entretiennent la gloire du poète, dont l'école laïque se met à exploiter les aspects les plus rassurants. Jusqu'au centenaire tricolore de 1902, les révélations d'inédits se poursuivent : Théâtre en liberté (1886-1888), Fin de Satan (1886), Choses vues, Toute la lyre (1888-1893), Voyages (1890-1892), Dieu (1891), les Années funestes (1898), Dernière Gerbe. Cette époque est celle des éditions Hugues et Testard, remplacées par la monumentale édition de l'imprimerie nationale (1904-1952), puis par l'édition chronologique de J. Massin (1967-1969) dont les derniers volumes reproduisent les 2 000 dessins qui placent désormais Hugo parmi les grands artistes du xixe s. Les communications de masse, radio, télévision, théâtre de foule, ne cessent de lui procurer une faveur grandissante, qui tient à la plasticité idéologique de son œuvre, à son mélange de violence, d'ironie et de
sérénité, à l'équilibre souverain de la folie visionnaire et de la rigueur formelle. Mais, ce qui reste à découvrir encore dans la matérialité tumultueuse ou secrète de ce monument national, c'est une intelligence exceptionnelle de la socialité des mœurs, de l'historicité de l'individu et une religion scripturale de la responsabilité.