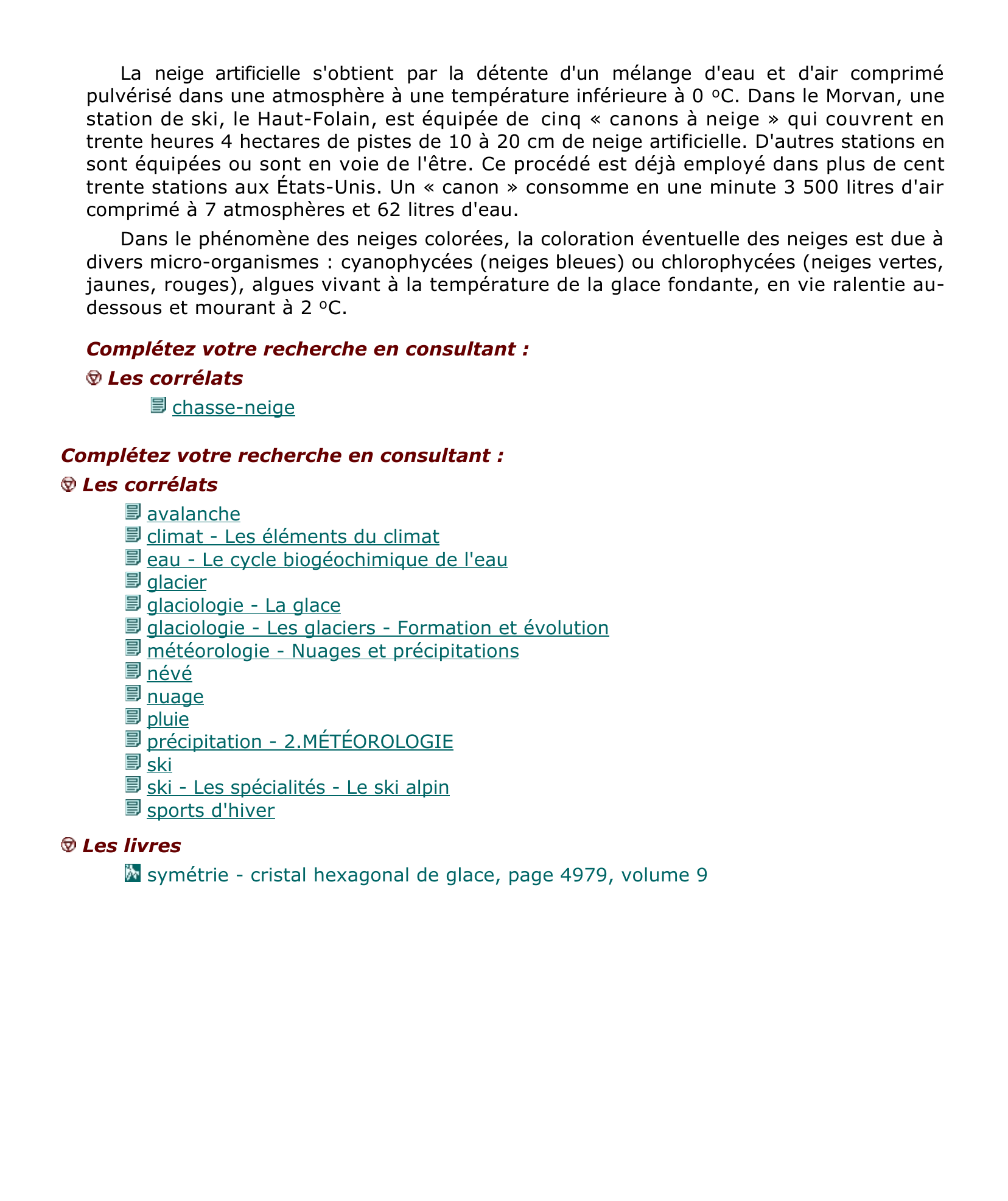neige. n.f., forme de précipitation atmosphérique. La neige est un hydrométéore qui se forme dans les nuages par la condensation à l'état solide et cristallisé de la vapeur d'eau, lorsque la température est inférieure à 0 o C. La transformation de vapeur en glace s'opère à des températures allant de - 5 à - 7 o C grâce à la présence de noyaux de congélation. Les cristaux tombent en grossissant à travers le nuage vers le sol ; lorsqu'ils atteignent l'isotherme 0 o C, ils se soudent en flocons qui peuvent être très gros. La neige est formée de cristaux du système hexagonal. Ces cristaux ont généralement la forme d'une étoile à six rayons, ramifiés eux-mêmes de façons très variées, avec cette particularité que, quel que soit le dessin formé, les angles que font entre eux les divers éléments sont toujours de 60o ou multiples de 60o . Il neige surtout quand la température est de l'ordre de - 1 o C à 0 o C, mais, en raison du temps de fusion des flocons, on peut avoir des chutes de neige même lorsqu'il fait plusieurs degrés au-dessus de 0 o C. Aux latitudes de l'Europe occidentale, il est à peu près établi que, lorsque la température au sol est voisine de 0 o C, les précipitations se font sous forme de neige pour 93 à 97 % des cas, et pour 99 % si elle avoisine - 1 o C. On peut facilement aujourd'hui détecter l'existence de neige dans un nuage grâce au radar, car l'écho des ondes est très différent s'il s'agit de pluie ou de cristaux de neige. Par temps froid prolongé, il se forme de minuscules cristaux de glace qui semblent planer dans l'air et brillent au soleil. Le grésil est constitué de petits grains de glace translucide ou blanche, de forme sensiblement sphérique, ayant 5 mm de diamètre au plus. On confond parfois le grésil avec la neige en grains, dite neige roulée, due souvent à la congélation de la bruine. La grêle, tombant en averses appelées giboulées, est composée de grêlons pouvant atteindre plusieurs centimètres de diamètre. Le manteau neigeux et les avalanches. La neige déposée sur le sol constitue le manteau neigeux, qui forme un isolant thermique pour la surface du sol recouverte. La couche totale est composée de strates formées par les chutes successives qui se produisent au cours d'un hiver. Chacune de ces strates garde l'empreinte des conditions météorologiques qui ont accompagné la chute ; il en résulte que les propriétés du manteau neigeux sont essentiellement anisotropes, c'est-à-dire dépourvues d'homogénéité. La neige engendre, lorsqu'elle est en couche importante, des avalanches. Le déclenchement d'avalanches se produit quand il y a déséquilibre entre la résistance au cisaillement et à la traction et la composante tangentielle du poids. La résistance est fonction d'une part de la cohésion des grains de neige, d'autre part de la friction statique interne, qui est proportionnelle à la pression normale exercée par le manteau neigeux à ses différents niveaux intérieurs. La seconde est la force dynamique qui résulte du poids du manteau suivant la pente, poids qui tend à entraîner la couche vers l'aval. Les chutes de neige fraîche sont la cause principale d'inégalité entre ces deux forces. On considère qu'il n'y a rupture provoquant une avalanche que sur les pentes supérieures à 45 %. La limite des neiges temporaires change d'une année à l'autre. La limite des neiges éternelles varie non seulement avec l'altitude et la latitude, mais encore selon l'exposition, l'influence maritime et de nombreux autres facteurs climatologiques. Sous les tropiques, elle se situe entre 4 000 et 6 200 m d'altitude ; dans les Alpes, au voisinage de 2 700 m ; à l'intérieur de la Norvège, à 1 000 m environ ; elle atteint le niveau de la mer à 81 o de latitude nord (côte orientale du Groenland) et à 53 o de latitude sud (île Heard, au sud-est des Kerguelen). La neige artificielle s'obtient par la détente d'un mélange d'eau et d'air comprimé pulvérisé dans une atmosphère à une température inférieure à 0 o C. Dans le Morvan, une station de ski, le Haut-Folain, est équipée de cinq « canons à neige » qui couvrent en trente heures 4 hectares de pistes de 10 à 20 cm de neige artificielle. D'autres stations en sont équipées ou sont en voie de l'être. Ce procédé est déjà employé dans plus de cent trente stations aux États-Unis. Un « canon » consomme en une minute 3 500 litres d'air comprimé à 7 atmosphères et 62 litres d'eau. Dans le phénomène des neiges colorées, la coloration éventuelle des neiges est due à divers micro-organismes : cyanophycées (neiges bleues) ou chlorophycées (neiges vertes, jaunes, rouges), algues vivant à la température de la glace fondante, en vie ralentie audessous et mourant à 2 o C. Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats chasse-neige Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats avalanche climat - Les éléments du climat eau - Le cycle biogéochimique de l'eau glacier glaciologie - La glace glaciologie - Les glaciers - Formation et évolution météorologie - Nuages et précipitations névé nuage pluie précipitation - 2.MÉTÉOROLOGIE ski ski - Les spécialités - Le ski alpin sports d'hiver Les livres symétrie - cristal hexagonal de glace, page 4979, volume 9