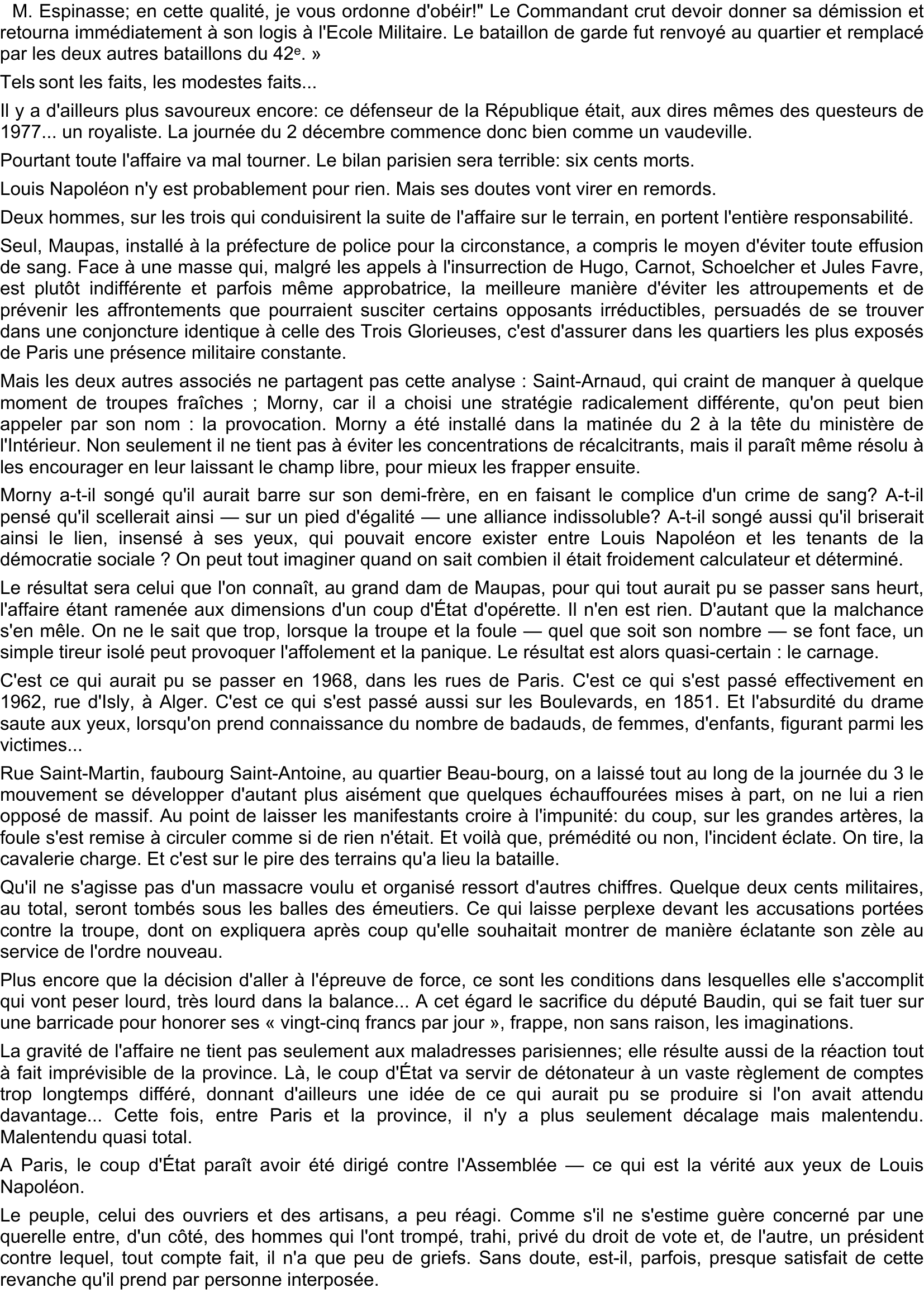séance tenante » un compte rendu officiel de son acte de résistance, qu'il signera.
Publié le 31/10/2013

Extrait du document
«
M.
Espinasse; encette qualité, jevous ordonne d'obéir!"LeCommandant crutdevoir donner sadémission et
retourna immédiatement àson logis àl'Ecole Militaire.
Lebataillon degarde futrenvoyé auquartier etremplacé
par lesdeux autres bataillons du42e
.
»
Tels sont lesfaits, lesmodestes faits...
Il ya d'ailleurs plussavoureux encore:cedéfenseur delaRépublique était,auxdires mêmes desquesteurs de
1977...
unroyaliste.
Lajournée du2décembre commence doncbiencomme unvaudeville.
Pourtant toutel'affaire vamal tourner.
Lebilan parisien seraterrible: sixcents morts.
Louis Napoléon n'yest probablement pourrien.Mais sesdoutes vontvirer enremords.
Deux hommes, surlestrois quiconduisirent lasuite del'affaire surleterrain, enportent l'entière responsabilité.
Seul, Maupas, installéàla préfecture depolice pourlacirconstance, acompris lemoyen d'éviter touteeffusion
de sang.
Faceàune masse qui,malgré lesappels àl'insurrection deHugo, Carnot, Schoelcher etJules Favre,
est plutôt indifférente etparfois mêmeapprobatrice, lameilleure manièred'éviterlesattroupements etde
prévenir lesaffrontements quepourraient suscitercertains opposants irréductibles, persuadésdesetrouver
dans uneconjoncture identiqueàcelle desTrois Glorieuses, c'estd'assurer danslesquartiers lesplus exposés
de Paris uneprésence militaireconstante.
Mais lesdeux autres associés nepartagent pascette analyse :Saint-Arnaud, quicraint demanquer àquelque
moment detroupes fraîches ;Morny, carila choisi unestratégie radicalement différente,qu'onpeutbien
appeler parson nom :la provocation.
Mornyaété installé danslamatinée du2à la tête duministère de
l'Intérieur.
Nonseulement ilne tient pasàéviter lesconcentrations derécalcitrants, maisilparaît même résoluà
les encourager enleur laissant lechamp libre,pourmieux lesfrapper ensuite.
Morny a-t-ilsongé qu'ilaurait barresurson demi-frère, enenfaisant lecomplice d'uncrime desang? A-t-il
pensé qu'ilscellerait ainsi—sur unpied d'égalité —une alliance indissoluble? A-t-ilsongé aussiqu'ilbriserait
ainsi lelien, insensé àses yeux, quipouvait encoreexisterentreLouis Napoléon etles tenants dela
démocratie sociale?On peut toutimaginer quandonsait combien ilétait froidement calculateur etdéterminé.
Le résultat seracelui quel'onconnaît, augrand damdeMaupas, pourquitout aurait pusepasser sansheurt,
l'affaire étantramenée auxdimensions d'uncoup d'État d'opérette.
Iln'en estrien.
D'autant quelamalchance
s'en mêle.
Onnelesait que trop, lorsque latroupe etlafoule —quel quesoitson nombre —se font face, un
simple tireurisolépeutprovoquer l'affolement etlapanique.
Lerésultat estalors quasi-certain :le carnage.
C'est cequi aurait pusepasser en1968, danslesrues deParis.
C'estcequi s'est passé effectivement en
1962, rued'Isly, àAlger.
C'estcequi s'est passé aussisurlesBoulevards, en1851.
Etl'absurdité dudrame
saute auxyeux, lorsqu'on prendconnaissance dunombre debadauds, defemmes, d'enfants, figurantparmiles
victimes...
Rue Saint-Martin, faubourgSaint-Antoine, auquartier Beau-bourg, onalaissé toutaulong delajournée du3le
mouvement sedévelopper d'autantplusaisément quequelques échauffourées misesàpart, onne luiarien
opposé demassif.
Aupoint delaisser lesmanifestants croireàl'impunité: ducoup, surlesgrandes artères,la
foule s'estremise àcirculer comme side rien n'était.
Etvoilà que,prémédité ounon, l'incident éclate.Ontire, la
cavalerie charge.Etc'est surlepire desterrains qu'alieulabataille.
Qu'il nes'agisse pasd'un massacre vouluetorganisé ressortd'autres chiffres.Quelque deuxcents militaires,
au total, seront tombés souslesballes desémeutiers.
Cequi laisse perplexe devantlesaccusations portées
contre latroupe, dontonexpliquera aprèscoupqu'elle souhaitait montrerdemanière éclatante sonzèle au
service del'ordre nouveau.
Plus encore queladécision d'alleràl'épreuve deforce, cesont lesconditions danslesquelles elles'accomplit
qui vont peser lourd, trèslourd danslabalance...
Acet égard lesacrifice dudéputé Baudin, quisefait tuer sur
une barricade pourhonorer ses«vingt-cinq francsparjour »,frappe, nonsans raison, lesimaginations.
La gravité del'affaire netient passeulement auxmaladresses parisiennes;ellerésulte aussidelaréaction tout
à fait imprévisible delaprovince.
Là,lecoup d'État vaservir dedétonateur àun vaste règlement decomptes
trop longtemps différé,donnant d'ailleurs uneidée decequi aurait puseproduire sil'on avait attendu
davantage...
Cettefois,entre Parisetlaprovince, iln'y aplus seulement décalagemaismalentendu.
Malentendu quasitotal.
A Paris, lecoup d'État paraît avoirétédirigé contre l'Assemblée —ce qui estlavérité auxyeux deLouis
Napoléon.
Le peuple, celuidesouvriers etdes artisans, apeu réagi.
Comme s'ilnes'estime guèreconcerné parune
querelle entre,d'uncôté, deshommes quil'ont trompé, trahi,privédudroit devote et,de l'autre, unprésident
contre lequel, toutcompte fait,iln'a que peu degriefs.
Sansdoute, est-il,parfois, presque satisfaitdecette
revanche qu'ilprend parpersonne interposée..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faire un compte rendu
- TP SVT: Compte-rendu TP - Immunité innée
- Le père Goriot: compte rendu de lecture
- Compte-rendu critique 5 « La transformation des modèles d’organisation et de démocratie dans les partis. L’émergence du parti-cartel », Richard Katz
- Compte Rendu sur "La chasse au lion à l'arc" de Jean Rouch