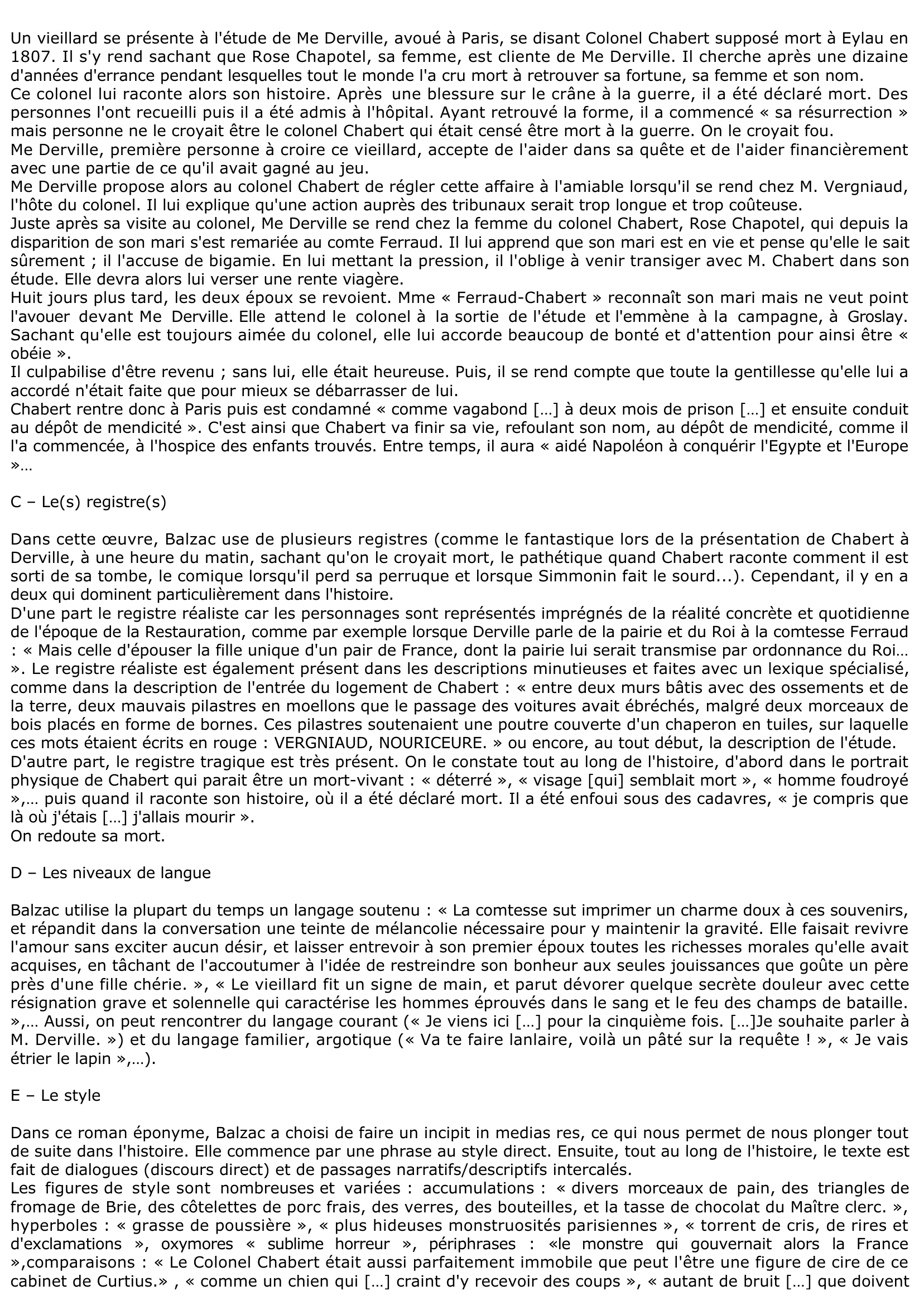Le Colonel Chabert
Publié le 19/04/2011

Extrait du document
FICHE DE LECTURE
Auteur : Honoré de Balzac
Œuvre : Le Colonel Chabert
Edition : Hatier
I - Recherches documentaires
A - Biographie de l’auteur :
Honoré de Balzac est né en 1799 à Tours où il a grandi. A l’âge de 15 ans, sa famille s’installe à Paris. Balzac y entreprend des études de Droit et travaille comme clerc d’avoué et de notaire.
En 1819, à 20 ans, il renonce à sa carrière juridique et se consacre à la création littéraire. Il écrit des pièces de théâtre et des romans sans succès publiés par épisodes dans des revues. En même temps, il crée une entreprise d’imprimerie qui fait faillite et le couvre de dettes. Ce n’est que dix ans plus tard, en 1829, que le succès arrive avec sa publication de Le Dernier Chouan ou la Bretagne en 1800. Ce succès se confirme ensuite en 1931 avec La Peau de chagrin.
Balzac écrit alors roman sur roman publiés dans des éditions groupées (Romans philosophiques, Etudes de mœurs).
En 1832, la correspondance avec une admiratrice russe (Mme Hanska) le mène au mariage, en 1850.
«
Un vieillard se présente à l'étude de Me Derville, avoué à Paris, se disant Colonel Chabert supposé mort à Eylau en1807.
Il s'y rend sachant que Rose Chapotel, sa femme, est cliente de Me Derville.
Il cherche après une dizained'années d'errance pendant lesquelles tout le monde l'a cru mort à retrouver sa fortune, sa femme et son nom.Ce colonel lui raconte alors son histoire.
Après une blessure sur le crâne à la guerre, il a été déclaré mort.
Despersonnes l'ont recueilli puis il a été admis à l'hôpital.
Ayant retrouvé la forme, il a commencé « sa résurrection »mais personne ne le croyait être le colonel Chabert qui était censé être mort à la guerre.
On le croyait fou.Me Derville, première personne à croire ce vieillard, accepte de l'aider dans sa quête et de l'aider financièrementavec une partie de ce qu'il avait gagné au jeu.Me Derville propose alors au colonel Chabert de régler cette affaire à l'amiable lorsqu'il se rend chez M.
Vergniaud,l'hôte du colonel.
Il lui explique qu'une action auprès des tribunaux serait trop longue et trop coûteuse.Juste après sa visite au colonel, Me Derville se rend chez la femme du colonel Chabert, Rose Chapotel, qui depuis ladisparition de son mari s'est remariée au comte Ferraud.
Il lui apprend que son mari est en vie et pense qu'elle le saitsûrement ; il l'accuse de bigamie.
En lui mettant la pression, il l'oblige à venir transiger avec M.
Chabert dans sonétude.
Elle devra alors lui verser une rente viagère.Huit jours plus tard, les deux époux se revoient.
Mme « Ferraud-Chabert » reconnaît son mari mais ne veut pointl'avouer devant Me Derville.
Elle attend le colonel à la sortie de l'étude et l'emmène à la campagne, à Groslay.Sachant qu'elle est toujours aimée du colonel, elle lui accorde beaucoup de bonté et d'attention pour ainsi être «obéie ».Il culpabilise d'être revenu ; sans lui, elle était heureuse.
Puis, il se rend compte que toute la gentillesse qu'elle lui aaccordé n'était faite que pour mieux se débarrasser de lui.Chabert rentre donc à Paris puis est condamné « comme vagabond […] à deux mois de prison […] et ensuite conduitau dépôt de mendicité ».
C'est ainsi que Chabert va finir sa vie, refoulant son nom, au dépôt de mendicité, comme ill'a commencée, à l'hospice des enfants trouvés.
Entre temps, il aura « aidé Napoléon à conquérir l'Egypte et l'Europe»…
C – Le(s) registre(s)
Dans cette œuvre, Balzac use de plusieurs registres (comme le fantastique lors de la présentation de Chabert àDerville, à une heure du matin, sachant qu'on le croyait mort, le pathétique quand Chabert raconte comment il estsorti de sa tombe, le comique lorsqu'il perd sa perruque et lorsque Simmonin fait le sourd...).
Cependant, il y en adeux qui dominent particulièrement dans l'histoire.D'une part le registre réaliste car les personnages sont représentés imprégnés de la réalité concrète et quotidiennede l'époque de la Restauration, comme par exemple lorsque Derville parle de la pairie et du Roi à la comtesse Ferraud: « Mais celle d'épouser la fille unique d'un pair de France, dont la pairie lui serait transmise par ordonnance du Roi…».
Le registre réaliste est également présent dans les descriptions minutieuses et faites avec un lexique spécialisé,comme dans la description de l'entrée du logement de Chabert : « entre deux murs bâtis avec des ossements et dela terre, deux mauvais pilastres en moellons que le passage des voitures avait ébréchés, malgré deux morceaux debois placés en forme de bornes.
Ces pilastres soutenaient une poutre couverte d'un chaperon en tuiles, sur laquelleces mots étaient écrits en rouge : VERGNIAUD, NOURICEURE.
» ou encore, au tout début, la description de l'étude.D'autre part, le registre tragique est très présent.
On le constate tout au long de l'histoire, d'abord dans le portraitphysique de Chabert qui parait être un mort-vivant : « déterré », « visage [qui] semblait mort », « homme foudroyé»,… puis quand il raconte son histoire, où il a été déclaré mort.
Il a été enfoui sous des cadavres, « je compris quelà où j'étais […] j'allais mourir ».On redoute sa mort.
D – Les niveaux de langue
Balzac utilise la plupart du temps un langage soutenu : « La comtesse sut imprimer un charme doux à ces souvenirs,et répandit dans la conversation une teinte de mélancolie nécessaire pour y maintenir la gravité.
Elle faisait revivrel'amour sans exciter aucun désir, et laisser entrevoir à son premier époux toutes les richesses morales qu'elle avaitacquises, en tâchant de l'accoutumer à l'idée de restreindre son bonheur aux seules jouissances que goûte un pèreprès d'une fille chérie.
», « Le vieillard fit un signe de main, et parut dévorer quelque secrète douleur avec cetterésignation grave et solennelle qui caractérise les hommes éprouvés dans le sang et le feu des champs de bataille.»,… Aussi, on peut rencontrer du langage courant (« Je viens ici […] pour la cinquième fois.
[…]Je souhaite parler àM.
Derville.
») et du langage familier, argotique (« Va te faire lanlaire, voilà un pâté sur la requête ! », « Je vaisétrier le lapin »,…).
E – Le style
Dans ce roman éponyme, Balzac a choisi de faire un incipit in medias res, ce qui nous permet de nous plonger toutde suite dans l'histoire.
Elle commence par une phrase au style direct.
Ensuite, tout au long de l'histoire, le texte estfait de dialogues (discours direct) et de passages narratifs/descriptifs intercalés.Les figures de style sont nombreuses et variées : accumulations : « divers morceaux de pain, des triangles defromage de Brie, des côtelettes de porc frais, des verres, des bouteilles, et la tasse de chocolat du Maître clerc.
»,hyperboles : « grasse de poussière », « plus hideuses monstruosités parisiennes », « torrent de cris, de rires etd'exclamations », oxymores « sublime horreur », périphrases : «le monstre qui gouvernait alors la France»,comparaisons : « Le Colonel Chabert était aussi parfaitement immobile que peut l'être une figure de cire de cecabinet de Curtius.» , « comme un chien qui […] craint d'y recevoir des coups », « autant de bruit […] que doivent.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Colonel Chabert
- (SA). En 1832, Balzac écrit colonel Chabert. Balzac est né
- fiche de lecture : le colonel chabert
- Fiche de lecture : Le Colonel Chabert
- Le personnage de CHABERT (le colonel) d’Honoré de Balzac