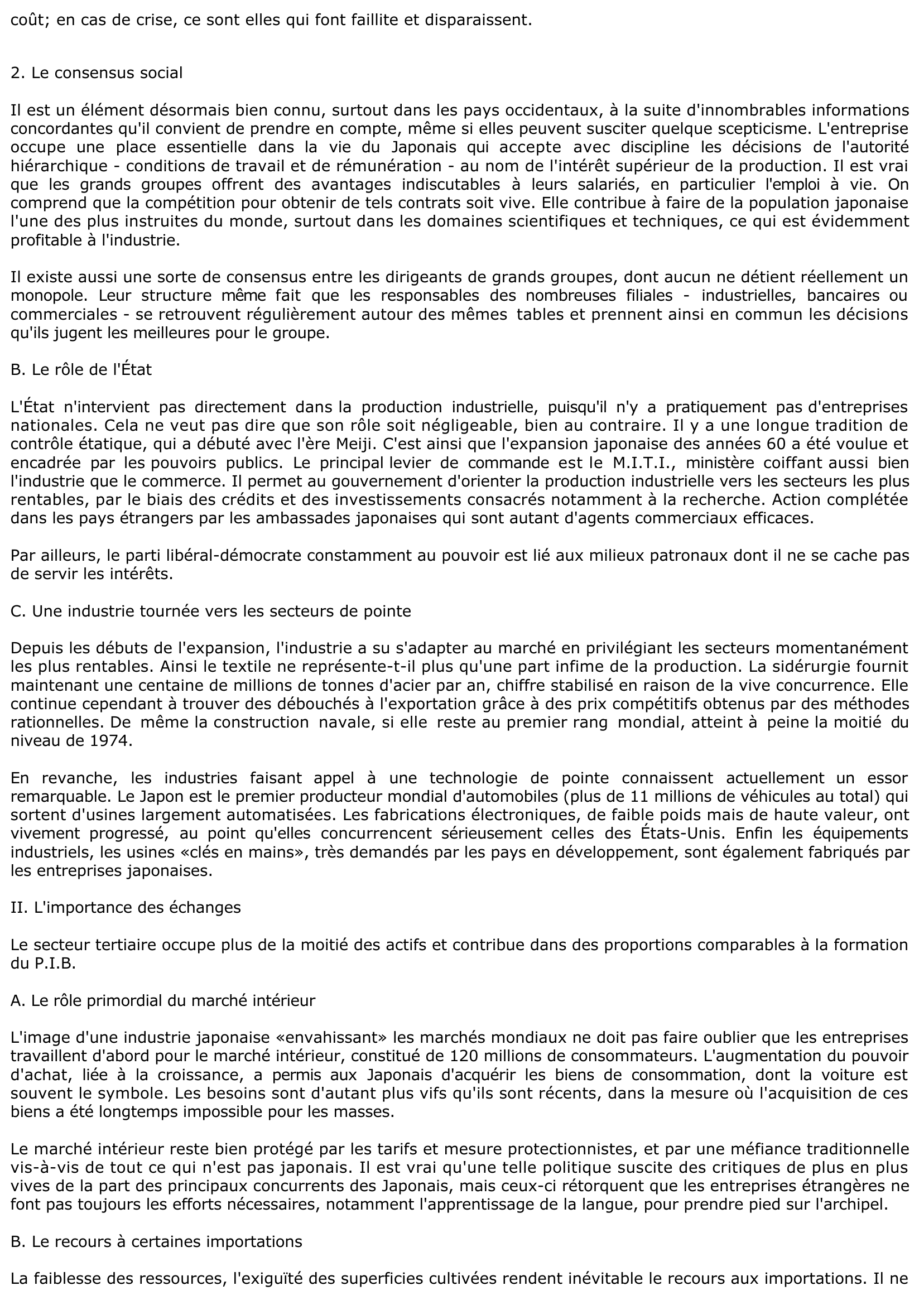1984: LES ÉLÉMENTS DE LA PUISSANCE ÉCONOMIQUE DU JAPON
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
Plan
I. L'industrie, base de la puissance japonaise
À. Les structures
1. L'organisation des entreprises
2. Le consensus social
B. Le rôle de l'État
II. L'importance des échanges
A. Le rôle primordial du marché intérieur
B. Le recours à certaines importations
1. Matières premières et énergie
2. Les produits alimentaires
C. Les succès à l'exportation
1. La conquête des marchés extérieurs
2. L'excédent commercial
«
coût; en cas de crise, ce sont elles qui font faillite et disparaissent.
2.
Le consensus social
Il est un élément désormais bien connu, surtout dans les pays occidentaux, à la suite d'innombrables informationsconcordantes qu'il convient de prendre en compte, même si elles peuvent susciter quelque scepticisme.
L'entrepriseoccupe une place essentielle dans la vie du Japonais qui accepte avec discipline les décisions de l'autoritéhiérarchique - conditions de travail et de rémunération - au nom de l'intérêt supérieur de la production.
Il est vraique les grands groupes offrent des avantages indiscutables à leurs salariés, en particulier l'emploi à vie.
Oncomprend que la compétition pour obtenir de tels contrats soit vive.
Elle contribue à faire de la population japonaisel'une des plus instruites du monde, surtout dans les domaines scientifiques et techniques, ce qui est évidemmentprofitable à l'industrie.
Il existe aussi une sorte de consensus entre les dirigeants de grands groupes, dont aucun ne détient réellement unmonopole.
Leur structure même fait que les responsables des nombreuses filiales - industrielles, bancaires oucommerciales - se retrouvent régulièrement autour des mêmes tables et prennent ainsi en commun les décisionsqu'ils jugent les meilleures pour le groupe.
B.
Le rôle de l'État
L'État n'intervient pas directement dans la production industrielle, puisqu'il n'y a pratiquement pas d'entreprisesnationales.
Cela ne veut pas dire que son rôle soit négligeable, bien au contraire.
Il y a une longue tradition decontrôle étatique, qui a débuté avec l'ère Meiji.
C'est ainsi que l'expansion japonaise des années 60 a été voulue etencadrée par les pouvoirs publics.
Le principal levier de commande est le M.I.T.I., ministère coiffant aussi bienl'industrie que le commerce.
Il permet au gouvernement d'orienter la production industrielle vers les secteurs les plusrentables, par le biais des crédits et des investissements consacrés notamment à la recherche.
Action complétéedans les pays étrangers par les ambassades japonaises qui sont autant d'agents commerciaux efficaces.
Par ailleurs, le parti libéral-démocrate constamment au pouvoir est lié aux milieux patronaux dont il ne se cache pasde servir les intérêts.
C.
Une industrie tournée vers les secteurs de pointe
Depuis les débuts de l'expansion, l'industrie a su s'adapter au marché en privilégiant les secteurs momentanémentles plus rentables.
Ainsi le textile ne représente-t-il plus qu'une part infime de la production.
La sidérurgie fournitmaintenant une centaine de millions de tonnes d'acier par an, chiffre stabilisé en raison de la vive concurrence.
Ellecontinue cependant à trouver des débouchés à l'exportation grâce à des prix compétitifs obtenus par des méthodesrationnelles.
De même la construction navale, si elle reste au premier rang mondial, atteint à peine la moitié duniveau de 1974.
En revanche, les industries faisant appel à une technologie de pointe connaissent actuellement un essorremarquable.
Le Japon est le premier producteur mondial d'automobiles (plus de 11 millions de véhicules au total) quisortent d'usines largement automatisées.
Les fabrications électroniques, de faible poids mais de haute valeur, ontvivement progressé, au point qu'elles concurrencent sérieusement celles des États-Unis.
Enfin les équipementsindustriels, les usines «clés en mains», très demandés par les pays en développement, sont également fabriqués parles entreprises japonaises.
II.
L'importance des échanges
Le secteur tertiaire occupe plus de la moitié des actifs et contribue dans des proportions comparables à la formationdu P.I.B.
A.
Le rôle primordial du marché intérieur
L'image d'une industrie japonaise «envahissant» les marchés mondiaux ne doit pas faire oublier que les entreprisestravaillent d'abord pour le marché intérieur, constitué de 120 millions de consommateurs.
L'augmentation du pouvoird'achat, liée à la croissance, a permis aux Japonais d'acquérir les biens de consommation, dont la voiture estsouvent le symbole.
Les besoins sont d'autant plus vifs qu'ils sont récents, dans la mesure où l'acquisition de cesbiens a été longtemps impossible pour les masses.
Le marché intérieur reste bien protégé par les tarifs et mesure protectionnistes, et par une méfiance traditionnellevis-à-vis de tout ce qui n'est pas japonais.
Il est vrai qu'une telle politique suscite des critiques de plus en plusvives de la part des principaux concurrents des Japonais, mais ceux-ci rétorquent que les entreprises étrangères nefont pas toujours les efforts nécessaires, notamment l'apprentissage de la langue, pour prendre pied sur l'archipel.
B.
Le recours à certaines importations
La faiblesse des ressources, l'exiguïté des superficies cultivées rendent inévitable le recours aux importations.
Il ne.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- De la capitulation au statut de grande puissance économique : la reconstruction du Japon après la Seconde Guerre mondiale
- Le japon , deuxième puissance économique de la planète
- Composition : Le Japon, puissance économique mondiale
- Le Japon, une puissance économique ouverte sur le monde
- Le Japon, puissance économique mondiale