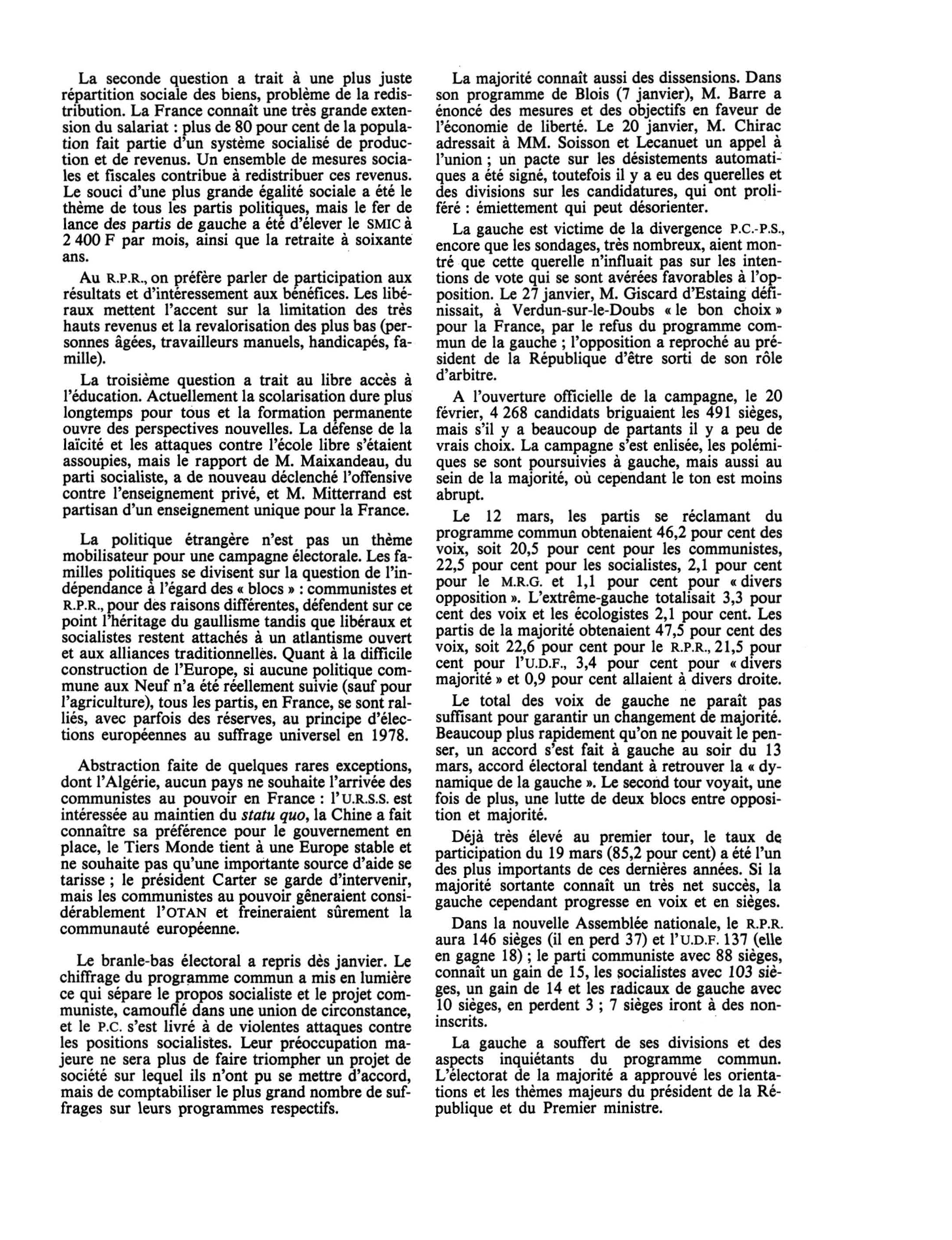AVRIL 1978 DANS LE MONDE
Publié le 15/11/2011
Extrait du document
Au R.P.R., on préfère parler de participation aux résultats et d'intéressement aux benéfices. Les libéraux mettent l'accent sur la limitation des très hauts revenus et la revalorisation des plus bas (personnes âgées, travailleurs manuels, handicapés, famille). La troisième question a trait au libre accès à l'éducation. Actuellement la scolarisation dure plus longtemps pour tous et la formation permanente ouvre des perspectives nouvelles. La defense de la laïcité et les attaques contre l'école libre s'étaient assoupies, mais le rapport de M. Maixandeau, du parti socialiste, a de nouveau déclenché l'offensive contre l'enseignement privé, et M. Mitterrand est partisan d'un enseignement unique pour la France.
«
La seconde question a trait à une plus juste
répartition sociale des biens, problème de la redis
tr ibution.
La France connaît une très grande exten
sion du salariat : plus de 80 pour cent de la popula
tion fait partie d'un système socialisé de produc
tion et de revenus .
Un ensemble de mesures socia
les et fiscales contribue à redistribuer ces revenus .
Le souci d'une plus grande égalité sociale a été
le thème de tous les partis politi9ues, mais le fer de
lance des partis de gauche a éte d'élever le SMIC à
2 400 F par mois, ainsi que la retraite à soixante
ans.
·
Au R.P .R ., on préfère parler de participation aux
résultats et d'intéressement aux benéfices.
Les libé
raux mettent l' accent sur la limitation des très
hauts revenus et la revalorisation des plus bas (per
sonnes âgées, travailleurs manuels, handicapés, fa
mille) .
La troisième question a trait au libre accès à
l'éducation .
Actuellement la scolarisation dure plus
longtemps pour
tous et la formation ~rmanente ouv re des perspectives nouvelles.
La defense de la
laïcité et les attaques contre l'école libre s'étaient
assoupies , mais le rapport de
M.
Maixandeau, du
parti socialiste, a de nouveau déclenché l'offensive
contre l'enseignement privé, et M.
Mitterrand est
partisan d'un enseignement unique pour la France.
La politique étrangère n'est pas un thème
mobilisateur pour une campagne électorale.
Les fa
milles politiques se divisent sur la question de l'in
dépendance a l'égard des
« blocs » : communistes et
R .P .R ., pour dès raisons différentes, défendent sur ce
point l'héritage du gaullisme tandis que libéraux et
socialistes restent attachés
à un atlantisme ouvert
et aux alliances traditionnelles.
Quant à la difficile
construction de l'Europe, si aucune politique com
mune aux
Neuf n'a été réellement suivie (sauf pour
l'agriculture), tous les partis, en France, se sont ral
liés , avec parfois des réserves, au principe d'élec
tions européennes au suffrage universel en 1978.
Abstraction faite de quelques rares exceptions,
dont l'Algérie, aucun pays ne souhaite l'arrivée des
communistes
au pouvoir en France : l'U .R .S . S.
est
intéressée au maintien du statu quo, la Chine a fait
connaître sa préférence pour le gouvernement en
place ,
le Tiers Monde tient à une Europe stable et
ne souhaite pas qu'une importante source d'aide se
tarisse ; le président Carter se garde d'intervenir,
ma is les communistes au pouvoir gêneraient consi
dérablement l'OTAN et freineraient sûrement la
communauté européenne.
Le branle -bas électoral a repris dès janvier.
Le
chiffrage du
progr!lffillle commun a mis en lumière
ce qui sépare le propos socialiste et le projet com
muniste , camouflé dans une union de circonstance,
et
le P .C .
s'est livré à de violentes attaques contre
les posit ions socialistes .
Leur préoccupation ma
jeure ne sera plus de faire
triompher un projet de
soc iété sur lequel ils n' ont pu se mettre d'accord,
mais de comptabiliser le plus grand nombre de suf
frages sur leurs programmes respectifs.
La majorité connaît aussi des dissens ions.
Dans
son programme de Blois (7 janvier), M.
Barre a
énoncé des mesures et des objectifs en faveur de
l 'économie de liberté.
Le
20 janvier, M.
Chirac
adressait à MM.
Soisson et Lecanuet un appel à
l'union ; uil pacte sur les désistements automati ~ ques a été signé , toutefois il y a eu des querelles et
des divisions sur les candidatures, qui ont proli-
féré : émiettement qui peut désorienter.
·
La gauche est victime de la divergence P.C.-P .S., encore que les sondages , très nombreux, aient mon
tré que cette querelle n'influait pas sur les inten
tions de vote qui se sont avérées favorables à l'op
position.
Le
27 janvier, M.
Giscard d'Estaing défi
nissait, à Verdun -sur-le-Doubs «le bon choix » pour la France , par le refus du programme com
mun de la gauche ; l'opposition a reproché au pré
sident de la République d'être sorti de son rôle
d'arbitre.
A l'ouverture officielle de la campagne ,
le 20 février, 4 268 candidats briguaient les 491 sièges,
mais s'il y a beaucoup de partants il y a peu de
vrais choix.
La campagne s'est enlisée, les polémi
ques se sont poursuivies à gauche, mais aussi au
sein de la majorité, où cependant le ton est moins
abrupt.
Le
12 mars , les partis se réclamant du
programme commun obtenaient 46,2 pour cent des
voix, soit
20,5 pour cent pour les communis t es,
22,5 pour cent pour les socialistes, 2, 1 pour cent
pour le M .R .G .
et 1,1 pour cent pour «divers opposition ».
L'extrême -gauche totalisait 3,3 pour
cent des voix et les écologistes 2, 1 pour cent.
Les
partis de la majorité obtenaient 4
7,5 pour cent des
v oix, soit 22,6 pour cent pour le R.P .R., 21,5 pour
cent pour l'U.D .F ., 3,4 pour cent pour « divers
majorité » et 0,9 pour cent allaient à divers droite.
Le total des voix de gauche ne paraît pas
suffisant pour garantir un changement de majorité.
Beaucoup plus rapidement qu'on ne pouvait le pen
ser, un accord s'est fait à gauche au soir du
13 mars , accord électoral tendant à retrouver la « dy
namique de la gauche ».
Le second tour voyait, une
fois de plus , une lutte de deux blocs entre oppos i
tion et majorité.
Déjà très élevé au premier tour,
le taux de
participation du 19 mars (85,2 pour cent) a été l'un
des plus importants de ces dernières années.
Si la
majorité sortante connaît un très net succès, la
gauche cependant progresse en voix et en sièges .
Dans la nouvelle Assemblée nationale,
le R.P .R .
aura 146 sièges (il en perd 37) et l'U.D .F.
137 (elle en gagne 18); le parti communiste avec 88 sièges,
connaît un gain de 15, les $OCialistes avec 103 siè
ges , un gain de 14 et les radicaux de gauche av ec 10 sièges , en perdent 3 ; 7 sièges iront à des non-
inscrits .
·
La gauche a souffert de ses divisions et des
aspects inquiétants du programme commun.
L'électorat de la majorité a approuvé les orienta
tions et les thèmes majeurs du président de la Ré
publique et du Premier ministre..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- CAITLYN, CE HEROS… Le 24 avril dernier, Bruce Jenner se présentait aux yeux du monde sur la chaîne américaine ABC.
- «Titre», Je suis heureux de vous annoncer la venue au monde de Clémentine, ma fille, le 6 avril.
- ■ AVRIL 1957 dans le monde (histoire chronologique)
- 1964 Avril dans le monde (histoire chronologique)
- Avril 1969 dans le monde (histoire chronologique)