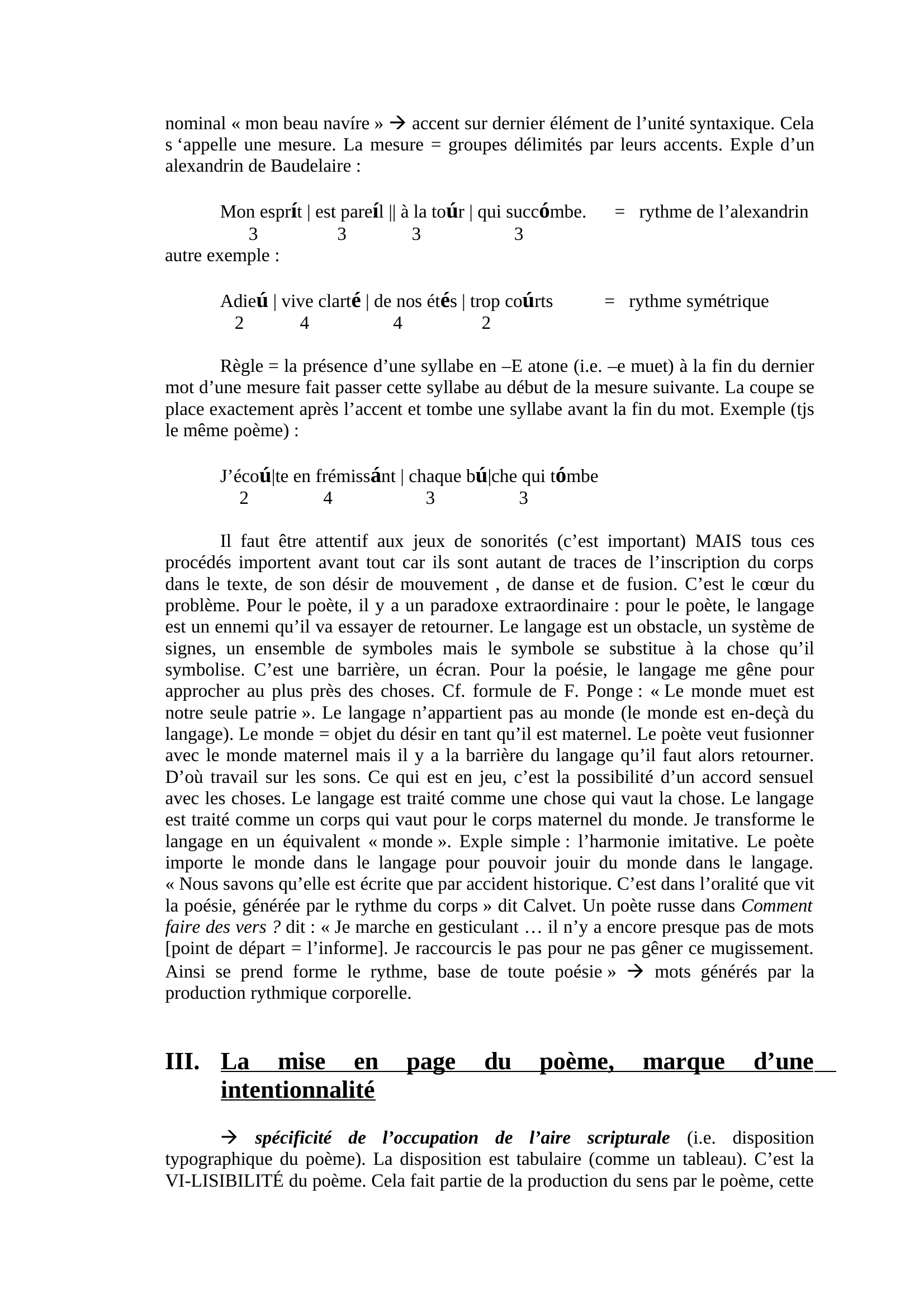Foucaut
Publié le 22/05/2014

Extrait du document
«
nominal « mon beau navíre » accent sur dernier élément de l’unité syntaxique.
Cela
s ‘appelle une mesure.
La mesure = groupes délimités par leurs accents.
Exple d’un
alexandrin de Baudelaire :
Mon espr í t | est pare í l || à la to ú r | qui succ ó mbe.
= rythme de l’alexandrin
3 3 3 3
autre exemple :
Adie ú | vive clart é | de nos ét é s | trop co ú rts = rythme symétrique
2 4 4 2
Règle = la présence d’une syllabe en –E atone (i.e.
–e muet) à la fin du dernier
mot d’une mesure fait passer cette syllabe au début de la mesure suivante.
La coupe se
place exactement après l’accent et tombe une syllabe avant la fin du mot.
Exemple (tjs
le même poème) :
J’éco ú |te en frémiss á nt | chaque b ú |che qui t ó mbe
2 4 3 3
Il faut être attentif aux jeux de sonorités (c’est important) MAIS tous ces
procédés importent avant tout car ils sont autant de traces de l’inscription du corps
dans le texte, de son désir de mouvement , de danse et de fusion.
C’est le cœur du
problème.
Pour le poète, il y a un paradoxe extraordinaire : pour le poète, le langage
est un ennemi qu’il va essayer de retourner.
Le langage est un obstacle, un système de
signes, un ensemble de symboles mais le symbole se substitue à la chose qu’il
symbolise.
C’est une barrière, un écran.
Pour la poésie, le langage me gêne pour
approcher au plus près des choses.
Cf.
formule de F.
Ponge : « Le monde muet est
notre seule patrie ».
Le langage n’appartient pas au monde (le monde est en-deçà du
langage).
Le monde = objet du désir en tant qu’il est maternel.
Le poète veut fusionner
avec le monde maternel mais il y a la barrière du langage qu’il faut alors retourner.
D’où travail sur les sons.
Ce qui est en jeu, c’est la possibilité d’un accord sensuel
avec les choses.
Le langage est traité comme une chose qui vaut la chose.
Le langage
est traité comme un corps qui vaut pour le corps maternel du monde.
Je transforme le
langage en un équivalent « monde ».
Exple simple : l’harmonie imitative.
Le poète
importe le monde dans le langage pour pouvoir jouir du monde dans le langage.
« Nous savons qu’elle est écrite que par accident historique.
C’est dans l’oralité que vit
la poésie, générée par le rythme du corps » dit Calvet.
Un poète russe dans Comment
faire des vers ? dit : « Je marche en gesticulant … il n’y a encore presque pas de mots
[point de départ = l’informe].
Je raccourcis le pas pour ne pas gêner ce mugissement.
Ainsi se prend forme le rythme, base de toute poésie » mots générés par la
production rythmique corporelle.
III.
La mise en page du poème, marque d’une
intentionnalité
spécificité de l’occupation de l’aire scripturale (i.e.
disposition
typographique du poème).
La disposition est tabulaire (comme un tableau).
C’est la
VI-LISIBILITÉ du poème.
Cela fait partie de la production du sens par le poème, cette.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓