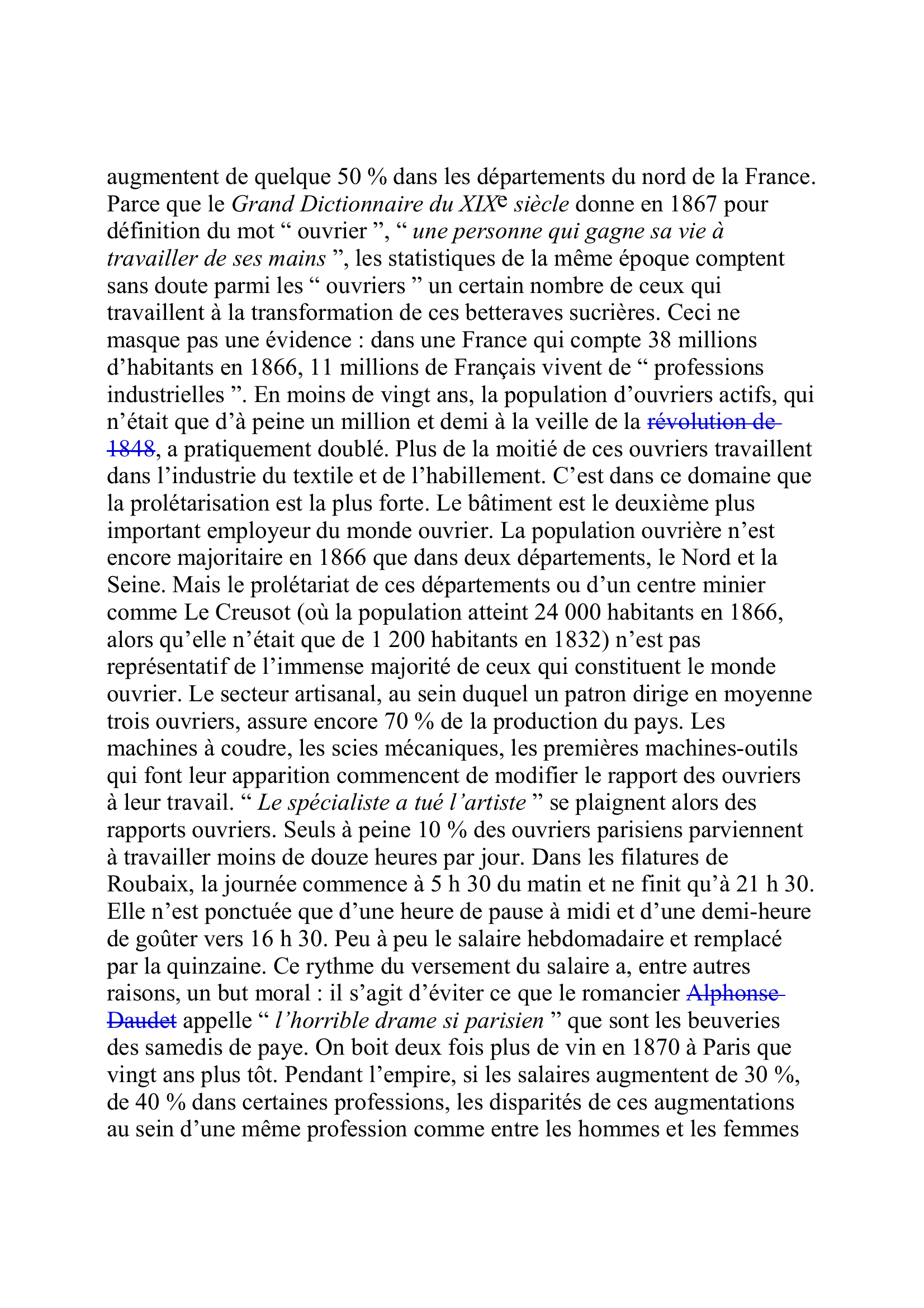Il faut se défaire d'une caricature.
Publié le 23/10/2012
Extrait du document
«
augmentent de quelque 50 % dans les départements du nord de la France.
Parce que le Grand Dictionnaire du XIX e siècle donne en 1867 pour
définition du mot “ ouvrier ”, “ une personne qui gagne sa vie à
travailler de ses mains ”, les statistiques de la même époque comptent
sans doute parmi les “ ouvriers ” un certain nombre de ceux qui
travaillent à la transformation de ces betteraves sucrières.
Ceci ne
masque pas une évidence : dans une France qui compte 38 millions
d’habitants en 1866, 11 millions de Français vivent de “ professions
industrielles ”.
En moins de vingt ans, la population d’ouvriers actifs, qui
n’était que d’à peine un million et demi à la veille de la révolution de
1848 , a pratiquement doublé.
Plus de la moitié de ces ouvriers travaillent
dans l’industrie du textile et de l’habillement.
C’est dans ce domaine que
la prolétarisation est la plus forte.
Le bâtiment est le deuxième plus
important employeur du monde ouvrier.
La population ouvrière n’est
encore majoritaire en 1866 que dans deux départements, le Nord et la
Seine.
Mais le prolétariat de ces départements ou d’un centre minier
comme Le Creusot (où la population atteint 24 000 habitants en 1866,
alors qu’elle n’était que de 1 200 habitants en 1832) n’est pas
représentatif de l’immense majorité de ceux qui constituent le monde
ouvrier.
Le secteur artisanal, au sein duquel un patron dirige en moyenne
trois ouvriers, assure encore 70 % de la production du pays.
Les
machines à coudre, les scies mécaniques, les premières machines-outils
qui font leur apparition commencent de modifier le rapport des ouvriers
à leur travail.
“ Le spécialiste a tué l’artiste ” se plaignent alors des
rapports ouvriers.
Seuls à peine 10 % des ouvriers parisiens parviennent
à travailler moins de douze heures par jour.
Dans les filatures de
Roubaix, la journée commence à 5 h 30 du matin et ne finit qu’à 21 h 30.
Elle n’est ponctuée que d’une heure de pause à midi et d’une demi-heure
de goûter vers 16 h 30.
Peu à peu le salaire hebdomadaire et remplacé
par la quinzaine.
Ce rythme du versement du salaire a, entre autres
raisons, un but moral : il s’agit d’éviter ce que le romancier Alphonse
Daudet appelle “ l’horrible drame si parisien ” que sont les beuveries
des samedis de paye.
On boit deux fois plus de vin en 1870 à Paris que
vingt ans plus tôt.
Pendant l’empire, si les salaires augmentent de 30 %,
de 40 % dans certaines professions, les disparités de ces augmentations
au sein d’une même profession comme entre les hommes et les femmes.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Faut-il limiter la liberté d'expression ?
- « L’art de la vie se rapproche de l’art de la lutte : il faut se tenir prêt sans broncher à répondre aux coups qui fondent sur nous, même s’ils sont imprévus » Marc Aurèle
- La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité dont il faut faire l'expérience. Kierkegaard
- On ne peut se défaire de la métaphysique comme on se défait d'une opinion. Heidegger
- Faut-il travailler moins pour vivre mieux ?