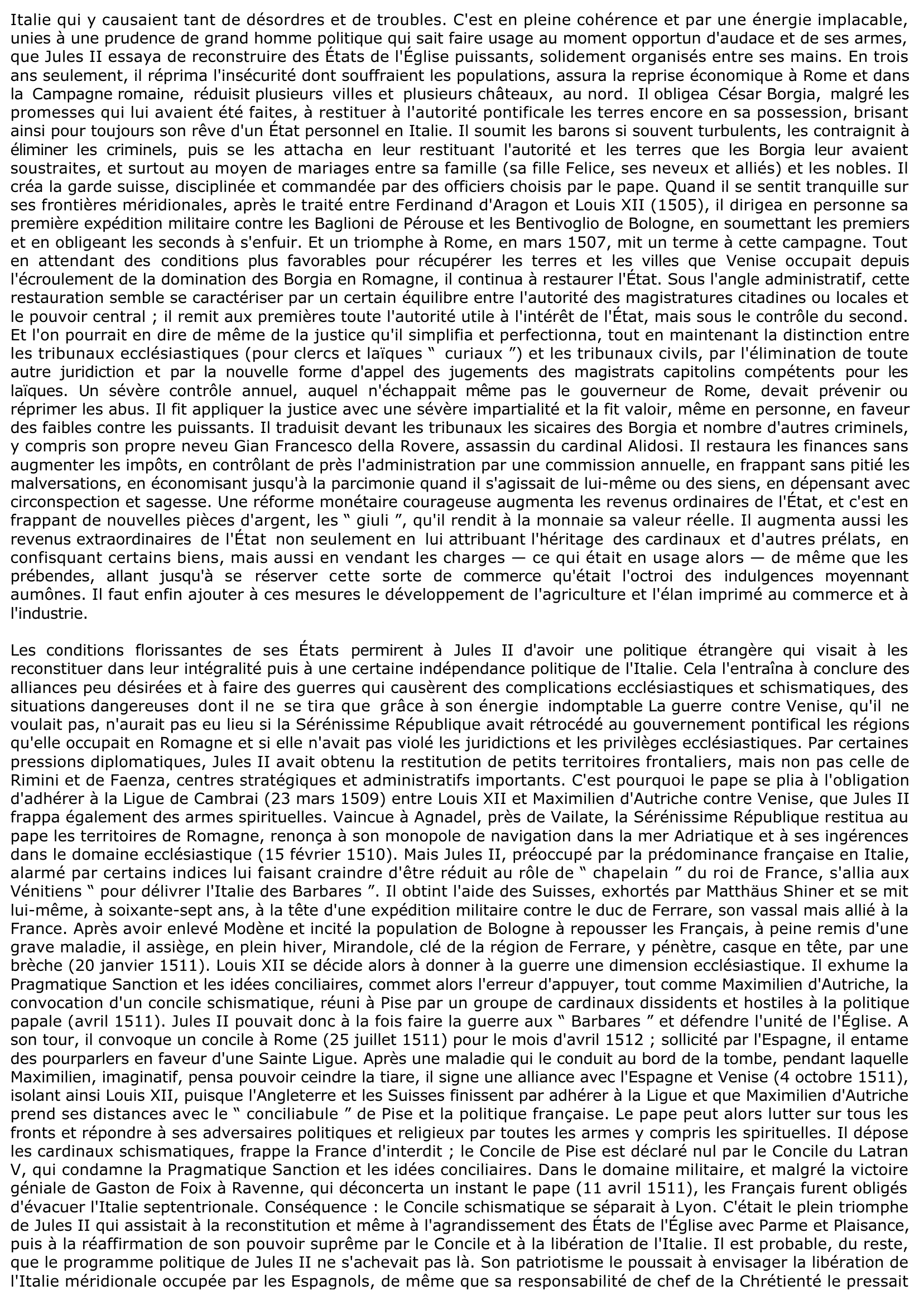Jules II
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
Italie qui y causaient tant de désordres et de troubles.
C'est en pleine cohérence et par une énergie implacable,unies à une prudence de grand homme politique qui sait faire usage au moment opportun d'audace et de ses armes,que Jules II essaya de reconstruire des États de l'Église puissants, solidement organisés entre ses mains.
En troisans seulement, il réprima l'insécurité dont souffraient les populations, assura la reprise économique à Rome et dansla Campagne romaine, réduisit plusieurs villes et plusieurs châteaux, au nord.
Il obligea César Borgia, malgré lespromesses qui lui avaient été faites, à restituer à l'autorité pontificale les terres encore en sa possession, brisantainsi pour toujours son rêve d'un État personnel en Italie.
Il soumit les barons si souvent turbulents, les contraignit àéliminer les criminels, puis se les attacha en leur restituant l'autorité et les terres que les Borgia leur avaientsoustraites, et surtout au moyen de mariages entre sa famille (sa fille Felice, ses neveux et alliés) et les nobles.
Ilcréa la garde suisse, disciplinée et commandée par des officiers choisis par le pape.
Quand il se sentit tranquille surses frontières méridionales, après le traité entre Ferdinand d'Aragon et Louis XII (1505), il dirigea en personne sapremière expédition militaire contre les Baglioni de Pérouse et les Bentivoglio de Bologne, en soumettant les premierset en obligeant les seconds à s'enfuir.
Et un triomphe à Rome, en mars 1507, mit un terme à cette campagne.
Touten attendant des conditions plus favorables pour récupérer les terres et les villes que Venise occupait depuisl'écroulement de la domination des Borgia en Romagne, il continua à restaurer l'État.
Sous l'angle administratif, cetterestauration semble se caractériser par un certain équilibre entre l'autorité des magistratures citadines ou locales etle pouvoir central ; il remit aux premières toute l'autorité utile à l'intérêt de l'État, mais sous le contrôle du second.Et l'on pourrait en dire de même de la justice qu'il simplifia et perfectionna, tout en maintenant la distinction entreles tribunaux ecclésiastiques (pour clercs et laïques “ curiaux ”) et les tribunaux civils, par l'élimination de touteautre juridiction et par la nouvelle forme d'appel des jugements des magistrats capitolins compétents pour leslaïques.
Un sévère contrôle annuel, auquel n'échappait même pas le gouverneur de Rome, devait prévenir ouréprimer les abus.
Il fit appliquer la justice avec une sévère impartialité et la fit valoir, même en personne, en faveurdes faibles contre les puissants.
Il traduisit devant les tribunaux les sicaires des Borgia et nombre d'autres criminels,y compris son propre neveu Gian Francesco della Rovere, assassin du cardinal Alidosi.
Il restaura les finances sansaugmenter les impôts, en contrôlant de près l'administration par une commission annuelle, en frappant sans pitié lesmalversations, en économisant jusqu'à la parcimonie quand il s'agissait de lui-même ou des siens, en dépensant aveccirconspection et sagesse.
Une réforme monétaire courageuse augmenta les revenus ordinaires de l'État, et c'est enfrappant de nouvelles pièces d'argent, les “ giuli ”, qu'il rendit à la monnaie sa valeur réelle.
Il augmenta aussi lesrevenus extraordinaires de l'État non seulement en lui attribuant l'héritage des cardinaux et d'autres prélats, enconfisquant certains biens, mais aussi en vendant les charges — ce qui était en usage alors — de même que lesprébendes, allant jusqu'à se réserver cette sorte de commerce qu'était l'octroi des indulgences moyennantaumônes.
Il faut enfin ajouter à ces mesures le développement de l'agriculture et l'élan imprimé au commerce et àl'industrie.
Les conditions florissantes de ses États permirent à Jules II d'avoir une politique étrangère qui visait à lesreconstituer dans leur intégralité puis à une certaine indépendance politique de l'Italie.
Cela l'entraîna à conclure desalliances peu désirées et à faire des guerres qui causèrent des complications ecclésiastiques et schismatiques, dessituations dangereuses dont il ne se tira que grâce à son énergie indomptable La guerre contre Venise, qu'il nevoulait pas, n'aurait pas eu lieu si la Sérénissime République avait rétrocédé au gouvernement pontifical les régionsqu'elle occupait en Romagne et si elle n'avait pas violé les juridictions et les privilèges ecclésiastiques.
Par certainespressions diplomatiques, Jules II avait obtenu la restitution de petits territoires frontaliers, mais non pas celle deRimini et de Faenza, centres stratégiques et administratifs importants.
C'est pourquoi le pape se plia à l'obligationd'adhérer à la Ligue de Cambrai (23 mars 1509) entre Louis XII et Maximilien d'Autriche contre Venise, que Jules IIfrappa également des armes spirituelles.
Vaincue à Agnadel, près de Vailate, la Sérénissime République restitua aupape les territoires de Romagne, renonça à son monopole de navigation dans la mer Adriatique et à ses ingérencesdans le domaine ecclésiastique (15 février 1510).
Mais Jules II, préoccupé par la prédominance française en Italie,alarmé par certains indices lui faisant craindre d'être réduit au rôle de “ chapelain ” du roi de France, s'allia auxVénitiens “ pour délivrer l'Italie des Barbares ”.
Il obtint l'aide des Suisses, exhortés par Matthäus Shiner et se mitlui-même, à soixante-sept ans, à la tête d'une expédition militaire contre le duc de Ferrare, son vassal mais allié à laFrance.
Après avoir enlevé Modène et incité la population de Bologne à repousser les Français, à peine remis d'unegrave maladie, il assiège, en plein hiver, Mirandole, clé de la région de Ferrare, y pénètre, casque en tête, par unebrèche (20 janvier 1511).
Louis XII se décide alors à donner à la guerre une dimension ecclésiastique.
Il exhume laPragmatique Sanction et les idées conciliaires, commet alors l'erreur d'appuyer, tout comme Maximilien d'Autriche, laconvocation d'un concile schismatique, réuni à Pise par un groupe de cardinaux dissidents et hostiles à la politiquepapale (avril 1511).
Jules II pouvait donc à la fois faire la guerre aux “ Barbares ” et défendre l'unité de l'Église.
Ason tour, il convoque un concile à Rome (25 juillet 1511) pour le mois d'avril 1512 ; sollicité par l'Espagne, il entamedes pourparlers en faveur d'une Sainte Ligue.
Après une maladie qui le conduit au bord de la tombe, pendant laquelleMaximilien, imaginatif, pensa pouvoir ceindre la tiare, il signe une alliance avec l'Espagne et Venise (4 octobre 1511),isolant ainsi Louis XII, puisque l'Angleterre et les Suisses finissent par adhérer à la Ligue et que Maximilien d'Autricheprend ses distances avec le “ conciliabule ” de Pise et la politique française.
Le pape peut alors lutter sur tous lesfronts et répondre à ses adversaires politiques et religieux par toutes les armes y compris les spirituelles.
Il déposeles cardinaux schismatiques, frappe la France d'interdit ; le Concile de Pise est déclaré nul par le Concile du LatranV, qui condamne la Pragmatique Sanction et les idées conciliaires.
Dans le domaine militaire, et malgré la victoiregéniale de Gaston de Foix à Ravenne, qui déconcerta un instant le pape (11 avril 1511), les Français furent obligésd'évacuer l'Italie septentrionale.
Conséquence : le Concile schismatique se séparait à Lyon.
C'était le plein triomphede Jules II qui assistait à la reconstitution et même à l'agrandissement des États de l'Église avec Parme et Plaisance,puis à la réaffirmation de son pouvoir suprême par le Concile et à la libération de l'Italie.
Il est probable, du reste,que le programme politique de Jules II ne s'achevait pas là.
Son patriotisme le poussait à envisager la libération del'Italie méridionale occupée par les Espagnols, de même que sa responsabilité de chef de la Chrétienté le pressait.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’influence de Jules Ferry sur le colonialisme français
- Exposé Jules Vallès , L'Enfant
- Commentaire d’un texte historique : L’industrie textile vue par Jules Michelet
- Voyage au centre de la Terre, de Jules Verne
- CHÂTEAU DES CARPATHES (le), de Jules Verne