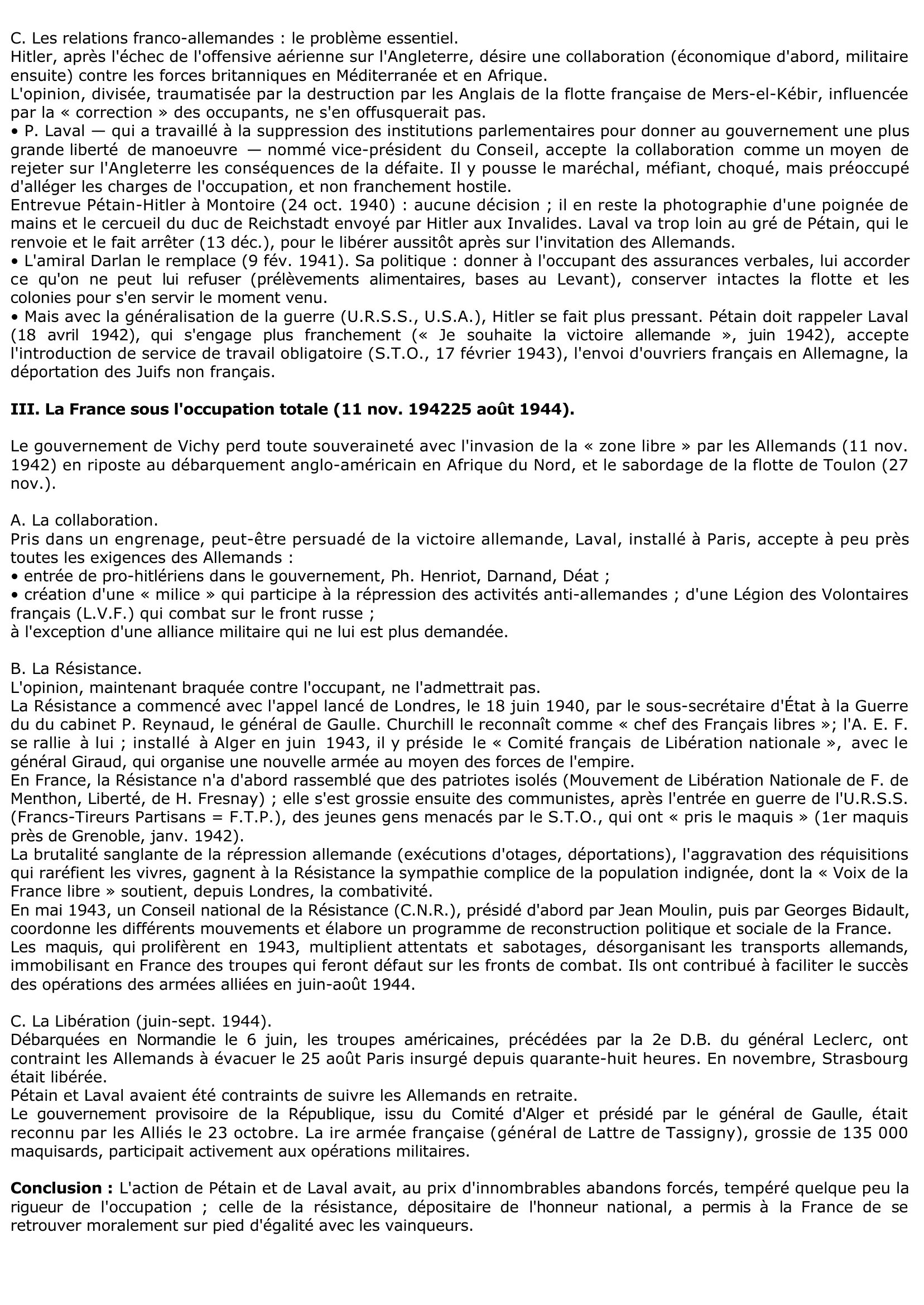LA FRANCE DANS LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
Publié le 22/02/2012

Extrait du document
«
C.
Les relations franco-allemandes : le problème essentiel.Hitler, après l'échec de l'offensive aérienne sur l'Angleterre, désire une collaboration (économique d'abord, militaireensuite) contre les forces britanniques en Méditerranée et en Afrique.L'opinion, divisée, traumatisée par la destruction par les Anglais de la flotte française de Mers-el-Kébir, influencéepar la « correction » des occupants, ne s'en offusquerait pas.• P.
Laval — qui a travaillé à la suppression des institutions parlementaires pour donner au gouvernement une plusgrande liberté de manoeuvre — nommé vice-président du Conseil, accepte la collaboration comme un moyen derejeter sur l'Angleterre les conséquences de la défaite.
Il y pousse le maréchal, méfiant, choqué, mais préoccupéd'alléger les charges de l'occupation, et non franchement hostile.Entrevue Pétain-Hitler à Montoire (24 oct.
1940) : aucune décision ; il en reste la photographie d'une poignée demains et le cercueil du duc de Reichstadt envoyé par Hitler aux Invalides.
Laval va trop loin au gré de Pétain, qui lerenvoie et le fait arrêter (13 déc.), pour le libérer aussitôt après sur l'invitation des Allemands.• L'amiral Darlan le remplace (9 fév.
1941).
Sa politique : donner à l'occupant des assurances verbales, lui accorderce qu'on ne peut lui refuser (prélèvements alimentaires, bases au Levant), conserver intactes la flotte et lescolonies pour s'en servir le moment venu.• Mais avec la généralisation de la guerre (U.R.S.S., U.S.A.), Hitler se fait plus pressant.
Pétain doit rappeler Laval(18 avril 1942), qui s'engage plus franchement (« Je souhaite la victoire allemande », juin 1942), acceptel'introduction de service de travail obligatoire (S.T.O., 17 février 1943), l'envoi d'ouvriers français en Allemagne, ladéportation des Juifs non français.
III.
La France sous l'occupation totale (11 nov.
194225 août 1944).
Le gouvernement de Vichy perd toute souveraineté avec l'invasion de la « zone libre » par les Allemands (11 nov.1942) en riposte au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, et le sabordage de la flotte de Toulon (27nov.).
A.
La collaboration.Pris dans un engrenage, peut-être persuadé de la victoire allemande, Laval, installé à Paris, accepte à peu prèstoutes les exigences des Allemands :• entrée de pro-hitlériens dans le gouvernement, Ph.
Henriot, Darnand, Déat ;• création d'une « milice » qui participe à la répression des activités anti-allemandes ; d'une Légion des Volontairesfrançais (L.V.F.) qui combat sur le front russe ;à l'exception d'une alliance militaire qui ne lui est plus demandée.
B.
La Résistance.L'opinion, maintenant braquée contre l'occupant, ne l'admettrait pas.La Résistance a commencé avec l'appel lancé de Londres, le 18 juin 1940, par le sous-secrétaire d'État à la Guerredu du cabinet P.
Reynaud, le général de Gaulle.
Churchill le reconnaît comme « chef des Français libres »; l'A.
E.
F.se rallie à lui ; installé à Alger en juin 1943, il y préside le « Comité français de Libération nationale », avec legénéral Giraud, qui organise une nouvelle armée au moyen des forces de l'empire.En France, la Résistance n'a d'abord rassemblé que des patriotes isolés (Mouvement de Libération Nationale de F.
deMenthon, Liberté, de H.
Fresnay) ; elle s'est grossie ensuite des communistes, après l'entrée en guerre de l'U.R.S.S.(Francs-Tireurs Partisans = F.T.P.), des jeunes gens menacés par le S.T.O., qui ont « pris le maquis » (1er maquisprès de Grenoble, janv.
1942).La brutalité sanglante de la répression allemande (exécutions d'otages, déportations), l'aggravation des réquisitionsqui raréfient les vivres, gagnent à la Résistance la sympathie complice de la population indignée, dont la « Voix de laFrance libre » soutient, depuis Londres, la combativité.En mai 1943, un Conseil national de la Résistance (C.N.R.), présidé d'abord par Jean Moulin, puis par Georges Bidault,coordonne les différents mouvements et élabore un programme de reconstruction politique et sociale de la France.Les maquis, qui prolifèrent en 1943, multiplient attentats et sabotages, désorganisant les transports allemands,immobilisant en France des troupes qui feront défaut sur les fronts de combat.
Ils ont contribué à faciliter le succèsdes opérations des armées alliées en juin-août 1944.
C.
La Libération (juin-sept.
1944).Débarquées en Normandie le 6 juin, les troupes américaines, précédées par la 2e D.B.
du général Leclerc, ontcontraint les Allemands à évacuer le 25 août Paris insurgé depuis quarante-huit heures.
En novembre, Strasbourgétait libérée.Pétain et Laval avaient été contraints de suivre les Allemands en retraite.Le gouvernement provisoire de la République, issu du Comité d'Alger et présidé par le général de Gaulle, étaitreconnu par les Alliés le 23 octobre.
La ire armée française (général de Lattre de Tassigny), grossie de 135 000maquisards, participait activement aux opérations militaires.
Conclusion : L'action de Pétain et de Laval avait, au prix d'innombrables abandons forcés, tempéré quelque peu la rigueur de l'occupation ; celle de la résistance, dépositaire de l'honneur national, a permis à la France de seretrouver moralement sur pied d'égalité avec les vainqueurs..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’historien et les mémoires des persécutions et du génocide juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France, depuis 1945
- Thème 1: Le rapport des sociétés à leur passé Chapitre 2 : L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France.
- La France sous la première guerre mondiale
- F êtes de la victoire, juillet 1919 Promu maréchal de France, Foch signe l' Armistice le 11novembre1918, qui met fin à la Première Guerre mondiale.
- Seconde Guerre mondiale france