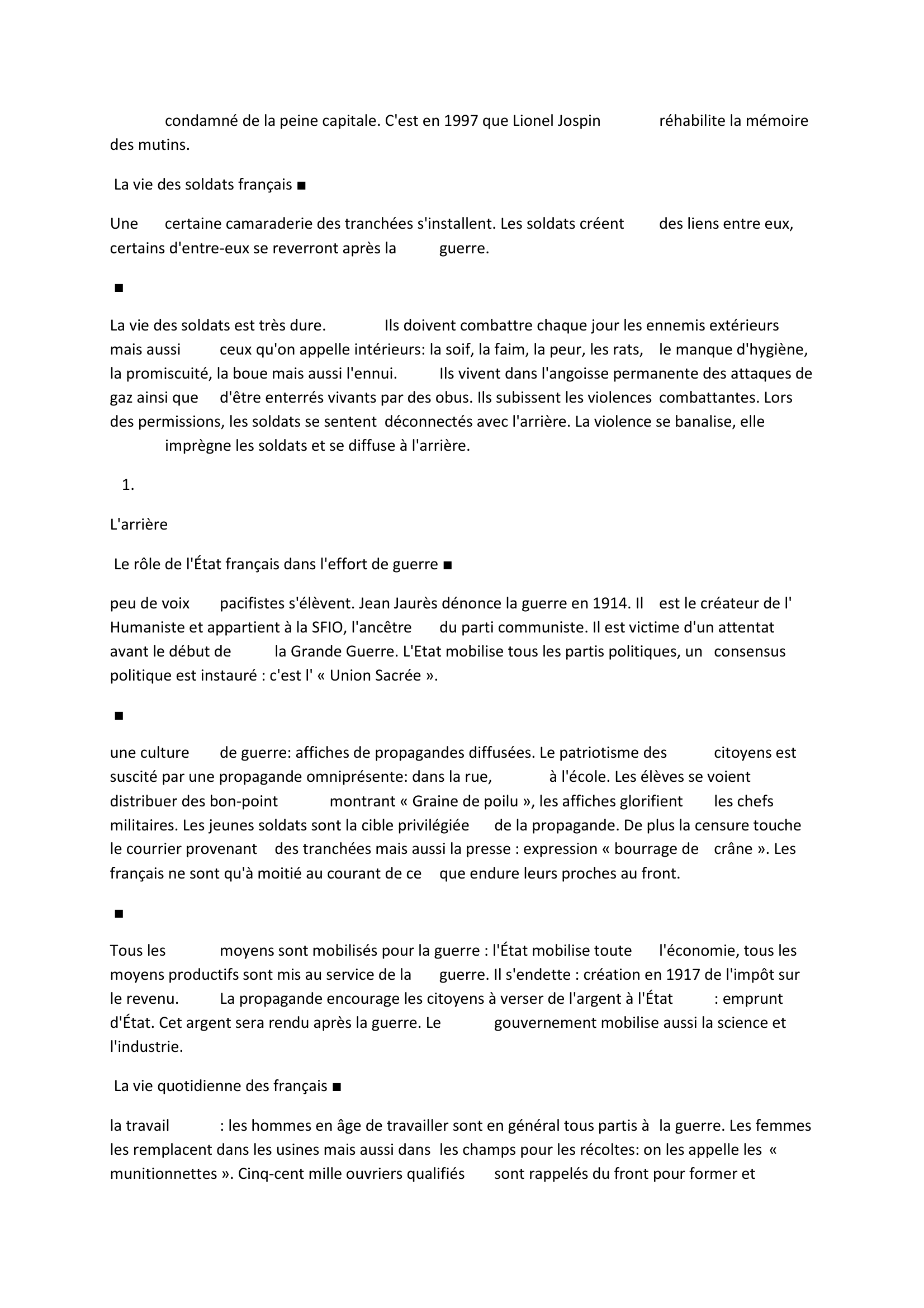La France et la Première Guerre Mondiale
Publié le 04/03/2012

Extrait du document
«
condamné de la peine capitale.
C'est en 1997 que Lionel Jospin réhabilite la mémoire
des mutins.
La vie des soldats français ■
Une certaine camaraderie des tranchées s'installent.
Les soldats créent des liens entre eux,
certains d'entre-eux se reverront après la guerre.
■
La vie des soldats est très dure.
Ils doivent combattre chaque jour les ennemis extérieurs
mais aussi ceux qu'on appelle intérieurs: la soif, la faim, la peur, les rats, le manque d'hygiène,
la promiscuité, la boue mais aussi l'ennui.
Ils vivent dans l'angoisse permanente des attaques de
gaz ainsi que d'être enterrés vivants par des obus.
Ils subissent les violences combattantes.
Lors
des permissions, les soldats se sentent déconnectés avec l'arrière.
La violence se banalise, elle
imprègne les soldats et se diffuse à l'arrière.
1.
L'arrière
Le rôle de l'État français dans l'effort de guerre ■
peu de voix pacifistes s'élèvent.
Jean Jaurès dénonce la guerre en 1914.
Il est le créateur de l'
Humaniste et appartient à la SFIO, l'ancêtre du parti communiste.
Il est victime d'un attentat
avant le début de la Grande Guerre.
L'Etat mobilise tous les partis politiques, un consensus
politique est instauré : c'est l' « Union Sacrée ».
■
une culture de guerre: affiches de propagandes diffusées.
Le patriotisme des citoyens est
suscité par une propagande omniprésente: dans la rue, à l'école.
Les élèves se voient
distribuer des bon-point montrant « Graine de poilu », les affiches glorifient les chefs
militaires.
Les jeunes soldats sont la cible privilégiée de la propagande.
De plus la censure touche
le courrier provenant des tranchées mais aussi la presse : expression « bourrage de crâne ».
Les
français ne sont qu'à moitié au courant de ce que endure leurs proches au front.
■
Tous les moyens sont mobilisés pour la guerre : l'État mobilise toute l'économie, tous les
moyens productifs sont mis au service de la guerre.
Il s'endette : création en 1917 de l'impôt sur
le revenu.
La propagande encourage les citoyens à verser de l'argent à l'État : emprunt
d'État.
Cet argent sera rendu après la guerre.
Le gouvernement mobilise aussi la science et
l'industrie.
La vie quotidienne des français ■
la travail : les hommes en âge de travailler sont en général tous partis à la guerre.
Les femmes
les remplacent dans les usines mais aussi dans les champs pour les récoltes: on les appelle les «
munitionnettes ».
Cinq-cent mille ouvriers qualifiés sont rappelés du front pour former et.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- L’historien et les mémoires des persécutions et du génocide juifs pendant la Seconde Guerre mondiale en France, depuis 1945
- Thème 1: Le rapport des sociétés à leur passé Chapitre 2 : L’historien et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale en France.
- La France sous la première guerre mondiale
- F êtes de la victoire, juillet 1919 Promu maréchal de France, Foch signe l' Armistice le 11novembre1918, qui met fin à la Première Guerre mondiale.
- Seconde Guerre mondiale france