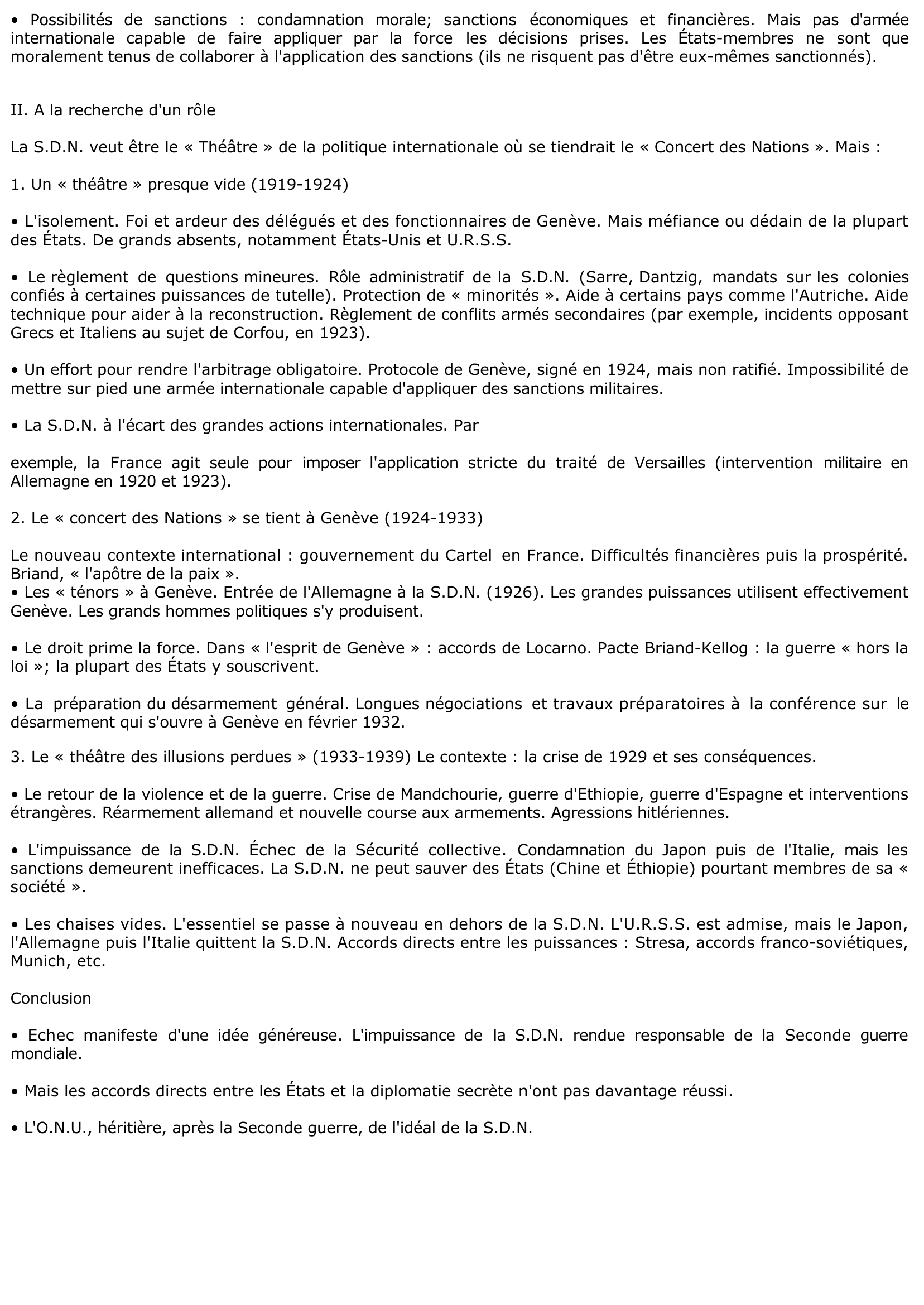La S.D.N.
Publié le 17/01/2022

Extrait du document
• Sujet de synthèse dont la brièveté de l'énoncé accentue encore la difficulté.
• Il faut tout d'abord bien comprendre que la création de la S.D.N. n'implique pas que les États, même ceux qui en font partie, daignent recourir à ses bons offices pour régler leurs différends ou que son autorité soit reconnue et ses décisions suivies d'effet. L'histoire de la S.D.N. est donc la tentative, finalement malheureuse, d'un organisme créé par des idéalistes pour jouer un rôle effectif dans les affaires internationales.
• La chronologie jointe à l'énoncé est loin d'être complète. Certains éléments qui y figurent visent seulement à évoquer l'absence de l'action de la S.D.N. dans leur déroulement (par exemple, la remilitarisation de la Rhénanie).
• Il ne faut surtout pas que le candidat confonde ce sujet avec l'étude des relations internationales entre 1919 et 1939.
«
• Possibilités de sanctions : condamnation morale; sanctions économiques et financières.
Mais pas d'arméeinternationale capable de faire appliquer par la force les décisions prises.
Les États-membres ne sont quemoralement tenus de collaborer à l'application des sanctions (ils ne risquent pas d'être eux-mêmes sanctionnés).
II.
A la recherche d'un rôle
La S.D.N.
veut être le « Théâtre » de la politique internationale où se tiendrait le « Concert des Nations ».
Mais :
1.
Un « théâtre » presque vide (1919-1924)
• L'isolement.
Foi et ardeur des délégués et des fonctionnaires de Genève.
Mais méfiance ou dédain de la plupartdes États.
De grands absents, notamment États-Unis et U.R.S.S.
• Le règlement de questions mineures.
Rôle administratif de la S.D.N.
(Sarre, Dantzig, mandats sur les coloniesconfiés à certaines puissances de tutelle).
Protection de « minorités ».
Aide à certains pays comme l'Autriche.
Aidetechnique pour aider à la reconstruction.
Règlement de conflits armés secondaires (par exemple, incidents opposantGrecs et Italiens au sujet de Corfou, en 1923).
• Un effort pour rendre l'arbitrage obligatoire.
Protocole de Genève, signé en 1924, mais non ratifié.
Impossibilité demettre sur pied une armée internationale capable d'appliquer des sanctions militaires.
• La S.D.N.
à l'écart des grandes actions internationales.
Par
exemple, la France agit seule pour imposer l'application stricte du traité de Versailles (intervention militaire enAllemagne en 1920 et 1923).
2.
Le « concert des Nations » se tient à Genève (1924-1933)
Le nouveau contexte international : gouvernement du Cartel en France.
Difficultés financières puis la prospérité.Briand, « l'apôtre de la paix ».• Les « ténors » à Genève.
Entrée de l'Allemagne à la S.D.N.
(1926).
Les grandes puissances utilisent effectivementGenève.
Les grands hommes politiques s'y produisent.
• Le droit prime la force.
Dans « l'esprit de Genève » : accords de Locarno.
Pacte Briand-Kellog : la guerre « hors laloi »; la plupart des États y souscrivent.
• La préparation du désarmement général.
Longues négociations et travaux préparatoires à la conférence sur ledésarmement qui s'ouvre à Genève en février 1932.
3.
Le « théâtre des illusions perdues » (1933-1939) Le contexte : la crise de 1929 et ses conséquences.
• Le retour de la violence et de la guerre.
Crise de Mandchourie, guerre d'Ethiopie, guerre d'Espagne et interventionsétrangères.
Réarmement allemand et nouvelle course aux armements.
Agressions hitlériennes.
• L'impuissance de la S.D.N.
Échec de la Sécurité collective.
Condamnation du Japon puis de l'Italie, mais lessanctions demeurent inefficaces.
La S.D.N.
ne peut sauver des États (Chine et Éthiopie) pourtant membres de sa «société ».
• Les chaises vides.
L'essentiel se passe à nouveau en dehors de la S.D.N.
L'U.R.S.S.
est admise, mais le Japon,l'Allemagne puis l'Italie quittent la S.D.N.
Accords directs entre les puissances : Stresa, accords franco-soviétiques,Munich, etc.
Conclusion
• Echec manifeste d'une idée généreuse.
L'impuissance de la S.D.N.
rendue responsable de la Seconde guerremondiale.
• Mais les accords directs entre les États et la diplomatie secrète n'ont pas davantage réussi.
• L'O.N.U., héritière, après la Seconde guerre, de l'idéal de la S.D.N..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓