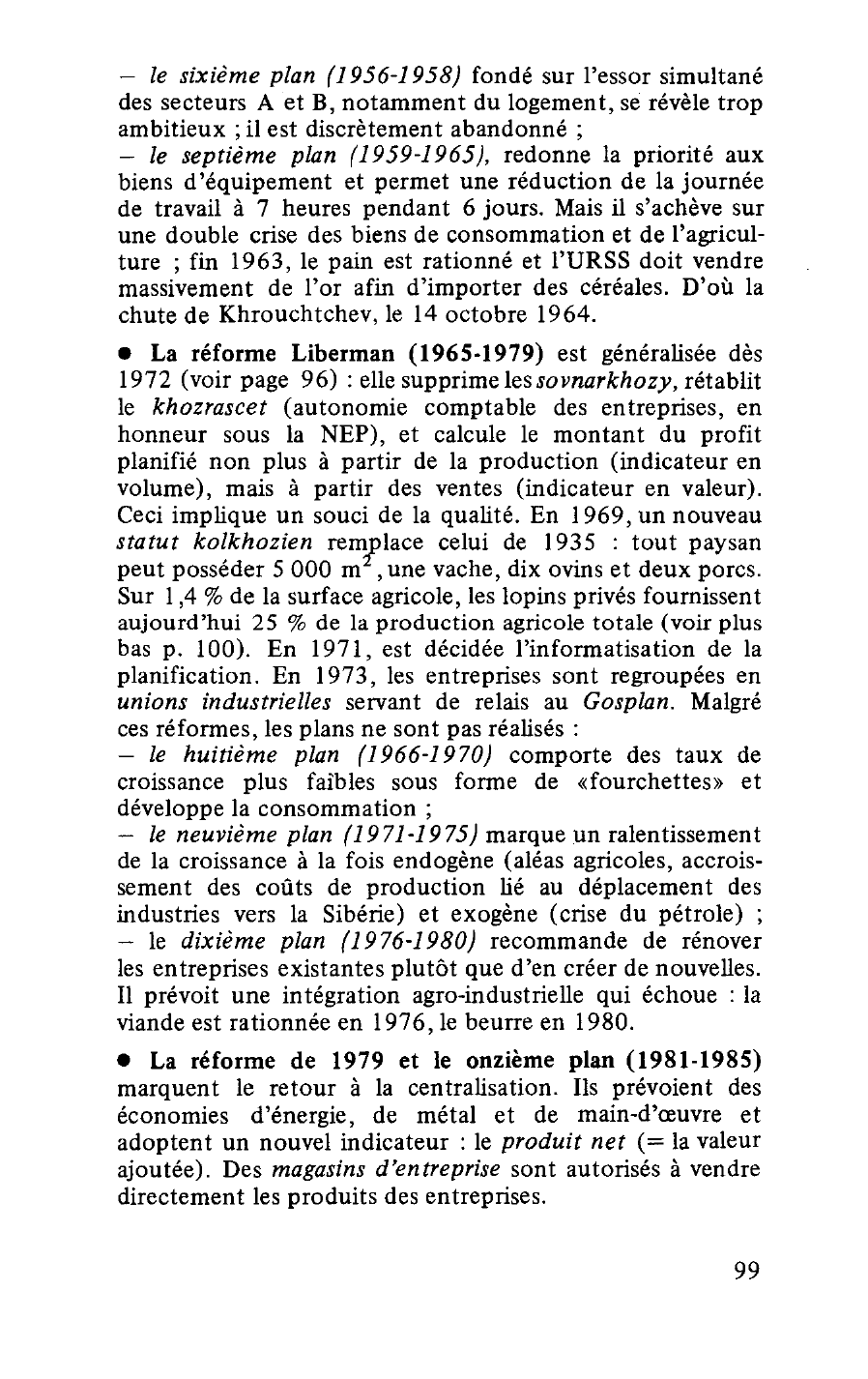L'ÉCONOMIE SOVIÉTIQUE DEPUIS 1945
Publié le 09/09/2014

Extrait du document
Les pertes de la seconde guerre mondiale ont exigé un vigoureux effort de reconstruction. Après la mort de Staline (1953), les dirigeants s'efforcent d'améliorer le fonction¬nement de l'économie.
1. La fin de l'ère stalinienne (1945-1953).
• Le passif de la guerre est lourd : 25 millions de morts, chute des productions de charbon (2/3), de fer (3/4), de pétrole (1/6) et de céréales (50 %). Les mauvaises récoltes de 1945 et 1946 provoquent des famines locales. La surface urbaine à reconstruire représente vingt fois celle de Paris. Démunis de tout, les Soviétiques opèrent des prélèvements (matières premières, démontages d'usines) dans les pays d'Europe centrale récemment devenus socialistes.
«
- le sixième plan (J 956-1958) fondé sur l'essor simultané
des secteurs A et B, notamment du logement, se révèle trop ambitieux ; il est discrètement abandonné ; - le septième plan (1959-1965), redonne la priorité aux
biens d'équipement et permet une réduction de la journée de travail à 7 heures pendant 6 jours.
Mais il s'achève sur
une double crise des biens de consommation et de l'agricul
ture ; fin 1963, le pain est rationné et l'URSS
doit vendre
massivement de
l'or afin d'importer des céréales.
D'où la
chute de Khrouchtchev, le 14 octobre 1964.
• La réforme Liberman (1965-1979) est généralisée dès
1972 (voir page 96): elle supprimelessovnarkhozy, rétablit
le khozrascet (autonomie comptable des entreprises, en
honneur sous la NEP), et calcule le montant du profit
planifié
non plus à partir de la production (indicateur en
volume), mais
à partir des ventes (indicateur en valeur).
Ceci implique
un souci de la qualité.
En 1969, un nouveau statut kolkhozien remplace celui de 1935 : tout paysan
peut posséder 5 000 m , une vache, dix ovins et deux porcs.
Sur 1,4
% de la surface agricole, les lopins privés fournissent
aujourd'hui 25 % de la production agricole totale (voir plus
bas p.
100).
En 1971, est décidée l'informatisation de la
planification.
En 1973, les entreprises sont regroupées en unions industrielles servant de relais au Gosplan.
Malgré
ces réformes, les plans ne
sont pas réalisés : - le huitième plan ( 1966-19 70) comporte des taux de
croissance plus faibles sous forme de
«fourchettes» et développe la consommation ; - le neuvième plan (J 9 71-1975) marque un ralentissement de la croissance à la fois endogène (aléas agricoles, accrois
sement des coûts de
production lié au déplacement des
industries vers la Sibérie) et exogène (crise du pétrole) ;
-
le dixième plan (J 9 76-1980) recommande de rénover
les entreprises existantes plutôt que d'en créer de nouvelles.
Il prévoit une intégration agro-industrielle qui échoue : la
viande est rationnée en 1976,
le beurre en 1980.
•
La réforme de 1979 et le onzième plan (1981-1985)
marquent le
retour à la centralisation.
Ils prévoient des
économies d'énergie, de métal
et de main-d'œuvre et
adoptent un nouvel indicateur : le produit net (=la valeur
ajoutée).
Des magasins d'entreprise sont autorisés à vendre
directement les produits des entreprises.
99.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Tolstoï Alekseï Nikolaïevitch , 1883-1945, né à Nikolaïevsk, écrivain soviétique.
- Saneïev Viktor Danilovitch , né en 1945 à Soukhoumi (Géorgie), athlète soviétique.
- Évoquant les régions sibériennes, un économiste soviétique a écrit : « Leur mise en valeur s'impose comme le fait essentiel du développement économique de l'U.R.S.S.». Le rôle de la Sibérie dans l'économie soviétique vous paraît-elle confirmer cette opinion ?
- Modèle soviétique et modèle américain de 1945 à 1991
- Ancien pays du bloc de l'Est, en opposition dès les années 80 avec le pouvoir soviétique, la Pologne passe en 1990 à l'économie de marché.