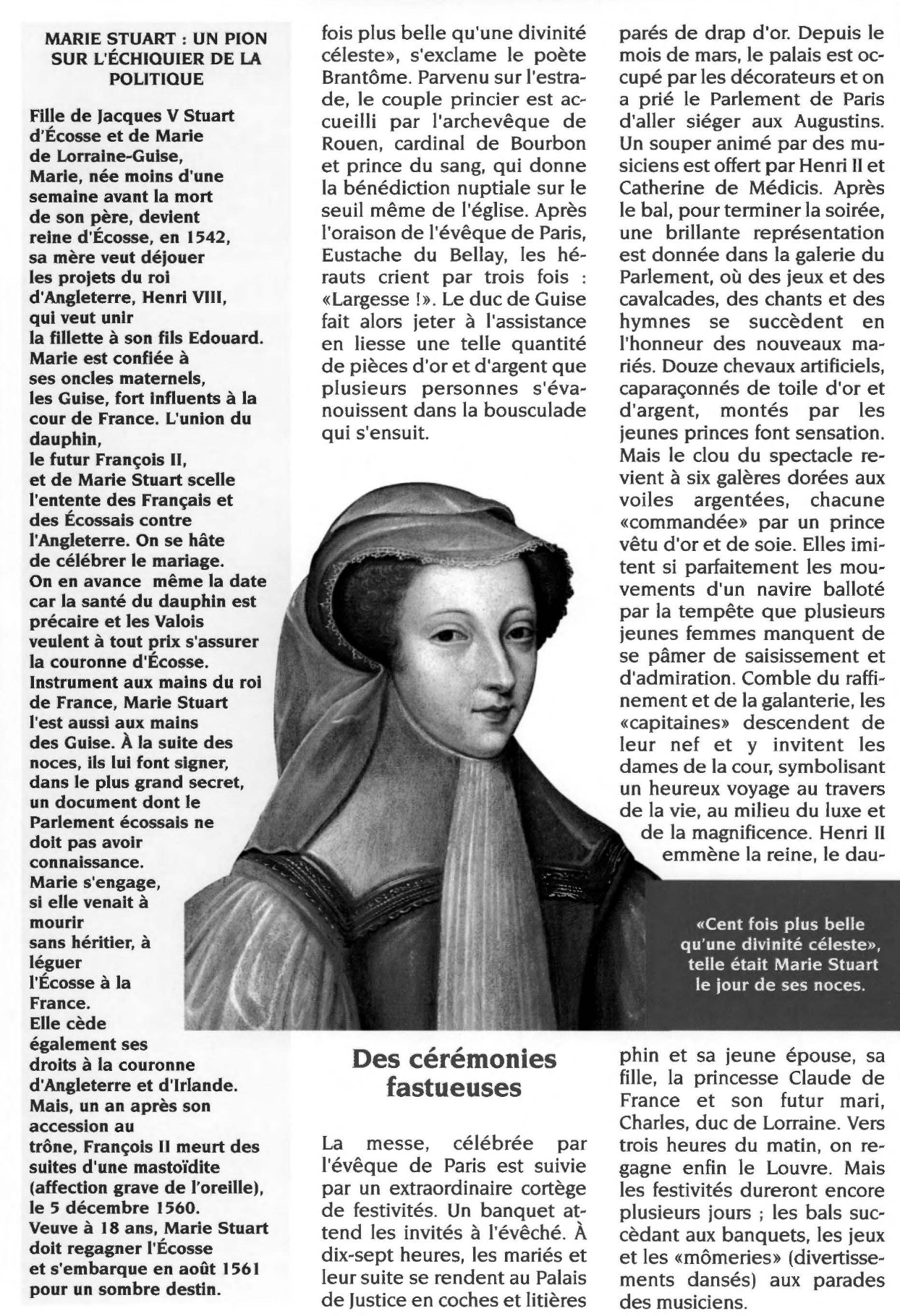Les noces de François II et de Marie Stuart
Publié le 31/03/2013

Extrait du document
La messe, célébrée par l'évêque de Paris est suivie par un extraordinaire cortège de festivités. Un banquet attend les invités à l'évêché. À dix-sept heures, les mariés et leur suite se rendent au Palais de Justice en coches et litières...
«
MARIE STUART : UN PION
SUR L'ÉCHIQUIER DE LA
POLITIQUE
Fille de Jacques V Stuart
d'Écosse et de Marie de Lorraine~Guise,
Marie, née moins d'une
semaine avant la mort
de son père, devient
reine d'Écosse, en 1542,
sa mère veut déjouer les projets du roi
d'Angleterre, Henri
VIII,
qui veut unir
la fillette
à son fils Edouard.
Marie
est confiée à
ses oncles maternels,
les Guise, fort influents à la
cour de France.
L'union du
dauphin,
le futur François Il,
et de Marie Stuart scelle
l'entente des Français et des Écossais contre
l'Angleterre.
On se hâte
de célébrer le mariage.
On en avance même la date
car la santé du dauphin est
précaire et les Valois
veulent à tout prix s'assurer
la couronne d'Écosse.
Instrument
aux mains du roi de France, Marie Stuart
l'est aussi aux mains
des Guise.
À la suite des noces, ils lui font signer, dans le plus grand secret,
un document dont le
Parlement écossais ne doit pas avoir
connaissance.
Marie
s'engage,
si elle venait à
mourir sans héritier, à
léguer
l'Écosse à la
France.
Elle
cède
également ses
droits à la couronne
d'Angleterre et d'Irlande.
Mais, un
an après son
accession au
trône, François
Il meurt des
suites d'une mastoïdite
(affection grave
de l'oreille),
le 5
décembre 1560.
Veuve à 18 ans, Marie Stuart
doit regagner l'Écosse
et s'embarque en août 1561
pour un sombre destin.
fois plus belle qu'une divinité
céleste», s'exclame le poète
Brantôme.
Parvenu sur l'estra~
de, le couple princier est ac~
cueilli par l'archevêque de
Rouen, cardinal de Bourbon
et prince du sang, qui donne
la bénédiction nuptiale sur le
seuil même de l'église.
Après
l'oraison
de l'évêque de Paris,
Eustache du Bellay, les hé
rauts crient par trois fois :
«Largesse!».
Le duc de Guise
fait alors
jeter à l'assistance
en liesse une
telle quantité
de pièces d'or et d'argent que
plusieurs personnes s'éva~
nouissent dans la bousculade
qui s'ensuit.
Des cérémonies
fastueuses
La messe, célébrée par
l'évêque de Paris est suivie
par un extraordinaire cortège
de festivités.
Un banquet at
tend les invités à l'évêché.
À
dix-sept heures, les mariés et
leur suite se rendent au Palais
de Justice en coches et litières parés
de drap d'or.
Depuis le
mois de mars, le palais
est oc
cupé par les décorateurs et on
a
prié le Parlement de Paris
d'aller siéger aux Augustins.
Un souper animé par des mu
siciens est offert par Henri II et
Catherine de Médicis.
Après
le bal, pour terminer la soirée,
une
brillante représentation
est donnée dans la galerie du
Parlement, où des jeux et des
cavalcades, des chants et des
hymnes se succèdent en
l'honneur des nouveaux ma
riés.
Douze chevaux artificiels,
caparaçonnés
de toile d'or et
d'argent, montés par les
jeunes princes
font sensation.
Mais
le clou du spectacle re
vient à six galères dorées aux
voiles argentées, chacune
«commandée» par un prince
vêtu d'or et de soie.
Elles imi
tent si parfaitement les mou
vements d'un navire balloté
par la tempête que plusieurs
jeunes femmes
manquent de
se pâmer de saisissement et
d'admiration.
Comble du raffi
nement et de la galanterie, les
«capitaines» descendent de
leur nef et y invitent les
dames de la cour, symbolisant
un heureux voyage au travers
de la vie, au milieu du luxe et
de la magnificence.
Henri Il
emmène la reine, le dau-
phin et sa jeune épouse, sa
fille, la princesse Claude de
France et son futur mari,
Charles, duc de Lorraine .
Vers
trois heures
du matin, on re
gagne enfin le Louvre.
Mais
les festivités
dureront encore
plusieurs jours ; les bals
suc
cèdant aux banquets, les jeux
et les «mômeries» (divertisse
ments dansés) aux parades
des musiciens ..
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Les noces de François II et de Marie Stuart
- ANDELOT, François de Coligny, seigneur d' (1521-1569) Frère de l'amiral Gaspard de Coligny, il est envoyé en Ecosse pour y aller chercher la jeune Marie Stuart.
- FRANÇOIS II (1544-1560) Fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, marié en 1558 à Marie Stuart, il monte sur le trône en 1559, à la mort de son père.
- ANDELOT, François de Coligny, seigneur d' (1521-1569) Frère de l'amiral Gaspard de Coligny, il est envoyé en Ecosse pour y aller chercher la jeune Marie Stuart.
- FRANÇOIS II (1544-1560) Fils aîné d'Henri II et de Catherine de Médicis, marié en 1558 à Marie Stuart, il monte sur le trône en 1559, à la mort de son père.