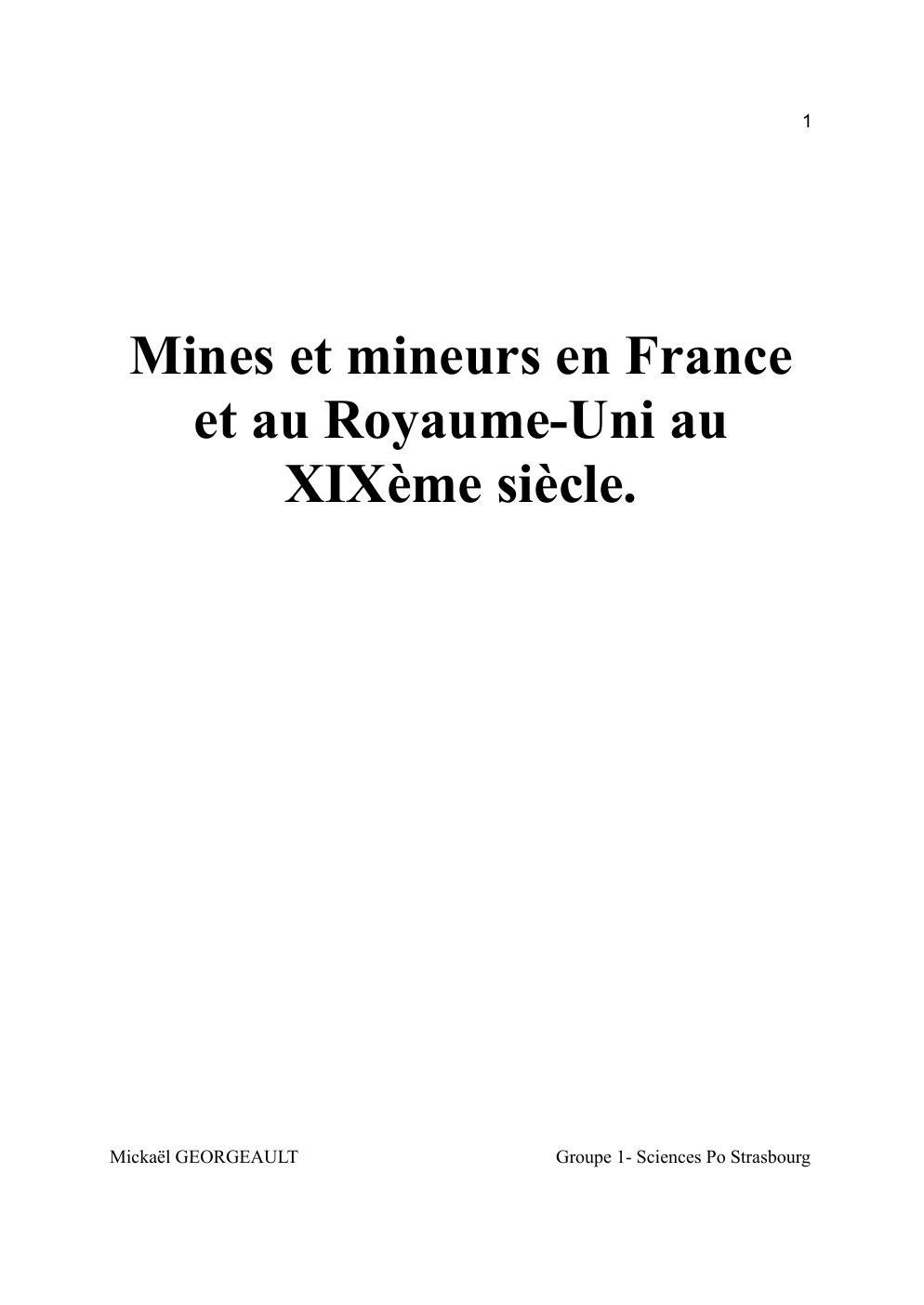Mines et mineurs en France et au Royaume-Uni au XIXème siècle.
Publié le 08/10/2025
Extrait du document
«
1
Mines et mineurs en France
et au Royaume-Uni au
XIXème siècle.
Mickaël GEORGEAULT
Groupe 1- Sciences Po Strasbourg
2
Sommaire :
Introduction
3
I- L’industrie minière au fondement de l’industrialisation des sociétés
franco-britanniques
A- Le charbon et le fer, trésors du XIXème siècle
B- Les mines, au centre de la toile industrielle des états et de son développement
C- Les conséquences démographiques de l’exploitation minière
5
5
6
7
II- le secteur minier comme vecteur des conflits sociaux au XIXème
A- Les mineurs dans la mine
B- L’émergence de conflits sociaux dans les mines
C- Un bilan mitigé
9
9
11
12
Conclusion
13
Annexes
15
Bibliographie
18
3
Introduction
1851, Londres reçoit la première exposition universelle, qui se veut la vitrine des
cultures et sociétés du monde occidental.
Mise à l’honneur en sa qualité d’hôte, la Grande
Bretagne s’est arrogé l’entrée du monumental Crystal Palace et l’entièreté de son aile ouest où
trône une statue de Richard Cœur de Lion, « symbole de la grandeur britannique ».
Celle-ci
partage pourtant la scène avec un bloc noir de 24 tonnes : du charbon1.
Ceci montre
l’importance croissante accordée à ce matériau et, plus généralement, à l’industrie minière
dans un contexte d’industrialisation au cours du XIXème siècle en Europe notamment au
Royaume-Uni et chez sa voisine immédiate : la France.
Une mine correspond à un terrain
d’où l’on peut extraire des minerais, dont par exemple le charbon, la houille, ou le fer.
Elle
peut être à ciel ouvert, généralement lorsque le minerai se trouve relativement proche de la
surface, ou bien souterraine, lorsque la quantité de mort-terrain à enlever est trop importante
et donc trop coûteuses.
En France et au Royaume Uni, durant les années 1800, la plupart des
mines de charbon étaient souterraines et donc composées de rampes d’accès, de galeries, de
1
Jarrige (F.) (sous la direction de P.
SINGARAVELOU et S.
VENAYRE), « Charbon », Histoire du
Monde au XIXè siècle, Paris, Fayard, 2017, p.
439
4
puits d'accès et de puits d'aération2.
Les mineurs quant à eux, du fait du rôle primordial du
secteur minier dans l’industrialisation européenne, forment au XIXème siècle une des
composantes les plus importantes du groupe ouvrier.
Un groupe par ailleurs composé à la fois
d’hommes et femmes et d’enfants.
La houille, ou charbon de terre, est utilisée depuis le
Moyen Âge, par exemple dans le Boulonnais où elle affleure.
À partir du XVIe siècle, on en
découvre en France dans de multiples lieux, et elle prend peu à peu la place du charbon de
bois.
En effet, celui-ci nécessite une combustion de bois et, de facto, l’exploitation des
ressources sylvicoles ce qui conduit à des défrichements massifs sur le continent, faisant
grimper le prix du bois, et jusqu’à une pénurie en Grande Bretagne, vers la fin du XVIIIème,
forçant l’île à importer depuis les pays scandinaves.
C’est donc naturellement que le charbon,
d’abord venu d’Angleterre, remplace peu à peu le bois.
Couplée à la mécanisation des
processus de production et à l’invention de la machine à vapeur en 1763, l’augmentation de la
demande pour ce charbon de terre et pour les métaux vulgaires tels que le fer ou l’étain
représente du pain béni pour l’industrie minière qui voit son marché s’étendre et se développe,
en réponse, à une vitesse fulgurante pour répondre aux besoins de cette industrialisation qui
ne dit pas encore son nom.
A la fois nourrie par et alimentant cette dernière, l’extraction va
provoquer de profondes évolutions, sociales, économiques et démographiques, dans les pays
d’Europe en particulier au Royaume Uni et en France où l’on assiste à une véritable
restructuration du système de production autour des mines.
Pourtant, ces évolutions ne se font
pas paisiblement : les mines et leurs promesses attirent à elles une nouvelle main d’œuvre qui,
concentrée sur des espaces réduits, constate de profondes inégalités, étincelles si propices à la
résurgence de conflits que l’on croyait enterrés avec la révolution française.
Dès lors,
pourquoi, malgré le développement économique qu’elle a engendré en France et au Royaume
Uni, l’industrie minière a-t-elle également provoqué l’émergence de conflits sociaux au cours
du XIXème siècle ? Si l’industrie minière se trouve au fondement de l’industrialisation des
sociétés franco -britanniques, ayant notamment engendré une amélioration du niveau de vie,
le secteur minier s’affirme cependant comme un véritable vecteur de conflits sociaux.
2
« Types de Mines » [en ligne], Comité sectoriel de main d’œuvre de l’industrie des mines,
https://www.explorelesmines.com/fr/secteur-minier/types-de-mines.html#:~:text=Il%20existe%20des%
20mines%20%C3%A0,une%20mine%20%C3%A0%20ciel%20ouvert.
, consulté le 2 février
5
I- L’industrie minière au fondement de l’industrialisation
des sociétés franco-britanniques
Le XIXème siècle marque l’entrée de l’Europe dans l’ère industrielle sous la conduite
du Royaume-Uni, véritable précurseur, dès la fin du XVIIIème.
Mue par le machinisme, les
ressources minières prennent, ipso facto, une dimension capitale jusqu’à en devenir
l’instigateur principal, nourrissant à la fois l’expansion des activités et des échanges mais
modifiant également jusqu’aux trames sociales et démographiques des États.
L’étude de ces
phénomènes révèle, en filigrane, sur toutes les innovations majeures de l’industrialisation des
sociétés françaises et britanniques la marque et l’influence de l’industrie minière.
A- Le charbon et le fer, trésors du XIXème siècle
Au Royaume uni comme en France, l’extraction minière a pour but d’arracher au sol
le combustible hautement riche en carbone qu’est le charbon de terre (ou houille) et le minerai
de fer.
Ces matériaux sont, en effet, les composantes principales de la révolution industrielle.
La houille, préférée au charbon de bois pour sa combustion plus lente et plus calorifère, sert
notamment de combustible avec la généralisation de la machine à vapeur à la fois dans
l’industrie et les transports mais également dans l’industrie métallurgique, pour fondre les
métaux.
De plus, charbon et fer entrent tous deux dans la production de l’alliage d’acier et de
fonte, matériaux idéaux de part leur résistance supérieure à celle que le fer brut, plus
malléable, ne présente pas à l’état pur3.
Cependant, c’est la houille qui représente le véritable
trésor du XIXème.
Outre-Manche, l’industrie minière se concentre surtout dans les régions du Pays de
Galles, du Yorkshire et, dans une moindre mesure, de l’Écosse4 qui profitent donc d’un
sous-sol riche et d’une industrialisation rapide (autour de Manchester notamment).
En France,
dans les années 1860, le Nord pas de Calais dépasse la production du Sud-Est, portée par les
gisements de la Loire, l’un des premier exploité (responsable de 54 % de la production
nationale en 1850)5.
3
4
5
Cours de Sciences des Matériaux de l'école des Mines d'Albi, « Au cœur des matériaux
cristallins », licence.
Redman Mitchel (B.), Economic development of the British coal industry,
1800-1914.
Royaume-Uni, Cambridge University Press, 1984.
Couriot l'album, Musée de la mine de Saint-Étienne, publication ville de Saint-Étienne, 2002,
(ISBN 2-9518970-0-6) p.
17
6
Véritable sang noir de l’industrie, le charbon est un des matériaux les plus importants
de la période et concentre autour de son exploitation des efforts colossaux : En Grande
Bretagne la production augmente de 500 % entre 1750 et 1830 et, en 1864, le pays représente
plus de la moitié de la production mondiale avec environ 100 millions de tonnes extraites
chaque année sur l’île6.
À titre de comparaison la France, ne produit en 1864 que 11 millions
de tonnes de houille et doit en importer un grande partie (depuis des pays comme l’Angleterre
justement), conséquence de son éveil tardif à l’importance du charbon (comme le reste du
continent, vers les années 1840) et à un sous-sol moins riche que celui de son voisin insulaire.
Elle parvient cependant à doubler sa production en 10 ans de 1854 (6 millions de tonnes) à
18647, montrant ainsi le début de la révolution industrielle dans l’hexagone, certes plus lente
mais qui n’empêche pas un essor des activités d’exploitation minière au même titre que celle
de la Prusse dans la Ruhr à la même époque, nécessaire à la réussite du pari industriel dans
lequel s’engage l’Europe.
B- Les mines, au centre de la toile industrielle des états et de son
développement
Ingénieur et explorateur français, Louis Simonin écrivait en 1867 à propos du charbon
de terre :
C’est un aliment aujourd’hui indispensable à la vie des nations civilisées, et chacun
prévoit tous les troubles qui surviendraient [...], si la houille manquait tout à coup.
Plus de
lumière dans les villes, plus de feu dans les usines et dans la plupart des maisons, tous les
chemins de fer arrêtés.
Les fabriques, les manufactures, presque tous les ateliers, presque
toutes les machines, bon nombre de navires, privés de l’aliment essentiel, se verraient
aussi condamnés au repos.8
Il esquisse par là l’importance du charbon dans la société du XIXème qui débute à la fois dans
la fabrication et le fonctionnement de machines, censées accélérer la production.
Les mines
sont donc, ainsi que les petites mains qui y travaillent, à l’origine de l’industrialisation des
sociétés qui s’accompagnent de profondes mutations économiques en particulier celle....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Islande Reykjavik Finlande Finlande Suède Suède Norvège Fédération de Russie Helsinki Stockholm Oslo Tallinn Estonie Moscou Riga Lettonie Lituanie Danemark Vilnius Copenhague Dublin Irlande Russie Biélorussie Royaume-Uni Londres Minsk Amsterdam Pays-Bas Kiev Varsovie Berlin Allemagne Pologne Ukraine Bruxelles Belgique Paris G-D Luxembourg Luxembourg Prague Rép. Tchèque Slovaquie France Liechtenstein Suisse Vaduz Berne Saint-Marin Saint-Marin Monaco M
- Le XIXème siècle LES DIFFICULTÉS DE LA RÉPUBLIQUE A S'IMPOSER EN FRANCE La construction de la République est, en France, une aventure longue et tumultueuse.
- Le XIXème siècle LES DIFFICULTÉS DE LA RÉPUBLIQUE A S'IMPOSER EN FRANCE La construction de la République est une aventure longue : de 1815 à 1914, la France connaît une succession de régimes politiques qui sont, chacun à leur manière, 1 étape dans la conquête des libertés.
- Cette idée ancrée depuis des siècles dans les esprits selon laquelle la France serait au XVIème siècle un royaume dangereux.
- MOLAY, Jacques de (vers 1243-19 mars 1314) Grand maître de l'ordre des Templiers Lorsque Jacques de Molay devient grand maître de l'ordre des Templiers, celui-ci est depuis plus d'un siècle le plus riche qu'il y ait dans le royaume de France.