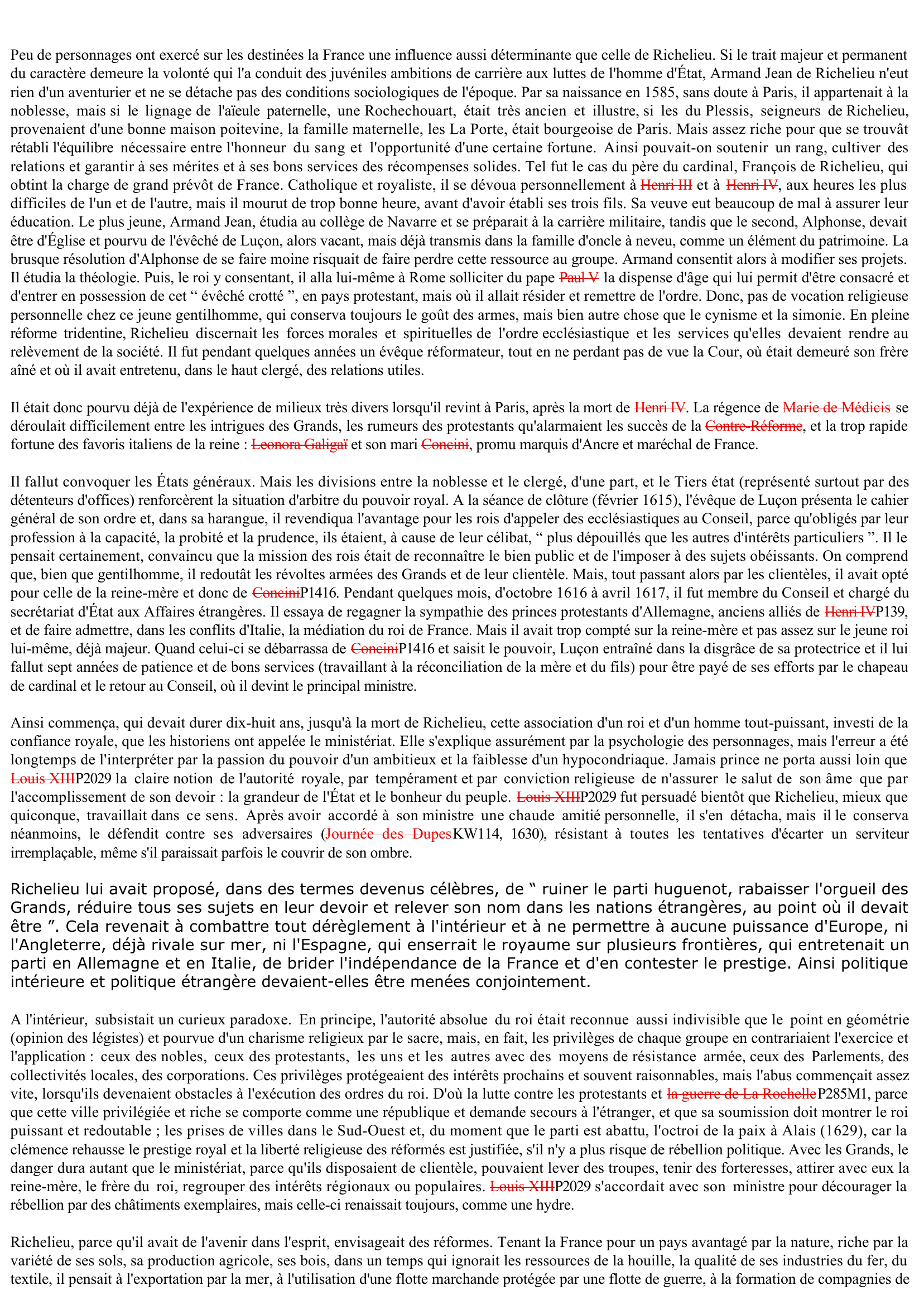Richelieu
Publié le 27/02/2008

Extrait du document


«
Peu de personnages ont exercé sur les destinées la France une influence aussi déterminante que celle de Richelieu.
Si le trait majeur et permanent du caractère demeure la volonté qui l'a conduit des juvéniles ambitions de carrière aux luttes de l'homme d'État, Armand Jean de Richelieu n'eutrien d'un aventurier et ne se détache pas des conditions sociologiques de l'époque.
Par sa naissance en 1585, sans doute à Paris, il appartenait à lanoblesse, mais si le lignage de l'aïeule paternelle, une Rochechouart, était très ancien et illustre, si les du Plessis, seigneurs de Richelieu,provenaient d'une bonne maison poitevine, la famille maternelle, les La Porte, était bourgeoise de Paris.
Mais assez riche pour que se trouvâtrétabli l'équilibre nécessaire entre l'honneur du sang et l'opportunité d'une certaine fortune.
Ainsi pouvait-on soutenir un rang, cultiver desrelations et garantir à ses mérites et à ses bons services des récompenses solides.
Tel fut le cas du père du cardinal, François de Richelieu, quiobtint la charge de grand prévôt de France.
Catholique et royaliste, il se dévoua personnellement à Henri III et à Henri IV , aux heures les plus difficiles de l'un et de l'autre, mais il mourut de trop bonne heure, avant d'avoir établi ses trois fils.
Sa veuve eut beaucoup de mal à assurer leuréducation.
Le plus jeune, Armand Jean, étudia au collège de Navarre et se préparait à la carrière militaire, tandis que le second, Alphonse, devaitêtre d'Église et pourvu de l'évêché de Luçon, alors vacant, mais déjà transmis dans la famille d'oncle à neveu, comme un élément du patrimoine.
Labrusque résolution d'Alphonse de se faire moine risquait de faire perdre cette ressource au groupe.
Armand consentit alors à modifier ses projets.Il étudia la théologie.
Puis, le roi y consentant, il alla lui-même à Rome solliciter du pape Paul V la dispense d'âge qui lui permit d'être consacré et d'entrer en possession de cet “ évêché crotté ”, en pays protestant, mais où il allait résider et remettre de l'ordre.
Donc, pas de vocation religieusepersonnelle chez ce jeune gentilhomme, qui conserva toujours le goût des armes, mais bien autre chose que le cynisme et la simonie.
En pleineréforme tridentine, Richelieu discernait les forces morales et spirituelles de l'ordre ecclésiastique et les services qu'elles devaient rendre aurelèvement de la société.
Il fut pendant quelques années un évêque réformateur, tout en ne perdant pas de vue la Cour, où était demeuré son frèreaîné et où il avait entretenu, dans le haut clergé, des relations utiles.
Il était donc pourvu déjà de l'expérience de milieux très divers lorsqu'il revint à Paris, après la mort de Henri IV .
La régence de Marie de Médicis se déroulait difficilement entre les intrigues des Grands, les rumeurs des protestants qu'alarmaient les succès de la Contre-Réforme , et la trop rapide fortune des favoris italiens de la reine : Leonora Galigaï et son mari Concini , promu marquis d'Ancre et maréchal de France.
Il fallut convoquer les États généraux.
Mais les divisions entre la noblesse et le clergé, d'une part, et le Tiers état (représenté surtout par desdétenteurs d'offices) renforcèrent la situation d'arbitre du pouvoir royal.
A la séance de clôture (février 1615), l'évêque de Luçon présenta le cahiergénéral de son ordre et, dans sa harangue, il revendiqua l'avantage pour les rois d'appeler des ecclésiastiques au Conseil, parce qu'obligés par leurprofession à la capacité, la probité et la prudence, ils étaient, à cause de leur célibat, “ plus dépouillés que les autres d'intérêts particuliers ”.
Il lepensait certainement, convaincu que la mission des rois était de reconnaître le bien public et de l'imposer à des sujets obéissants.
On comprendque, bien que gentilhomme, il redoutât les révoltes armées des Grands et de leur clientèle.
Mais, tout passant alors par les clientèles, il avait optépour celle de la reine-mère et donc de Concini P1416 .
Pendant quelques mois, d'octobre 1616 à avril 1617, il fut membre du Conseil et chargé du secrétariat d'État aux Affaires étrangères.
Il essaya de regagner la sympathie des princes protestants d'Allemagne, anciens alliés de Henri IV P139 , et de faire admettre, dans les conflits d'Italie, la médiation du roi de France.
Mais il avait trop compté sur la reine-mère et pas assez sur le jeune roilui-même, déjà majeur.
Quand celui-ci se débarrassa de Concini P1416 et saisit le pouvoir, Luçon entraîné dans la disgrâce de sa protectrice et il lui fallut sept années de patience et de bons services (travaillant à la réconciliation de la mère et du fils) pour être payé de ses efforts par le chapeaude cardinal et le retour au Conseil, où il devint le principal ministre.
Ainsi commença, qui devait durer dix-huit ans, jusqu'à la mort de Richelieu, cette association d'un roi et d'un homme tout-puissant, investi de laconfiance royale, que les historiens ont appelée le ministériat.
Elle s'explique assurément par la psychologie des personnages, mais l'erreur a étélongtemps de l'interpréter par la passion du pouvoir d'un ambitieux et la faiblesse d'un hypocondriaque.
Jamais prince ne porta aussi loin queLouis XIII P2029 la claire notion de l'autorité royale, par tempérament et par conviction religieuse de n'assurer le salut de son âme que par l'accomplissement de son devoir : la grandeur de l'État et le bonheur du peuple.
Louis XIII P2029 fut persuadé bientôt que Richelieu, mieux que quiconque, travaillait dans ce sens.
Après avoir accordé à son ministre une chaude amitié personnelle, il s'en détacha, mais il le conservanéanmoins, le défendit contre ses adversaires ( Journée des Dupes KW114 , 1630), résistant à toutes les tentatives d'écarter un serviteur irremplaçable, même s'il paraissait parfois le couvrir de son ombre.
Richelieu lui avait proposé, dans des termes devenus célèbres, de “ ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil desGrands, réduire tous ses sujets en leur devoir et relever son nom dans les nations étrangères, au point où il devaitêtre ”.
Cela revenait à combattre tout dérèglement à l'intérieur et à ne permettre à aucune puissance d'Europe, nil'Angleterre, déjà rivale sur mer, ni l'Espagne, qui enserrait le royaume sur plusieurs frontières, qui entretenait unparti en Allemagne et en Italie, de brider l'indépendance de la France et d'en contester le prestige.
Ainsi politiqueintérieure et politique étrangère devaient-elles être menées conjointement.
A l'intérieur, subsistait un curieux paradoxe.
En principe, l'autorité absolue du roi était reconnue aussi indivisible que le point en géométrie(opinion des légistes) et pourvue d'un charisme religieux par le sacre, mais, en fait, les privilèges de chaque groupe en contrariaient l'exercice etl'application : ceux des nobles, ceux des protestants, les uns et les autres avec des moyens de résistance armée, ceux des Parlements, descollectivités locales, des corporations.
Ces privilèges protégeaient des intérêts prochains et souvent raisonnables, mais l'abus commençait assezvite, lorsqu'ils devenaient obstacles à l'exécution des ordres du roi.
D'où la lutte contre les protestants et la guerre de La Rochelle P285M1 , parce que cette ville privilégiée et riche se comporte comme une république et demande secours à l'étranger, et que sa soumission doit montrer le roipuissant et redoutable ; les prises de villes dans le Sud-Ouest et, du moment que le parti est abattu, l'octroi de la paix à Alais (1629), car laclémence rehausse le prestige royal et la liberté religieuse des réformés est justifiée, s'il n'y a plus risque de rébellion politique.
Avec les Grands, ledanger dura autant que le ministériat, parce qu'ils disposaient de clientèle, pouvaient lever des troupes, tenir des forteresses, attirer avec eux lareine-mère, le frère du roi, regrouper des intérêts régionaux ou populaires.
Louis XIII P2029 s'accordait avec son ministre pour décourager la rébellion par des châtiments exemplaires, mais celle-ci renaissait toujours, comme une hydre.
Richelieu, parce qu'il avait de l'avenir dans l'esprit, envisageait des réformes.
Tenant la France pour un pays avantagé par la nature, riche par lavariété de ses sols, sa production agricole, ses bois, dans un temps qui ignorait les ressources de la houille, la qualité de ses industries du fer, dutextile, il pensait à l'exportation par la mer, à l'utilisation d'une flotte marchande protégée par une flotte de guerre, à la formation de compagnies de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- TESTAMENT POLITIQUE de Richelieu. (résumé et analyse)
- Le personnage de RICHELIEU (Armand-Jean Du Plessis, cardinal duc de)
- TESTAMENT POLITIQUE de Richelieu. (résumé et analyse)
- MÉMOIRES du cardinal de Richelieu - résumé
- CHAMPAIGNE Philippe de : Portrait du cardinal de Richelieu (analyse du tableau).