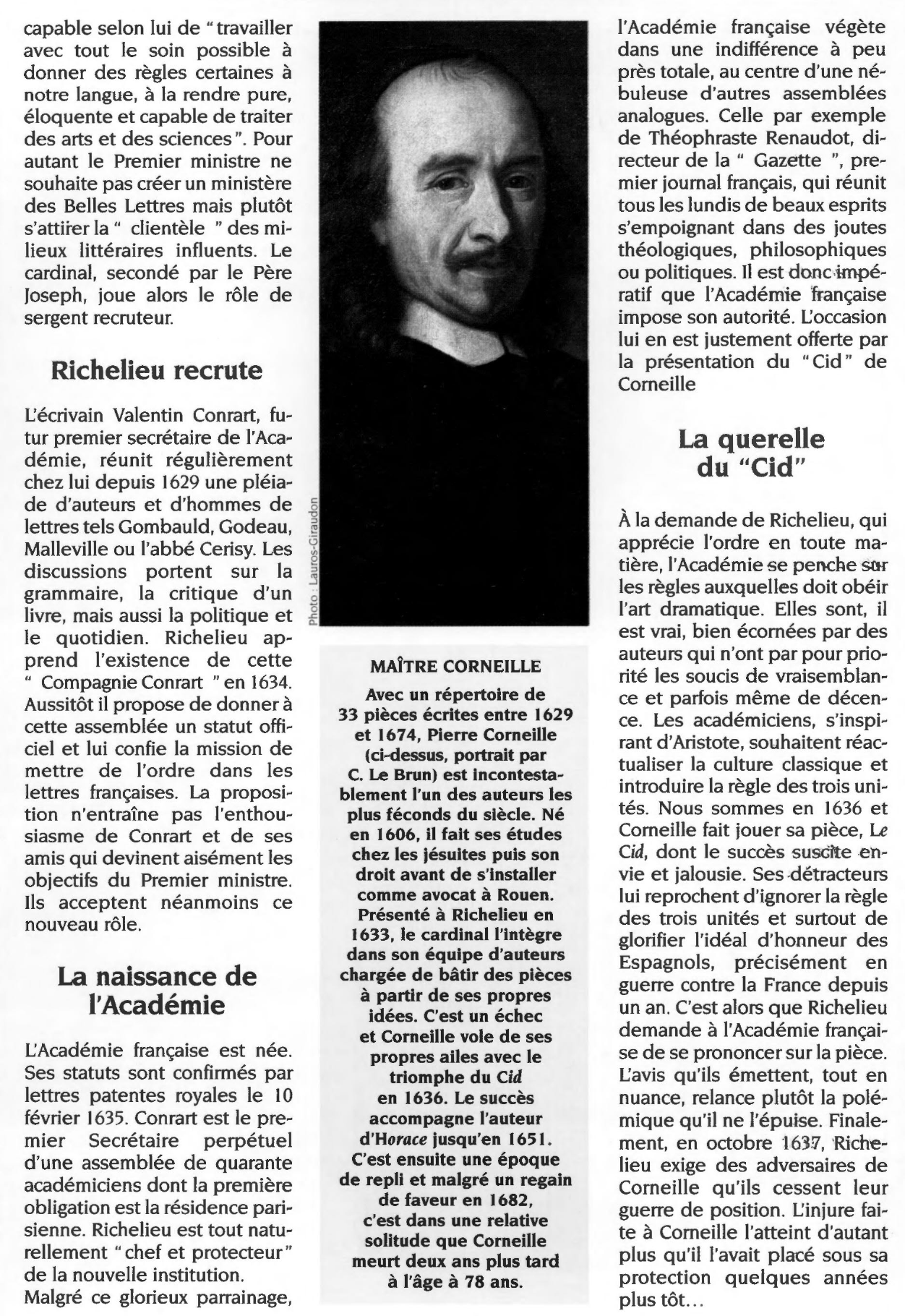Richelieu et l'Académie française
Publié le 01/04/2013

Extrait du document

À la demande de Richelieu, qui apprécie l'ordre en toute matière, l'Académie se penche sur les règles auxquelles doit obéir l'art dramatique. Elles sont, il est vrai, bien écornées par des auteurs qui n'ont par pour priorité les soucis de vraisemblance et parfois même de décence. Les académiciens, s'inspirant d'Aristote, souhaitent réactualiser la culture classique

«
capable selon lui de "travailler
avec tout le soin possible à
donner des règles certaines à
notre langue, à la rendre pure,
éloquente et capable de traiter
des arts et des sciences".
Pour
autant le Premier ministre ne
souhaite pas créer un ministère
des Belles Lettres mais plutôt
s'attifer la " clientèle " des mi
lieux littéraires influents.
Le
cardinal, secondé par le Père
Joseph, joue alors le rôle de
sergent recruteur .
Richelieu recrute
L'écrivain Valentin Conrart, fu
tur premier secrétaire de l'Aca
démie, réunit régulièrement
chez lui depuis 1629 une pléia
de d'auteurs et d'hommes de 5 "O lettres tels Gombauld, Godeau, ~
Malleville ou l'abbé Cerisy.
Les ~
discussions portent sur la j
grammaire, la critique d'un a
livre, mais aussi la politique et ~
le quotidien.
Richelieu ap
prend l'existence de cette
" Compagnie Conrart " en 1634.
Aussitôt il propose de donner à
cette assemblée un statut offi
ciel et lui confie la mission de
mettre de l'ordre dans les
lettres françaises.
La proposi
tion n'entraîne pas l'enthou
siasme de Conrart et de ses
amis qui devinent aisément les
objectifs
du Premier ministre.
Ils
acceptent néanmoins ce
nouveau rôle.
La naissance de
l'Académie
L'Académie française est née.
Ses statuts sont confirmés par
lettres patentes royales le 10
février 1635 .
Conrart est le pre
mier Secrétaire perpétuel
d'une assemblée de quarante
académiciens
dont la première
obligation
est la résidence pari
sienne.
Richelieu est tout natu
rellement " chef et protecteur"
de la nouvelle institution.
Malgré ce glorieux parrainage,
MAÎTRE CORNEILLE
Avec un répertoire de
33 pièces écrites entre 1629 et 1674, Pierre Corneille
(ci-dessus, portrait
par C.
Le Brun) est Incontesta- blement l'un des auteurs les plus féconds du siècle.
Né
en 1606, il fait ses études chez les jésuites puis son
droit avant
de s'installer
comme avocat à Rouen.
Présenté à Richelieu en 1633, le cardinal l'intègre dans son équipe d'auteurs
chargée de bâtir des pièces
à partir de ses propres
Idées.
C'est un échec
et Corneille vole de ses
propres alles avec le
triomphe du Cid
en 1636.
Le succès
accompagne l'auteur
d'Horace jusqu'en 1651.
C'est
ensuite une époque
de repli et malgré un regain
de faveur en 1682,
c'est dans une relative
solitude
que Corneille
meurt deux ans plus tard
à l'âge à 78 ans.
l'Académie française végète
dans une indifférence à peu
près totale, au centre d'une né
buleuse d'autres assemblées
analogues .
Celle par exemple
de Théophraste Renaudot, di
recteur de la " Gazette ", pre
mier journal français, qui réunit
tous les lundis
de beaux esprits
s'empoignant
dans des joutes
théologiques, philosophiques
ou politiques.
Il est donc.impé
ratif que l'Académie française
impose son autorité .
L'occasion
lui en est justement offerte par
la présentation du " Cid " de
Corneille
La querelle
du "Cid"
À la demande de Richelieu, qui
apprécie l'ordre
en toute ma
tière, l'Académie se penche sur
les règles auxquelles doit obéir
l'art dramatique.
Elles sont, il
est vrai, bien écornées par des
auteurs qui n'ont par pour prio
rité les soucis de vraisemblan
ce et parfois même de décen
ce.
Les académiciens, s'inspi
rant d'Aristote, souhaitent réac
tualiser la culture classique et
introduire la règle des trois uni
tés .
Nous sommes en 1636 et
Corneille fait jouer sa pièce, Le
Cid, dont le succès suscite en
vie et jalousie.
Ses -détracteurs
lui reprochent d'ignorer la règle
des trois unités et surtout de
glorifier l'idéal d'honneur des
Espagnols, précisément en
guerre contre la France depuis
un an.
C'est alors que Richelieu
demande à l'Académie françai
se de se prononcer sur la pièce .
L'avis qu'ils émettent, tout en
nuance, relance plutôt la polé
mique qu'il ne l'épuise .
Finale
ment, en octobre I 6l7, Riche
lieu exige des adversaires de
Corneille qu'ils cessent leur
guerre
de position .
L'injure fai
te à Corneille l'atteint d'autant
plus qu'il l'avait placé sous sa
protection quelques années
plus tôt ....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- DESMARETS de Saint-Sorlin, Jean (1595-1676) Ecrivain de l'Académie française, protégé de Richelieu.
- Académie française Créée par Richelieu, cette institution universellement célèbre eut en réalité une naissance difficile.
- DESMARETS de Saint-Sorlin, Jean (1595-1676) Ecrivain de l'Académie française, protégé de Richelieu.
- Richelieu et l'Académie française
- HISTOIRE DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE (résumé) de Paul Pellisson