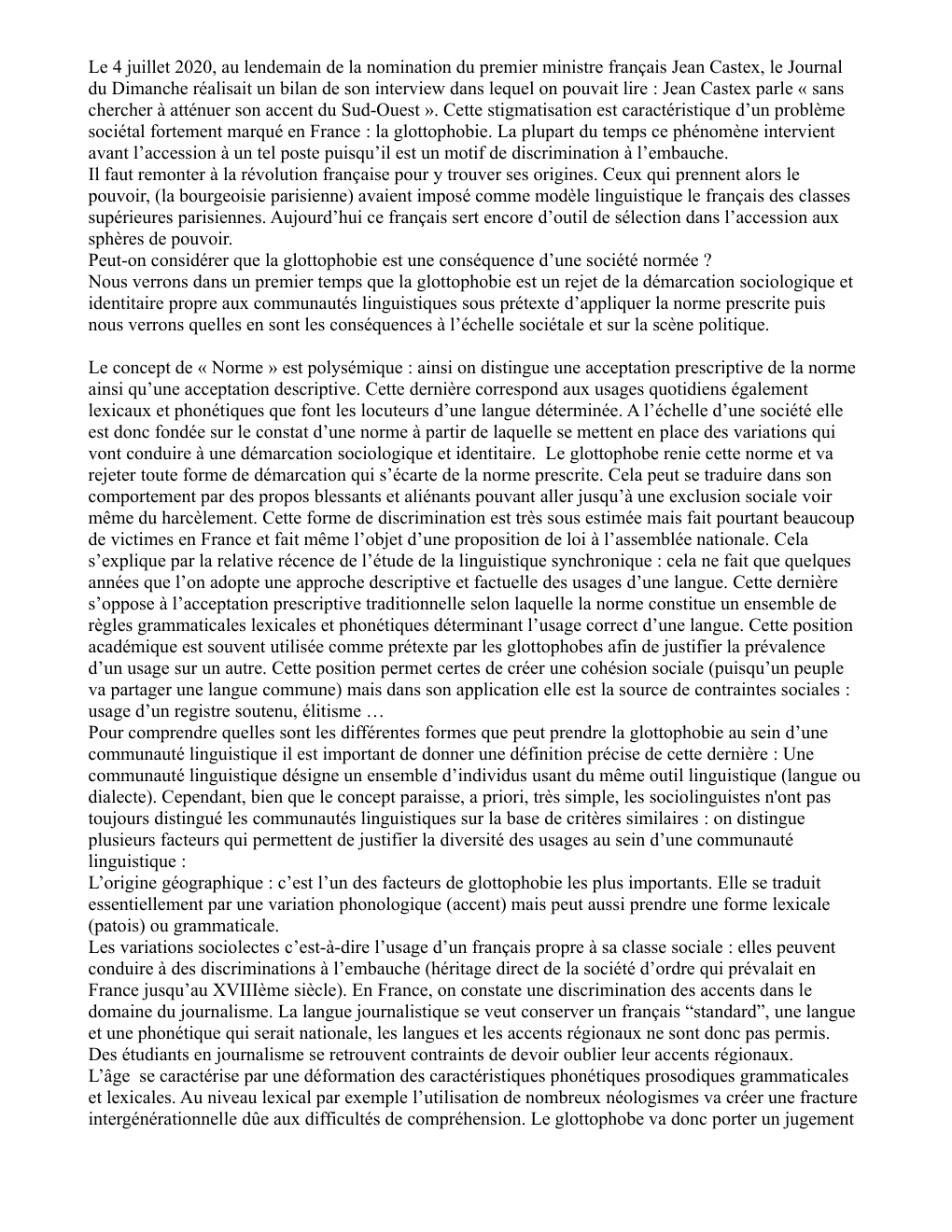Glottophobie
Publié le 09/05/2022
Extrait du document
«
Le 4 juillet 2020, au lendemain de la nomination du premier ministre français Jean Castex, le Journal
du Dimanche réalisait un bilan de son interview dans lequel on pouvait lire : Jean Castex parle « sans
chercher à atténuer son accent du Sud-Ouest ».
Cette stigmatisation est caractéristique d’un problème
sociétal fortement marqué en France : la glottophobie.
La plupart du temps ce phénomène intervient
avant l’accession à un tel poste puisqu’il est un motif de discrimination à l’embauche.
Il faut remonter à la révolution française pour y trouver ses origines.
Ceux qui prennent alors le
pouvoir, (la bourgeoisie parisienne) avaient imposé comme modèle linguistique le français des classes
supérieures parisiennes.
Aujourd’hui ce français sert encore d’outil de sélection dans l’accession aux
sphères de pouvoir.
Peut-on considérer que la glottophobie est une conséquence d’une société normée ?
Nous verrons dans un premier temps que la glottophobie est un rejet de la démarcation sociologique et
identitaire propre aux communautés linguistiques sous prétexte d’appliquer la norme prescrite puis
nous verrons quelles en sont les conséquences à l’échelle sociétale et sur la scène politique.
Le concept de « Norme » est polysémique : ainsi on distingue une acceptation prescriptive de la norme
ainsi qu’une acceptation descriptive.
Cette dernière correspond aux usages quotidiens également
lexicaux et phonétiques que font les locuteurs d’une langue déterminée.
A l’échelle d’une société elle
est donc fondée sur le constat d’une norme à partir de laquelle se mettent en place des variations qui
vont conduire à une démarcation sociologique et identitaire.
Le glottophobe renie cette norme et va
rejeter toute forme de démarcation qui s’écarte de la norme prescrite.
Cela peut se traduire dans son
comportement par des propos blessants et aliénants pouvant aller jusqu’à une exclusion sociale voir
même du harcèlement.
Cette forme de discrimination est très sous estimée mais fait pourtant beaucoup
de victimes en France et fait même l’objet d’une proposition de loi à l’assemblée nationale.
Cela
s’explique par la relative récence de l’étude de la linguistique synchronique : cela ne fait que quelques
années que l’on adopte une approche descriptive et factuelle des usages d’une langue.
Cette dernière
s’oppose à l’acceptation prescriptive traditionnelle selon laquelle la norme constitue un ensemble de
règles grammaticales lexicales et phonétiques déterminant l’usage correct d’une langue.
Cette position
académique est souvent utilisée comme prétexte par les glottophobes afin de justifier la prévalence
d’un usage sur un autre.
Cette position permet certes de créer une cohésion sociale (puisqu’un peuple
va partager une langue commune) mais dans son application elle est la source de contraintes sociales :
usage d’un registre soutenu, élitisme …
Pour comprendre quelles sont les différentes formes que peut prendre la glottophobie au sein d’une
communauté linguistique il est important de donner une définition précise de cette dernière : Une
communauté linguistique désigne un ensemble d’individus usant du même outil linguistique (langue ou
dialecte).
Cependant, bien que le concept paraisse, a priori, très simple, les sociolinguistes n'ont pas
toujours distingué les communautés linguistiques sur la base de critères similaires : on distingue
plusieurs facteurs qui permettent de justifier la diversité des usages au sein d’une communauté
linguistique :
L’origine géographique : c’est l’un des facteurs de glottophobie les plus importants.
Elle se traduit
essentiellement par une variation phonologique (accent) mais peut aussi prendre une forme lexicale
(patois) ou grammaticale.
Les variations sociolectes c’est-à-dire l’usage d’un français propre à sa classe sociale : elles peuvent
conduire à des discriminations à l’embauche (héritage direct de la société d’ordre qui prévalait en
France jusqu’au XVIIIème siècle).
En France, on constate une discrimination des accents dans le
domaine du journalisme.
La langue journalistique se veut conserver un français “standard”, une langue
et une phonétique qui serait nationale, les langues et les accents régionaux ne sont donc pas permis.
Des étudiants en journalisme se retrouvent contraints de devoir oublier leur accents régionaux.
L’âge se caractérise par une déformation des caractéristiques phonétiques prosodiques grammaticales
et lexicales.
Au niveau lexical par exemple l’utilisation de nombreux néologismes va créer une fracture
intergénérationnelle dûe aux difficultés de compréhension.
Le glottophobe va donc porter un jugement.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓