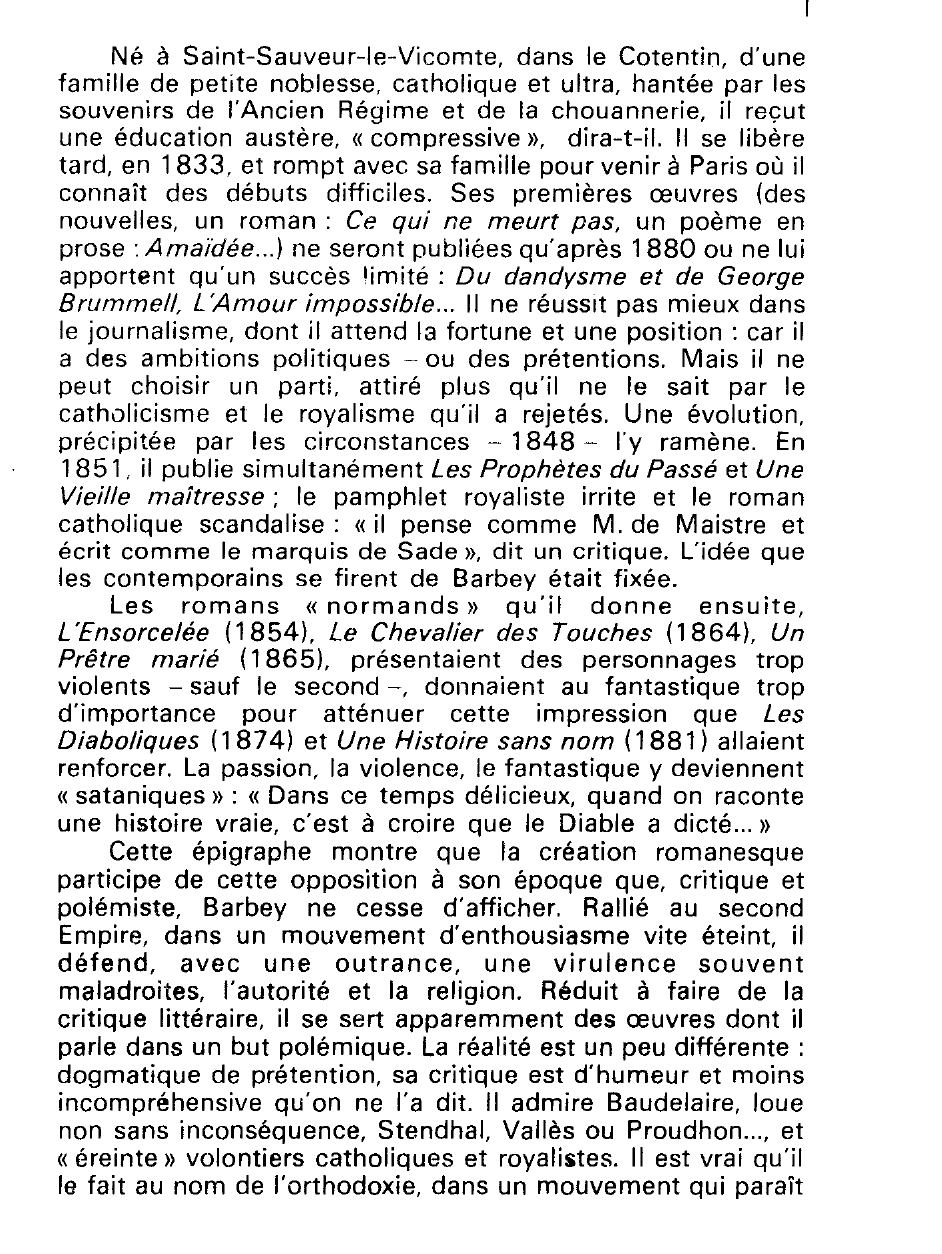Barbey d'Aurevilly (1808-1889) - analyse de l'oeuvre
Publié le 07/04/2012

Extrait du document

"Portrait dépaysé, je cherche mon cadre", la formule dit bien l'isolement dans lequel Barbey a vécu et s'est complu. Littérairement, politiquement il va -ou croit aller à contre-courant. se raidit dans l'opposition, dénonce "la bêtise contemporaine" avec un éclat qui séduit et irrite, écrit une oeuvre romanesque qui par le choix de l'époque: la chouannerie, ou par la violence des passions, traduit le même refus, dont le dandysme n'est peut-être que la manifestation la plus simple. Longtemps le personnage a ainsi masqué l'oeuvre dont s'amorce aujourd'hui une relecture....

«
Né à Saint-Sauveur-le-Vicomte, dans le Cotentin, d'une famille de petite noblesse, catholique et ultra, hantée par les
souvenirs de l'Ancien Régime et de la chouannerie, il reçut
une éducation austère, «compressive», dira-t-il.
Il se libère
tard, en 1833, et rompt avec sa famille pour venir à Paris où il
connaît des débuts difficiles.
Ses premières œuvres (des
nouvelles, un
roman : Ce qui ne meurt pas, un poème en prose: Amaidée ...
) ne seront publiées qu'après 1880 ou ne lui
apportent qu'un succès !imité : Du dandysme et de George Brummell, L'Amour impossible ...
Il ne réusstt pas mieux dans
le journalisme, dont il attend la fortune et une position : car il
a des
ambitions politiques -ou des prétentions.
Mais il ne peut choisir un parti, attiré plus qu'il ne le sait par le catholicisme et le royalisme qu'il a rejetés.
Une évolution,
précipitée par les circonstances -1848- l'y ramène.
En
1851, il publie simultanément Les Prophètes du Passé et Une Vieille maitresse; le pamphlet royaliste irrite et le roman
catholique scandalise: «il pense comme M.
de Maistre et écrit comme le marquis de Sade», dit un critique.
L'idée que les contemporains se firent de Barbey était fixée.
Les romans «normands» qu'il donne ensuite, L'Ensorcelée (1854).
Le Chevalier des Touches (1864), Un Prêtre marié ( 1865), présentaient des personnages trop violents -sauf le second -, donnaient au fantastique trop d'importance pour atténuer cette impression que Les Diaboliques ( 1874) et Une Histoire sans nom ( 1881) allaient
renforcer.
La passion, la violence, le fantastique y deviennent
« sataniques» : « Dans ce temps délicieux, quand on raconte
une histoire vraie, c'est à croire que le Diable a dicté ...
»
Cette
épigraphe montre que la création romanesque
participe de cette opposition à son époque que, critique et polémiste, Barbey ne cesse d'afficher.
Rallié au second
Empire, dans un
mouvement d'enthousiasme vite éteint, il
défend, avec une outrance, une virulence souvent maladroites, l'autorité et la religion.
Réduit à faire de la
critique littéraire, il se sert apparemment des œuvres dont il
parle dans un but polémique.
La réalité est un peu différente :
dogmatique de prétention, sa critique est d'humeur et moins incompréhensive qu'on ne l'a dit.
Il admire Baudelaire, loue
non sans inconséquence,
Stendhal, Vallès ou Proudhon ...
, et
«éreinte» volontiers catholiques et royalistes.
Il est vrai qu'il le fait au nom de l'orthodoxie, dans un mouvement qui paraît.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- PRÊTRE MARIÉ (Un) de Jules Barbey d’Aurevilly (résumé et analyse de l’oeuvre)
- Ensorcelée (L'). Roman de Jules Barbey d'Aurevilly (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Diaboliques (les). Recueil de nouvelles de Jules Barbey d'Aurevilly (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Chevalier des Touches (le). Roman de Jules Barbey d'Aurevilly (résumé de l'oeuvre & analyse détaillée)
- Barbey d'Aurevilly (Jules) Écrivain français (Saint-Sauveur-le-Vicomte, 1808 - Paris, 1889).