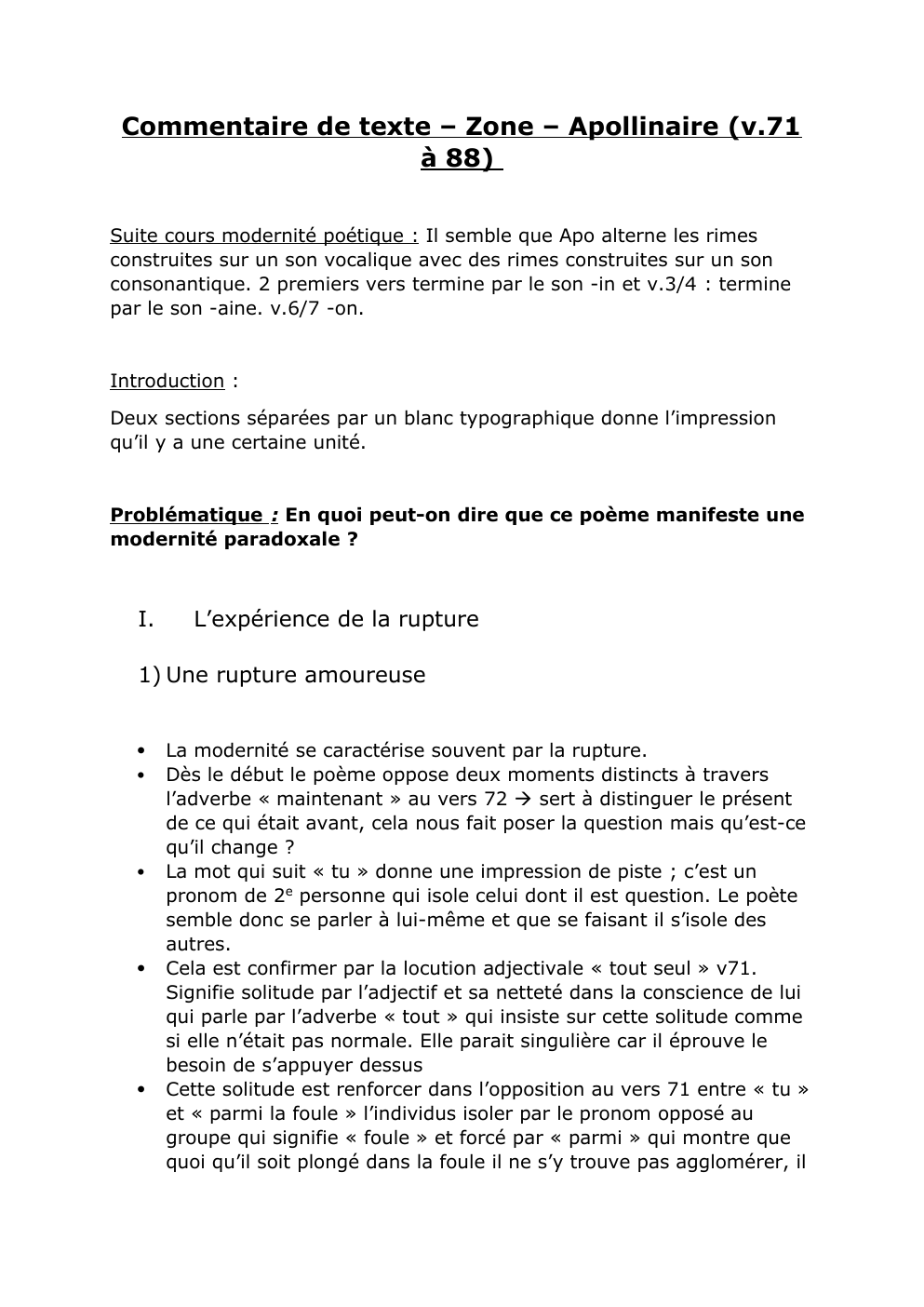Commentaire de texte - Zone d'Apollinaire (fait par un professeur de lettre)
Publié le 27/04/2023
Extrait du document
«
Commentaire de texte – Zone – Apollinaire (v.71
à 88)
Suite cours modernité poétique : Il semble que Apo alterne les rimes
construites sur un son vocalique avec des rimes construites sur un son
consonantique.
2 premiers vers termine par le son -in et v.3/4 : termine
par le son -aine.
v.6/7 -on.
Introduction :
Deux sections séparées par un blanc typographique donne l’impression
qu’il y a une certaine unité.
Problématique : En quoi peut-on dire que ce poème manifeste une
modernité paradoxale ?
I.
L’expérience de la rupture
1) Une rupture amoureuse
La modernité se caractérise souvent par la rupture.
Dès le début le poème oppose deux moments distincts à travers
l’adverbe « maintenant » au vers 72 sert à distinguer le présent
de ce qui était avant, cela nous fait poser la question mais qu’est-ce
qu’il change ?
La mot qui suit « tu » donne une impression de piste ; c’est un
pronom de 2e personne qui isole celui dont il est question.
Le poète
semble donc se parler à lui-même et que se faisant il s’isole des
autres.
Cela est confirmer par la locution adjectivale « tout seul » v71.
Signifie solitude par l’adjectif et sa netteté dans la conscience de lui
qui parle par l’adverbe « tout » qui insiste sur cette solitude comme
si elle n’était pas normale.
Elle parait singulière car il éprouve le
besoin de s’appuyer dessus
Cette solitude est renforcer dans l’opposition au vers 71 entre « tu »
et « parmi la foule » l’individus isoler par le pronom opposé au
groupe qui signifie « foule » et forcé par « parmi » qui montre que
quoi qu’il soit plongé dans la foule il ne s’y trouve pas agglomérer, il
est dans la foule mais il ne fait pas parmi d’elle.
Il fait l’expérience
de se sentir autre et de n’avoir pas l’impression de se sentir dedans
pour autant.
-
-
-
Solitude renforcé par l’opposition des activités : lui il marche tant
dis que les autres passent en bus / 72 « des troupeaux d’autobus
mugissent en près de toi roulent »
En outre les bus sont animaliser pour montrer sa différence, il
n’est pas comme car lui parle tant dis que les troupeaux
d’autobus mugissent.
L’animalisation se manifeste en 1er dans
« troupeaux » (attroupement d’animaux) et dans « mugissant »
(cris animal).
L’animalisation le singularise, le met à part.
Ces bus sont représentés en nombre « troupeaux » pluriel +
troupeaux désigne une grande quantité ; plusieurs blocs de
grande quantité qui fait opposition à la solitude du poète.
Marqué
notamment par la proximité dans le vers avec « près de toi »
juxtapose la figure singulière du poète à celle des troupeaux donc
faire ressortir d’autant plus par le contraste immédiat : sa
solitude
La nouveauté pour le poète se serait d’être seul mais pourquoi il ne l’était
pas avant qu’est ce qui change entre le passé et le présent.
Les vers suivant y répondent (v73/74).
Le verbe « aimer » est
compris dans une structure de négation totale comme si « tu ne
devrais plus jamais être aimé » indiquant la rupture de continuité
temporelle avec le « ne plus » ce qui rejoint le « maintenant ».
Donc
quelque chose à change, le verbe ici étant « aimer » indique que ce
qui à changé se rapporte à l’amour.
-
Remarquons que le verbe est conjugué sous sa forme passive
« être aimé » comme si « tu ne devais plus jamais être aimé »,
ce n’est pas le poète qui n’aime plus mais que l’interruption de
l’amour frappe la femme, c’est sans doute que lui aime toujours
mais c’est l’autre qui n’aime plus, il n’est plus aimé par d’où
l’impression de sa solitude.
Conclusion 1) : Ce poème nous présente le poète donc il se présente luimême comme le mal aimé (celui de la chanson) et sa poésie est exposé
comme une évocation lyrique.
1) La souffrance du mal aimé
La rupture amoureuse est pour le poète cause de souffrance comme
nous pouvons le remarquer au v86.
- Il écrit « l’amour dont je souffre » cela relit étroitement l’amour à
la souffrance.
L’amour source naturelle de souffrance.
- Cette souffrance se présente tout d’abord comme
psychologique.
Car elle fait éprouvé l’angoisse comme marqué
v73 « l’angoisse de l’amour » l’amour est associé par
complément du nom à angoisse comme s’il était une origine de
celle-ci, comme si leur lien était évident.
Cette évidence est confirmée par le retour au v87 « te fait
survivre dans l’insomnie et dans l’angoisse » cette image que
possède le poète.
Nous pouvons en suggérer qu’il s’agit de la
femme, qui est cause de cette angoisse.
L’angoisse peut être défini comme un malaise psychique, une
crainte diffuse devant l’imminence d’un danger très pressant
mais pas toujours identifier et parait assez insurmontable.
Ajoutons un sens philosophique, celui d’une inquiétude
métaphysique, né la réflexion de l’existence humaine.
Cela
signifierait que cette souffrance que ressent le poète le conduit à
douter du sens même de son existence donc le remettrait
profondément en cause.
- Mais à cette première façon de caractériser la souffrance
psychologique s’ajoute l’insomnie dont il parle dans ce même
vers 87.
L’insomnie est le fait de ne pas trouver le sommeil, c’est
une torture.
Ici le poète se présente donc comme pris par cette
manifestation nocturne de l’angoisse donc comme une
confirmation de la force de l’angoisse qui ne se produit pas que
de jours mais aussi la nuit, mais une forme d’accroissement de
l’angoisse qui signifie que la souffrance ne s’arrête jamais.
L’insomnie est traitée et considérée comme une maladie de nos
jours qui est source de souffrance
- Le poète dit être malade comme nous le lisons v85 « Je suis
malade d’ouïr les paroles bien heureuses ».
La structure
attributive qui le réduit lui par le « je » à cet état de maladie.
Comme s’il n’y avait plus en lui-même de place pour autre chose
que cette maladie.
- L’amour qu’il ressent est assimilé par métaphore à une maladie
dans le v86 mais aussi dans sa continuité.
Or si la maladie est
source de souffrance, elle est aussi un disfonctionnement de la
personne, il n’était plus vrm lui-même a cause de la maladie.
Premièrement, la souffrance physique de la maladie est exprimer
au v13 : « serrer le gosier » signifie une action concrète sur le
corps, la gorge ici à cause de l’angoisse très concret par cet
effet de pression, d’être comprimé.
En outre c’est une
personnification de l’angoisse.
L’angoisse sert le gosier comme si
elle était à l’initiative, comme si elle essayait de refermer ses
mains sur sa gorge, ce qui lui donne plus de force.
Comme le
gosier est la gorge ca veut dire que l’amour fait pression sur la
partie du corp qui apporte l’oxygène donc il ne peux plus respirer
donc vivre.
La souffrance est telle qui semble donc manquer d’air
comme lui manque l’amour, l’amour étant assimilé à l’air lui
permettant de vivre donc le poète risquerait de mourir.
Deuxièmement, la portion de dysfonctionnement du corp est
porté par « l’image que tu possèdes te fait survivre » v87.
Donc
le poète ne vit plus, il survit.
Survivre signifie continuer de vivre
après une cause de mort.
Donc le poète survit à la séparation
mais il pense qu’il aurait du en mourir.
Survivre signifie aussi
qu’il est déjà mort, donc il ne vit plus vrm et donc il est dans un
état inférieur à cela de la vie.
Il est diminué.
Cela permet d’affirmé que le poète est malade de l’amour et
cette amour est cause de souffrance physique et aussi
dysfonctionnement de la personne
Point 1 : Le poète exprime une souffrance très forte telle qu’elle lui donne
l’impression de ne plus vivre, d’être en sursis comme tué par la rupture
amoureuse.
La violence de cette souffrance se trouve encore exprimer non pas
seulement par l’expression explicite « sentiments du poète » mais
par la violence des images qu’il déploie.
5 images qu’il déploie :
-
-
V77 ; il y a une comparaison « tu te moques de toi et comme le
feu de l’enfer ton rire pétille » Dans cette comparaison, on
observe le fait de recourir à la violence des flammes, le feu mais
aussi la violence morale du lieu désignant l’au-delà de la mort :
l’enfer.
D’autant plus, qu’il s’agit du lieu où se retrouve les
déplorer, là où Dieu n’est pas, là où l’amour n’est pas.
Le feu
serai activé au v78 par le substantif « étincelles » donc la
métaphore est filé ici ce qui permet au poète de dire la très
grande violence, à la fois le feu et l’enfer de la situation qu’il
endure.
V79 ; métaphore « c’est un tableau pendu dans un sombre
musée ».
« Pendue » pour un tableau est un peu curieux.....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire de texte : ZONE d'apollinaire
- Zone d'Apollinaire texte bac: modernité
- Commentaire du texte de Rousseau : Julie ou la Nouvelle Héloïse, Lettre VIII
- Commentaire de Texte Lettre au President Lincoln de L'AIT
- Commentaire de texte - lettre Henri Ier