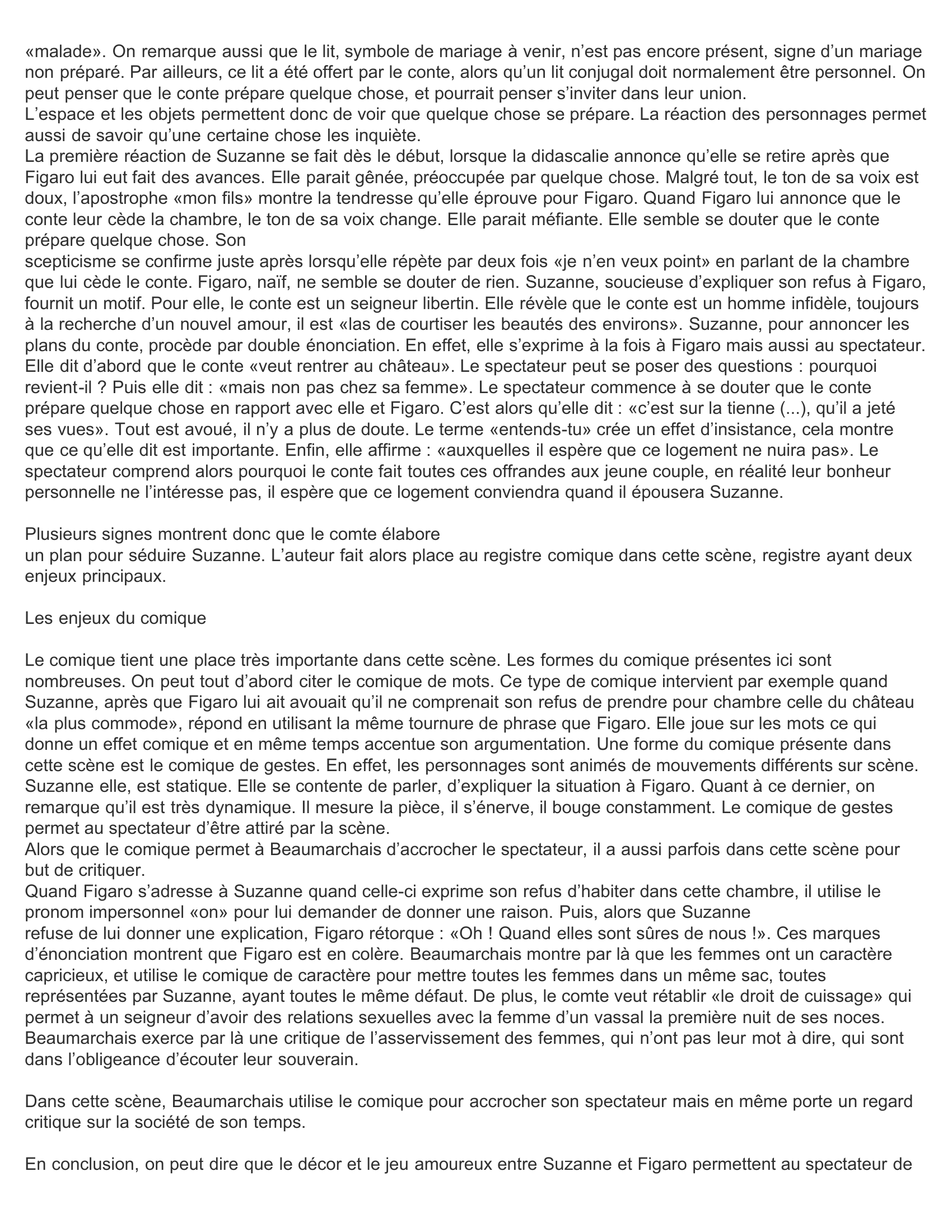Commentaire "le mariage de figaro" acte i scène 1
Publié le 12/09/2018

Extrait du document
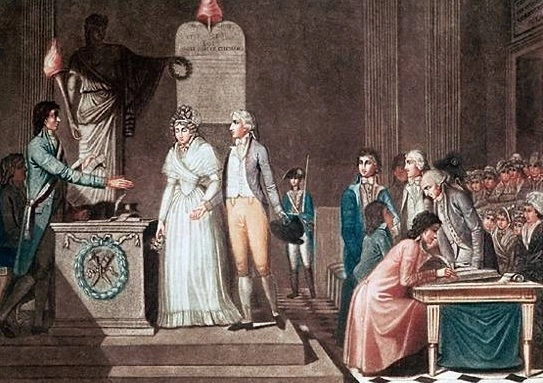
Quand Figaro s’adresse à Suzanne quand celle-ci exprime son refus d’habiter dans cette chambre, il utilise le pronom impersonnel «on» pour lui demander de donner une raison. Puis, alors que Suzanne
refuse de lui donner une explication, Figaro rétorque : «Oh ! Quand elles sont sûres de nous !». Ces marques d’énonciation montrent que Figaro est en colère. Beaumarchais montre par là que les femmes ont un caractère capricieux, et utilise le comique de caractère pour mettre toutes les femmes dans un même sac, toutes représentées par Suzanne, ayant toutes le même défaut. De plus, le comte veut rétablir «le droit de cuissage» qui permet à un seigneur d’avoir des relations sexuelles avec la femme d’un vassal la première nuit de ses noces. Beaumarchais exerce par là une critique de l’asservissement des femmes, qui n’ont pas leur mot à dire, qui sont dans l’obligeance d’écouter leur souverain.
Dans cette scène, Beaumarchais utilise le comique pour accrocher son spectateur mais en même porte un regard critique sur la société de son temps.
En conclusion, on peut dire que le décor et le jeu amoureux entre Suzanne et Figaro permettent au spectateur de comprendre que le thème principal est celui du mariage. Ensuite, les objets présents sur scène et les réactions des personnages lui font comprendre que quelque chose se prépare. Enfin, l’auteur emploie le registre comique pour accrocher le spectateur mais aussi pour exercer une critique sur la société de son temps. Nous pourrions alors nous poser la question suivante : «l’intrigue est-elle lancée de la même façon dans Le Barbier de Séville ?»
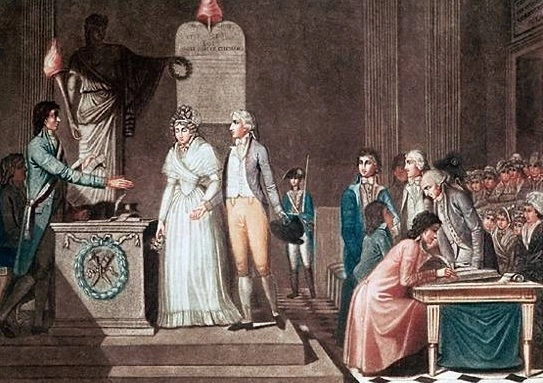
«
«malade».
On remarque aussi que le lit, symbole de mariage à venir, n’est pas encore présent, signe d’un mariage
non préparé.
Par ailleurs, ce lit a été offert par le conte, alors qu’un lit conjugal doit normalement être personnel.
On
peut penser que le conte prépare quelque chose, et pourrait penser s’inviter dans leur union.
L’espace et les objets permettent donc de voir que quelque chose se prépare.
La réaction des personnages permet
aussi de savoir qu’une certaine chose les inquiète.
La première réaction de Suzanne se fait dès le début, lorsque la didascalie annonce qu’elle se retire après que
Figaro lui eut fait des avances.
Elle parait gênée, préoccupée par quelque chose.
Malgré tout, le ton de sa voix est
doux, l’apostrophe «mon fils» montre la tendresse qu’elle éprouve pour Figaro.
Quand Figaro lui annonce que le
conte leur cède la chambre, le ton de sa voix change.
Elle parait méfiante.
Elle semble se douter que le conte
prépare quelque chose.
Son
scepticisme se confirme juste après lorsqu’elle répète par deux fois «je n’en veux point» en parlant de la chambre
que lui cède le conte.
Figaro, naïf, ne semble se douter de rien.
Suzanne, soucieuse d’expliquer son refus à Figaro,
fournit un motif.
Pour elle, le conte est un seigneur libertin.
Elle révèle que le conte est un homme infidèle, toujours
à la recherche d’un nouvel amour, il est «las de courtiser les beautés des environs».
Suzanne, pour annoncer les
plans du conte, procède par double énonciation.
En effet, elle s’exprime à la fois à Figaro mais aussi au spectateur.
Elle dit d’abord que le conte «veut rentrer au château».
Le spectateur peut se poser des questions : pourquoi
revient -il ? Puis elle dit : «mais non pas chez sa femme».
Le spectateur commence à se douter que le conte
prépare quelque chose en rapport avec elle et Figaro.
C’est alors qu’elle dit : «c’est sur la tienne (...), qu’il a jeté
ses vues».
Tout est avoué, il n’y a plus de doute.
Le terme «entends-tu» crée un effet d’insistance, cela montre
que ce qu’elle dit est importante.
Enfin, elle affirme : «auxquelles il espère que ce logement ne nuira pas».
Le
spectateur comprend alors pourquoi le conte fait toutes ces offrandes aux jeune couple, en réalité leur bonheur
personnelle ne l’intéresse pas, il espère que ce logement conviendra quand il épousera Suzanne.
Plusieurs signes montrent donc que le comte élabore
un plan pour séduire Suzanne.
L’auteur fait alors place au registre comique dans cette scène, registre ayant deux
enjeux principaux.
Les enjeux du comique
Le comique tient une place très importante dans cette scène.
Les formes du comique présentes ici sont
nombreuses.
On peut tout d’abord citer le comique de mots.
Ce type de comique intervient par exemple quand
Suzanne, après que Figaro lui ait avouait qu’il ne comprenait son refus de prendre pour chambre celle du château
«la plus commode», répond en utilisant la même tournure de phrase que Figaro.
Elle joue sur les mots ce qui
donne un effet comique et en même temps accentue son argumentation.
Une forme du comique présente dans
cette scène est le comique de gestes.
En effet, les personnages sont animés de mouvements différents sur scène.
Suzanne elle, est statique.
Elle se contente de parler, d’expliquer la situation à Figaro.
Quant à ce dernier, on
remarque qu’il est très dynamique.
Il mesure la pièce, il s’énerve, il bouge constamment.
Le comique de gestes
permet au spectateur d’être attiré par la scène.
Alors que le comique permet à Beaumarchais d’accrocher le spectateur, il a aussi parfois dans cette scène pour
but de critiquer.
Quand Figaro s’adresse à Suzanne quand celle-ci exprime son refus d’habiter dans cette chambre, il utilise le
pronom impersonnel «on» pour lui demander de donner une raison.
Puis, alors que Suzanne
refuse de lui donner une explication, Figaro rétorque : «Oh ! Quand elles sont sûres de nous !».
Ces marques
d’énonciation montrent que Figaro est en colère.
Beaumarchais montre par là que les femmes ont un caractère
capricieux, et utilise le comique de caractère pour mettre toutes les femmes dans un même sac, toutes
représentées par Suzanne, ayant toutes le même défaut.
De plus, le comte veut rétablir «le droit de cuissage» qui
permet à un seigneur d’avoir des relations sexuelles avec la femme d’un vassal la première nuit de ses noces.
Beaumarchais exerce par là une critique de l’asservissement des femmes, qui n’ont pas leur mot à dire, qui sont
dans l’obligeance d’écouter leur souverain.
Dans cette scène, Beaumarchais utilise le comique pour accrocher son spectateur mais en même porte un regard
critique sur la société de son temps.
En conclusion, on peut dire que le décor et le jeu amoureux entre Suzanne et Figaro permettent au spectateur de.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Commentaire sur le Mariage de Figaro extrait de l'acte III scène 16
- Commentaire acte III scène 15 le mariage de Figaro
- Commentaire composé : Le Mariage de Figaro ; Beaumarchais. Acte V scène 7.
- Acte II scène 21 du mariage de Figaro (Commentaire)
- Commentaire Acte V, scène 3 Le Mariage de Figaro (Commentaire)