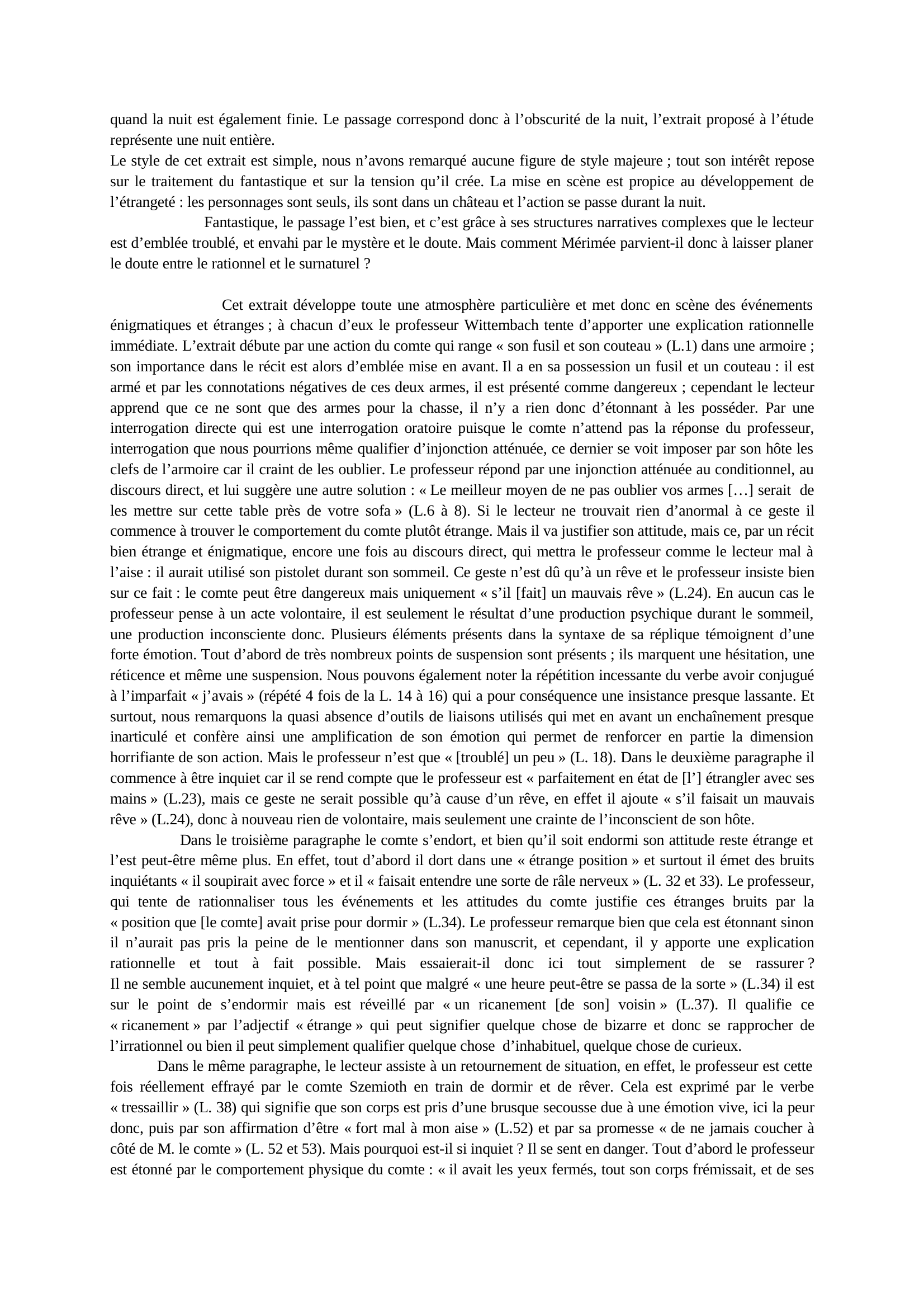Commentaire Lokis Mérimée
Publié le 23/10/2012

Extrait du document
« La bête humaine « Commentaire composé Lokis de Mérimée p.210 Le XIXème siècle montre un intérêt très fort pour les animaux et plus particulièrement pour le rapport qui relie l'homme à l'animal. Parue en 1869 dans la Revue des deux Mondes, Lokis est une nouvelle fantastique de Prosper Mérimée dont le sujet, selon lui, est « [...] le plus extravaguant et le plus atroce [...] « (Lettre à Mme Delessert). Le professeur Wittembach est invité au château du comte Szemioth pour y consulter un ouvrage très rare : le Catechismus Samogiticus de Lawicki. Ce comte est lié à une histoire terrifiante : sa mère a eu le malheur d'être enlevée par un ours et elle en est devenue folle. Le comportement très étrange du comte est d'emblée manifesté au professeur ainsi qu'au lecteur. Durant toute la nouvelle nous assistons à une gradation dans l'étrange : mais pourquoi le comportement du comte est si étrange ? Notre extrait se trouve au cinquième chapitre de la nouvelle, dans lequel le professeur et le comte sont au château de Dowghielly, où demeure Mlle Ioulka dont ce dernier semble amoureux. Pour la nuit, ils sont tous deux contraints de dormir dans la même pièce. Le professeur est alors très mal à l'aise car témoin d'un crescendo dans les bizarreries de son hôte : l'anecdote de son somnambulisme, ses divers « bruits « et surtout, l'étrange rêve qu'il fait, qui semble révéler une nature bestiale et monstrueuse. Cet extrait qui mêle description et dialogue, met en scène le comte et le professeur seuls ensemble ; il confronte le lecteur à des événements de plus en plus étranges qui se trouve alors face à un choix paradoxal entre une version surnaturelle et une explication rationnelle, le rationnel commençant petit à petit à être mis en doute. Ce sont donc les moyens dont use Mérimée pour maintenir le trouble et l'ambiguïté tout en essayant de faire pencher le lecteur du côté de l'irrationnel via l'inquiétude du professeur que nous allons étudier. Dans quelle mesure la nouvelle Lokis peut être qualifiée de fantastique et quelles sont les structures narratives de cet extrait ? Comment le professeur tente-il de donner aux événements de plus en plus étranges une explication rationnelle? Enfin, en quoi cet extrait oriente plus le lecteur du côté de l'irrationnel ? Lokis est une nouvelle fantastique. Mais qu'est ce que le fantastique ? Le texte fantastique est ambigu. Selon le théoricien de la littérature Tzvetan Todorov le fantastique ne serait présent que dans l'hésitation entre l'acceptation du surnaturel en tant que tel et une tentative d'explication rationnelle. Autrement dit, le fantastique est l'hésitation entre une explication rationnelle et irrationnelle, cette hésitation est entièrement maintenue dans la nouvelle de Prosper Mérimée, en effet le lecteur est dans l'impossibilité de « trancher « entre les deux explications qui sont en fait toutes deux possibles. Dans le fantastique, la peur est très souvent présente pour le héros comme pour le lecteur, Sigmund Freud parle de l'inquiétante étrangeté propre à ce genre littéraire. C'est une littérature de la souffrance, de la folie, de l'échec... qui marque une rupture profonde avec l'optimisme des lumières. Grâce à un texte court, Mérimée parvient à maintenir une tension dramatique. Lokis peut être interprété de deux manières différentes, soit le comte Szemioth est un ours et il s'est vraiment transformé durant la nuit des noces, soit le comte est en fait fou. La version rationnelle comme la version irrationnelle sont possibles dans ce récit. Il fait appel à un narrateur redoublé d'un second narrateur qui introduit le récit et le met à distance : en effet nous avons le procédé d'un récit enchâssé, la nouvelle se constitue d'un récit cadre, ou encadrant, et d'un récit encadré qui est le manuscrit, « ce cahier relié en parchemin « (chapitre 1), du professeur Wittembach. Selon la formulation de Gérard Genette le narrateur du récit cadre est hétérodiégétique alors que celui du récit encadré est un narrateur homodiégétique. Nous pouvons même parler d...
«
quand la nuit est également finie.
Le passage correspond donc à l’obscurité de la nuit, l’extrait proposé à l’étude
représente une nuit entière.
Le style de cet extrait est simple, nous n’avons remarqué aucune figure de style majeure ; tout son intérêt repose
sur le traitement du fantastique et sur la tension qu’il crée.
La mise en scène est propice au développement de
l’étrangeté : les personnages sont seuls, ils sont dans un château et l’action se passe durant la nuit.
Fantastique, le passage l’est bien, et c’est grâce à ses structures narratives complexes que le lecteur
est d’emblée troublé, et envahi par le mystère et le doute.
Mais comment Mérimée parvient-il donc à laisser planer
le doute entre le rationnel et le surnaturel ?
Cet extrait développe toute une atmosphère particulière et met donc en scène des événements
énigmatiques et étranges ; à chacun d’eux le professeur Wittembach tente d’apporter une explication rationnelle
immédiate.
L’extrait débute par une action du comte qui range « son fusil et son couteau » (L.1) dans une armoire ;
son importance dans le récit est alors d’emblée mise en avant.
Il a en sa possession un fusil et un couteau : il est
armé et par les connotations négatives de ces deux armes, il est présenté comme dangereux ; cependant le lecteur
apprend que ce ne sont que des armes pour la chasse, il n’y a rien donc d’étonnant à les posséder.
Par une
interrogation directe qui est une interrogation oratoire puisque le comte n’attend pas la réponse du professeur,
interrogation que nous pourrions même qualifier d’injonction atténuée, ce dernier se voit imposer par son hôte les
clefs de l’armoire car il craint de les oublier.
Le professeur répond par une injonction atténuée au conditionnel, au
discours direct, et lui suggère une autre solution : « Le meilleur moyen de ne pas oublier vos armes […] serait de
les mettre sur cette table près de votre sofa » (L.6 à 8).
Si le lecteur ne trouvait rien d’anormal à ce geste il
commence à trouver le comportement du comte plutôt étrange.
Mais il va justifier son attitude, mais ce, par un récit
bien étrange et énigmatique, encore une fois au discours direct, qui mettra le professeur comme le lecteur mal à
l’aise : il aurait utilisé son pistolet durant son sommeil.
Ce geste n’est dû qu’à un rêve et le professeur insiste bien
sur ce fait : le comte peut être dangereux mais uniquement « s’il [fait] un mauvais rêve » (L.24).
En aucun cas le
professeur pense à un acte volontaire, il est seulement le résultat d’une production psychique durant le sommeil,
une production inconsciente donc.
Plusieurs éléments présents dans la syntaxe de sa réplique témoignent d’une
forte émotion.
Tout d’abord de très nombreux points de suspension sont présents ; ils marquent une hésitation, une
réticence et même une suspension.
Nous pouvons également noter la répétition incessante du verbe avoir conjugué
à l’imparfait « j’avais » (répété 4 fois de la L.
14 à 16) qui a pour conséquence une insistance presque lassante.
Et
surtout, nous remarquons la quasi absence d’outils de liaisons utilisés qui met en avant un enchaînement presque
inarticulé et confère ainsi une amplification de son émotion qui permet de renforcer en partie la dimension
horrifiante de son action.
Mais le professeur n’est que « [troublé] un peu » (L.
18).
Dans le deuxième paragraphe il
commence à être inquiet car il se rend compte que le professeur est « parfaitement en état de [l’] étrangler avec ses
mains » (L.23), mais ce geste ne serait possible qu’à cause d’un rêve, en effet il ajoute « s’il faisait un mauvais
rêve » (L.24), donc à nouveau rien de volontaire, mais seulement une crainte de l’inconscient de son hôte.
Dans le troisième paragraphe le comte s’endort, et bien qu’il soit endormi son attitude reste étrange et
l’est peut-être même plus.
En effet, tout d’abord il dort dans une « étrange position » et surtout il émet des bruits
inquiétants « il soupirait avec force » et il « faisait entendre une sorte de râle nerveux » (L.
32 et 33).
Le professeur,
qui tente de rationnaliser tous les événements et les attitudes du comte justifie ces étranges bruits par la
« position que [le comte] avait prise pour dormir » (L.34).
Le professeur remarque bien que cela est étonnant sinon
il n’aurait pas pris la peine de le mentionner dans son manuscrit, et cependant, il y apporte une explication
rationnelle et tout à fait possible.
Mais essaierait-il donc ici tout simplement de se rassurer ?
Il ne semble aucunement inquiet, et à tel point que malgré « une heure peut-être se passa de la sorte » (L.34) il est
sur le point de s’endormir mais est réveillé par « un ricanement [de son] voisin » (L.37).
Il qualifie ce
« ricanement » par l’adjectif « étrange » qui peut signifier quelque chose de bizarre et donc se rapprocher de
l’irrationnel ou bien il peut simplement qualifier quelque chose d’inhabituel, quelque chose de curieux.
Dans le même paragraphe, le lecteur assiste à un retournement de situation, en effet, le professeur est cette
fois réellement effrayé par le comte Szemioth en train de dormir et de rêver.
Cela est exprimé par le verbe
« tressaillir » (L.
38) qui signifie que son corps est pris d’une brusque secousse due à une émotion vive, ici la peur
donc, puis par son affirmation d’être « fort mal à mon aise » (L.52) et par sa promesse « de ne jamais coucher à
côté de M.
le comte » (L.
52 et 53).
Mais pourquoi est-il si inquiet ? Il se sent en danger.
Tout d’abord le professeur
est étonné par le comportement physique du comte : « il avait les yeux fermés, tout son corps frémissait, et de ses.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Lokis (extrait) Prosper Mérimée A onze heures et demie, après beaucoup de méchantes plaisanteries, on commença à murmurer, tout bas d'abord, bientôt assez haut.
- Commentaire de la rencontre de Carmen et Don José - Carmen, de Prosper Mérimée
- Bernard Lahire Commentaire
- Droit public des biens - Commentaire d’arrêt Conseil d'Etat, 18 septembre 2015, société Prest’Air req. N° 387315
- COMMENTAIRE DE TEXTE (concours administratifs)