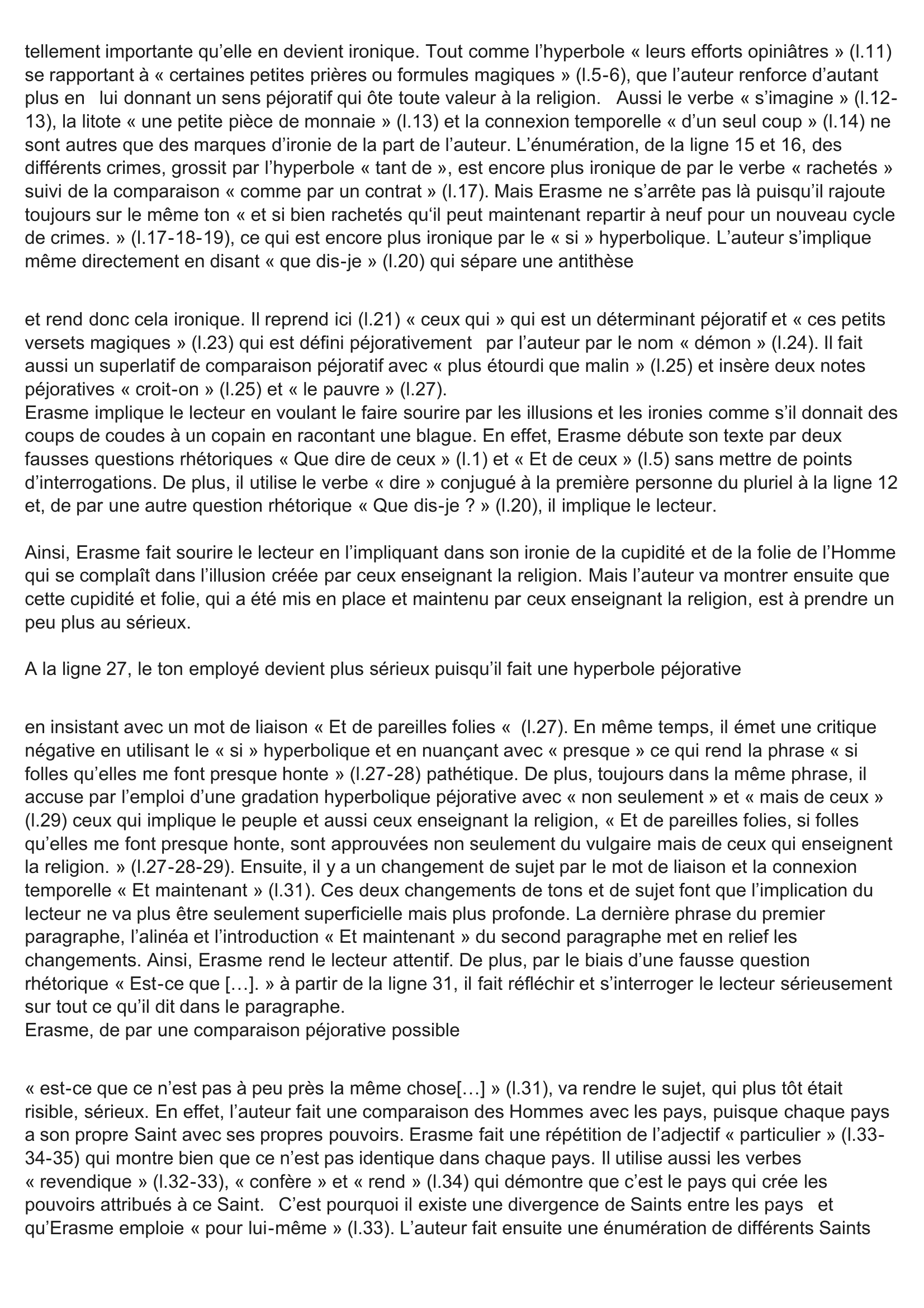commentaire sur Eloge de la Folie d’Erasme
Publié le 22/12/2012

Extrait du document


«
tellement importante qu’elle en devient ironique.
Tout comme l’hyperbole « leurs efforts opiniâtres » (l.11)
se rapportant à « certaines petites prières ou formules magiques » (l.5-6), que l’auteur renforce d’autant
plus en lui donnant un sens péjoratif qui ôte toute valeur à la religion.
Aussi le verbe « s’imagine » (l.12 -
13), la litote « une petite pièce de monnaie » (l.13) et la connexion temporelle « d’un seul coup » (l.14) ne
sont autres que des marques d’ironie de la part de l’auteur.
L’énumération, de la ligne 15 et 16, des
différents crimes, grossit par l’hyperbole « tant de », est encore plus ironique de par le verbe « rachetés »
suivi de la comparaison « comme par un contrat » (l.17).
Mais Erasme ne s’arrête pas là puisqu’il rajoute
toujours sur le même ton « et si bien rachetés qu‘il peut maintenant repartir à neuf pour un nouveau cycle
de crimes.
» (l.17 -18-19), ce qui est encore plus ironique par le « si » hyperbolique.
L’auteur s’implique
même directement en disant « que dis-je » (l.20) qui sépare une antithèse
et rend donc cela ironique.
Il reprend ici (l.21) « ceux qui » qui est un déterminant péjoratif et « ces petits
versets magiques » (l.23) qui est défini péjorativement par l’auteur par le nom « démon » (l.24).
Il fait
aussi un superlatif de comparaison péjoratif avec « plus étourdi que malin » (l.25) et insère deux notes
péjoratives « croit-on » (l.25) et « le pauvre » (l.27).
Erasme implique le lecteur en voulant le faire sourire par les illusions et les ironies comme s’il donnait des
coups de coudes à un copain en racontant une blague.
En effet, Erasme débute son texte par deux
fausses questions rhétoriques « Que dire de ceux » (l.1) et « Et de ceux » (l.5) sans mettre de points
d’interrogations.
De plus, il utilise le verbe « dire » conjugué à la première personne du pluriel à la ligne 12
et, de par une autre question rhétorique « Que dis-je ? » (l.20), il implique le lecteur.
Ainsi, Erasme fait sourire le lecteur en l’impliquant dans son ironie de la cupidité et de la folie de l’Homme
qui se complaît dans l’illusion créée par ceux enseignant la religion.
Mais l’auteur va montrer ensuite que
cette cupidité et folie, qui a été mis en place et maintenu par ceux enseignant la religion, est à prendre un
peu plus au sérieux.
A la ligne 27, le ton employé devient plus sérieux puisqu’il fait une hyperbole péjorative
en insistant avec un mot de liaison « Et de pareilles folies « (l.27).
En même temps, il émet une critique
négative en utilisant le « si » hyperbolique et en nuançant avec « presque » ce qui rend la phrase « si
folles qu’elles me font presque honte » (l.27 -28) pathétique.
De plus, toujours dans la même phrase, il
accuse par l’emploi d’une gradation hyperbolique péjorative avec « non seulement » et « mais de ceux »
(l.29) ceux qui implique le peuple et aussi ceux enseignant la religion, « Et de pareilles folies, si folles
qu’elles me font presque honte, sont approuvées non seulement du vulgaire mais de ceux qui enseignent
la religion.
» (l.27 -28-29).
Ensuite, il y a un changement de sujet par le mot de liaison et la connexion
temporelle « Et maintenant » (l.31).
Ces deux changements de tons et de sujet font que l’implication du
lecteur ne va plus être seulement superficielle mais plus profonde.
La dernière phrase du premier
paragraphe, l’alinéa et l’introduction « Et maintenant » du second paragraphe met en relief les
changements.
Ainsi, Erasme rend le lecteur attentif.
De plus, par le biais d’une fausse question
rhétorique « Est -ce que […].
» à partir de la ligne 31, il fait réfléchir et s’interroger le lecteur sérieusement
sur tout ce qu’il dit dans le paragraphe.
Erasme, de par une comparaison péjorative possible
« est-ce que ce n’est pas à peu près la même chose[…] » (l.31), va rendre le sujet, qui plus tôt était
risible, sérieux.
En effet, l’auteur fait une comparaison des Hommes avec les pays, puisque chaque pays
a son propre Saint avec ses propres pouvoirs.
Erasme fait une répétition de l’adjectif « particulier » (l.33 -
34-35) qui montre bien que ce n’est pas identique dans chaque pays.
Il utilise aussi les verbes
« revendique » (l.32 -33), « confère » et « rend » (l.34) qui démontre que c’est le pays qui crée les
pouvoirs attribués à ce Saint.
C’est pourquoi il existe une divergence de Saints entre les pays et
qu’Erasme emploie « pour lui -même » (l.33).
L’auteur fait ensuite une énumération de différents Saints.
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Fiche de bac Eloge de la folie Erasme chap 40 ²
- Fiche de lecture Eloge de la Folie Erasme
- lecture analytique Eloge de la folie de Erasme
- Ecriture d'invention : Erasme "l'eloge de la folie "
- Lecture analytique Erasme, Eloge de la folie